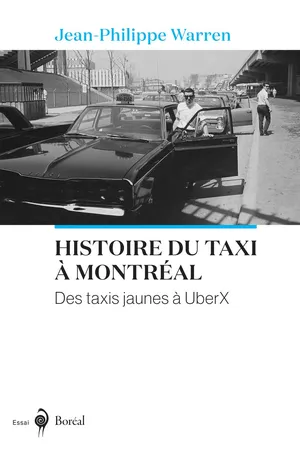chapitre 1
Des voitures de maître (1910-1929)
L’histoire des chauffeurs de taxi à Montréal a une préhistoire. C’est celle des cochers de fiacre qui, depuis le début du xixe siècle, se tiennent sur la place du Vieux-Marché (aujourd’hui place de la Douane), la place Jacques-Cartier, la place d’Armes et quelques autres lieux passants du centre de la métropole. À cette époque, la profession n’est pas très développée : à peine quelques cabriolets et calèches circulent pour transporter des passagers. Le contexte change dans la seconde moitié du xixe siècle, quand la population montréalaise fait mieux que quintupler. L’aire urbaine s’étire désormais sur une douzaine de kilomètres et cet étalement crée une demande pour des moyens de déplacement rapides et efficaces. On assiste à la multiplication des carrosses, calèches et autres voitures sur roues (l’été) ou sur patins (l’hiver), tirés par un ou plusieurs chevaux. Des règlements municipaux encadrent cette industrie en plein essor. Les propriétaires de « voiture de louage » doivent obtenir du chef de police un permis et une plaque d’immatriculation, se garer aux endroits prévus et ne pas dépasser le nombre de places autorisées. Par exemple, cinq voitures, la tête des chevaux tournée du côté de la rue Notre-Dame, peuvent se garer sur le côté ouest de la rue Bonsecours, près de la rue Saint-Paul. Le cahier des charges de la Ville indique le prix à payer par les passagers pour un trajet d’un quart d’heure, d’une demi-heure et d’une heure et pour chaque heure supplémentaire, selon que la voiture est tirée par un cheval ou deux. Il est permis aux conducteurs d’exiger cinquante pour cent de plus pour les courses effectuées entre minuit et quatre heures du matin. Les voitures qui circulent la nuit doivent être équipées de lanternes.
Les services de ces « cochers de place », comme on les appelle, vont subir de plein fouet la concurrence des omnibus hippomobiles, c’est-à-dire des voitures de six à huit passagers tirées par des chevaux, lesquelles deviennent aussi abordables que populaires dès le moment où elles commencent à sillonner la ville, en 1841. En 1861, la Montreal City Passenger Railway Company crée un véritable réseau de tramways sur rails, qui deviendra électrique en 1892. La prolifération des « p’tits chars » fait très mal aux caléchiers. Au tournant du xxe siècle, ceux-ci se lamentent d’en être réduits à une extrême privation, d’autant plus qu’ils doivent, la plupart du temps, louer leur voiture et leur cheval. Pour mieux faire face à la concurrence, des voix leur suggèrent de se bâtir une clientèle stable, d’obtenir de plus généreux pourboires en offrant un service supérieur, d’abréger leurs visites au café du coin, de presser encore davantage le pas de leurs chevaux. Mais les efforts des cochers pour préserver leur part de marché ne résistent pas à l’engouement croissant pour les tramways électriques, plus réguliers, plus rapides, plus efficaces, plus sécuritaires et, de surcroît, moins chers. L’expansion du tramway jette par conséquent des milliers de cochers à la rue ou les pousse à la misère. « Depuis que les chars électriques ont pris possession de nos rues, écrit-on en 1897, non seulement le nombre de cochers de place a diminué, mais ceux qui restent se plaignent qu’ils ne gagnent presque rien. Ils passent leurs journées et leurs veillées dans l’oisiveté. L’entrain et la gaieté d’autrefois n’existent plus. »
Les cochers de fiacre n’ont rien vu encore : au printemps 1898, pour la première fois, les Montréalais peuvent admirer les performances d’une « voiture sans cheval ». L’engouement pour l’automobile ne se démentira pas dans les années suivantes, transformant en profondeur le paysage urbain tout autant que les mœurs citadines. Il ne faut pas longtemps pour que des personnes songent à faire un usage commercial de ce nouveau moyen de locomotion. Les cochers de fiacre de Montréal comprennent d’emblée que cette invention risque d’entraîner leur ruine définitive, comme le tramway hippomobile puis électrique avait provoqué leur déclin abrupt. Devant la Commission de police et le Conseil municipal, ils cherchent à bloquer l’automobile de louage. Peu sensibles à leurs arguments, les élites ne croient pas qu’il soit bon d’entraver le libre marché dans le domaine des transports. « Nous ne sommes aucunement surpris, écrivent les éditeurs de La Presse, de voir les cochers de place s’opposer à la concurrence des automobiles. Il est très naturel qu’ils se protègent. Mais ce qui ne serait pas naturel, ce qui serait contraire à toute idée de progrès, ce serait que la Commission de police se rendît à la requête des cochers et mît une entrave à l’automobilisme de place. » Aussi, pas plus qu’ils n’avaient su freiner l’extension du tramway, les cochers ne sont en mesure de s’opposer à l’octroi de permis de transport de passagers aux automobilistes. L’arrivée des chauffeurs de taxi signale la disparition de leur profession – qui survivra, pour l’essentiel, comme attraction folklorique pour les touristes en visite sur le mont Royal ou, jusqu’en 2020, dans le Vieux-Montréal.
Le triomphe du taximètre
Le 18 septembre 1909, le taxi motorisé fait son apparition à Montréal, après avoir conquis New York, Chicago et Toronto deux ans plus tôt. Désormais approuvé par la Commission de police, le premier permis d’exploitation d’un « autotaxi » appartient à Berna Motors and Taxicab Ltd., dont le siège social est à Toronto. « Dans notre siècle de progrès, peut-on lire dans un article enthousiaste de La Presse, ce qui aujourd’hui paraît n’être que du luxe, devient demain une nécessité, et le public qui s’habitue vite aux méthodes modernes adopte rapidement celle de se faire transporter, ainsi que ses marchandises, par procédés mécaniques. » La compagnie ne compte toutefois pas établir un service régulier avant au moins quelques mois, car les moteurs de ses véhicules ne sont pas encore assez puissants pour gravir les pentes de la métropole. Le 7 juin 1910, on annonce donc une nouvelle fois l’arrivée des premiers taxis à Montréal. Le rédacteur de La Presse se rend sur les quais du port afin de voir par lui-même la « voiture de place » grâce à laquelle, au dire du directeur de la compagnie Canadian Auto-Taxi, Arthur Vaillancourt, le transport des personnes dans la métropole sera assuré. « Délicieuses sous son vernis vert foncé, avec ses garnitures intérieures en drap gris, et tout le confort moderne ; éclairage électrique, acoustique, chauffage à vapeur, etc. ; c’est une merveille du genre que cet autotaxi, et nul doute que tout le monde voudra s’en servir, pour aller par nos belles journées faire une promenade autour de la montagne ou sur le bord du Saint-Laurent. » Cette prédiction se révèle exacte et, dès 1915, il y a déjà une centaine de taxis en service dans la métropole, lesquels sont gérés par une ribambelle d’entrepreneurs.
Le transport par taxi est rapidement très populaire. Dès 1920, à elles seules, les voitures de la compagnie Bramson parcourent en moyenne chaque mois 110 000 kilomètres, transportent 50 000 passagers et consomment 30 000 litres d’essence. Source : La Presse, 4 juin 1930.
En apparence, les chauffeurs de taxi exercent un métier similaire à celui des cochers de place. Seul semble changer le type de locomotion, la traction animale étant remplacée par la traction mécanique. La fonction des taxis consiste, tout comme avant, à déplacer sur d’assez courtes distances des voyageurs à bord d’un véhicule conduit par un chauffeur moyennant rétribution. Après une période de flottement, les règlements municipaux qui s’appliquaient aux cochers sont d’ailleurs simplement reconduits, sans grandes modifications, pour les chauffeurs de taxi. Au départ, les taxis occupent les mêmes postes d’attente que les calèches et utilisent les mêmes téléphones. Il y a donc en apparence une transition presque parfaite d’une profession à l’autre. Une seule différence demeure, mais elle n’est pas aussi anodine qu’il y paraît : les chauffeurs de taxi ne sont pas payés à l’heure comme les cochers des voitures de louage, mais en fonction de la distance parcourue. Leur véhicule est muni d’un taximètre, c’est-à-dire d’un instrument « par lequel le prix de louage d’un autotaxi est mécaniquement calculé ».
Dans l’esprit des administrateurs, le taximètre permet de tracer une distinction non seulement entre le taxi (payé d’abord selon la distance) et la voiture de louage (payée d’abord à l’heure), mais aussi entre le véhicule populaire et la voiture de luxe. Les tarifs du taxi sont en effet moins élevés que ceux de la voiture de louage (laquelle, à l’époque, vient toujours avec son chauffeur, la location de voiture n’existant pas encore), car on considère que celle-ci s’adresse à l’élite et sert d’abord à effectuer de longues promenades à l’extérieur de la ville ou à se déplacer lors d’événements spéciaux, comme les baptêmes, les mariages et les enterrements. Il y aura sans cesse confusion entre ces deux types de transport, les chauffeurs de taxi accusant régulièrement – pas toujours à tort – les voitures de louage d’être des taxis déguisés. D’un autre côté, les chauffeurs seront passablement frustrés de se voir confier la responsabilité d’un transport en commun (c’est-à-dire collectif) à coût modique sans aucune des subventions ni aucun des avantages que les gouvernements accordent aux...