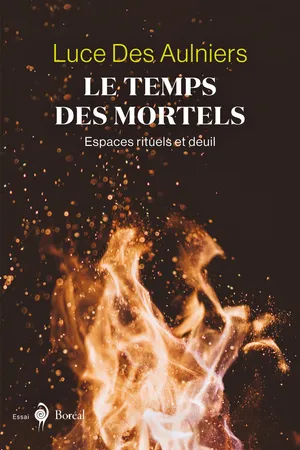chapitre 1
La terre, ou le passage-repos
Terre, la référence fondatrice des pas humains.
Partant, il n’est pas étonnant qu’elle soit le premier élément naturel par lequel se sont signés les rapports humains à la mort :
On sait avec certitude que le donné anthropologique de la mort remonte quasiment à l’apparition de l’homme. Il existe des preuves de sépultures volontaires dès le Paléolithique moyen ( – 100 000 à – 35 000 ans) ; la présence de fosses, d’offrandes, d’ossements d’animaux déposés sur les squelettes montre que l’homme de Néandertal inhumait ses morts. Sans doute, des interrogations subsistent puisqu’on ne sait rien des croyances qui sous-tendent ces pratiques. Mais avec le Mésolithique ( – 10 000 ans), des squelettes inhumés en position fœtale, regroupés en d’authentiques nécropoles où l’on trouve de l’ocre, du mobilier funéraire et des parures, parfois des traces de pollen, accréditent l’idée de la mort-naissance et de la survie.
Ce lieu originel a été par la suite investi sous plusieurs variantes. En effet, les formes de mise en terre sont multiples et obéissent à la fois à des impératifs géologiques et à des croyances quant au confort des esprits associés à la définition multivoque de la personne : tertres, mégalithes, tumuli étrusques, pyramides, cryptes, catacombes, urnes, puits, fosses, grottes…
Cette diversité des demeures d’éternité (pour employer la métaphore égyptienne) ne saurait toutefois dissiper ce fait : le rapport à la terre est celui qui, de tous les éléments, est le plus marqué d’ambivalence, attestant ainsi la complexité universelle devant la mort dont traite cet ouvrage.
Des éléments naturels multivoques
D’emblée, la valence positive de la terre rend compte d’un retour au sein de cette part de l’univers sur laquelle on a marché et qui nous a nourris. Terre-Mère. Dans cette ligne du don et de sa reconnaissance, la sépulture est associée à la mort contenue, bercée, sous figuration maternelle, donnant lieu à un nouvel enfantement : ainsi, pour plusieurs cultures africaines, la tombe est une sorte de chambre à coucher où s’opère une intense transformation de la vie. On confie le mort au sein de la vieille en vue d’une nouvelle initiation. La cosmogonie autochtone, de la boréale à l’australe, renvoie à un imaginaire parent, la terre étant certitude vitale : « Notre terre vaut mieux que de l’argent. Elle sera toujours là. Elle ne périra pas, même dans les flammes d’un feu. Aussi longtemps que le soleil brillera et que l’eau coulera, cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux. Nous ne pouvons vendre la vie des hommes et des animaux ; c’est pourquoi nous ne pouvons vendre cette terre. Elle fut placée ici par le Grand Esprit et nous ne pouvons la vendre parce qu’elle ne nous appartient pas… »
Par extension, l’analogie entre humus, terreau, terroir et le domaine de l’âge qui hérite d’une grande espérance de vie confère à la vieillesse un statut méritoire dans la société des vivants. Ce trait est typique des sociétés privilégiant un rapport au temps cyclique, comme on le verra.
Pour sa part, la valence négative de la mise en terre renforce l’angoisse fondamentale et universelle de ne pas être réellement mort. Bien plus, l’association avec la mort maternelle, si empreinte de douceur lénifiante, n’est pas non plus dénuée d’angoisse : celle-ci est liée à la séparation, à la parfois redoutée déperdition du lien originel.
Cette ambivalence se traduit puissamment dans le sort du cadavre, et ce, pour toutes les variations archétypales. Point essentiel : ce sort est déterminé aussi bien par les croyances populaires que par les systèmes eschatologiques. Les religions communes ou instituées et les philosophies élaborent toutes un récit à propos des fins dernières ou des destinées d’un ou de plusieurs principes spirituels, eu égard au corps. J’en donnerai des exemples.
Systèmes et croyances s’emploient à rationaliser et à tenter de dépasser le désarroi, si ce n’est l’effroi, que le cadavre inspire. À travers ceux-ci, on peut lire un rapport symbolique global à la nature, humaine et environnementale, rapport synergique et unifié, qui n’agit pas que devant la mort.
D’évidence, l’inhumation suit le processus naturel du cycle de la vie et de la mort. La symbolique de l’enterrement se coule dans la naturalité, puisqu’on laisse ce cadaver cadare, c’est-à-dire tomber dans le sol, certes avec ménagement. Cette conformité à l’ordre matériel premier, perpétuellement recommencé, ne signifie pas pour autant que l’acceptation en soit aisée, mais plutôt qu’elle tisse une logique complexe. Comment ?
Stratégies devant l’incontrôlable : l’accueillir de plain-pied pour le transformer
Cette logique procède d’une conception de l’humanité et de l’identité axée sur la part d’indéterminé dans l’humain, à savoir le mystère, justement, de sa finitude. (On parlera alors volontiers de la mort comme énigme, en soi et dans le processus qui y mène, à propos de la transmission intergénérationnelle.)
Or, l’étrange, ce qui dépasse l’entendement, fabrique le « numineux ». Dans l’ambivalence comme matrice de nos rapports au monde, ce numineux attire en même temps qu’il peut rebuter. Et la déliquescence, puis la désagrégation d’un corps humain, d’autant plus s’il est individualisé, rend l’angoisse insoutenable. Il va donc falloir se défendre de la face troublante de ce numineux, ici, en s’alliant avec lui. Ce « jaillissement de vie dans la mort », disait Louis-Vincent Thomas, est alors considéré dans toute son ampleur, et sa violence sera récupérée. Violence, oui. La mort est intrinsèquement violente puisque la déperdition corporelle annonce l’indifférenciation ultime. Elle est à la base forcément intolérable pour l’être humain qui cherche à la fois à s’intégrer comme un tout et à se distinguer dans un tout.
Par quelles astuces l’imaginaire peut-il convertir positivement de telles valences négatives ? En saisissant à bras-le-corps un phénomène a priori déstabilisateur, en négociant avec les forces pouvant être reçues comme délétères : en les interprétant autrement. De fait, on accueille en toute conscience, même malheureuse ; on manœuvre en rusant, on fait bifurquer le sens brut trop ardu de cette altérité si altérante vers des aménagements plus amènes. (Nous investiguerons cette merveilleuse maîtrise symbolique, qui vient moduler les effets pénibles d’une situation et nous entraîne imaginairement ailleurs.) Comment donc s’arroger une part de cette puissance de l’étrange pour la transformer ?
Sous l’égide du rapport à la terre se forgent alors les modes de défense contre la déperdition physique que sont l’affrontement, la délimitation, l’amplification ponctuelle des affects, le rassemblement, la prolongation. Ils fondent largement la psyché humaine.
On va commencer par accueillir ce numineux considéré comme impur en accusant son caractère perturbateur, et ce, selon deux stratégies.
Purifier
On consent d’abord à cette « pollution » qu’est la putréfaction en la délimitant : la toilette du mort a notamment cette fonction. Plus ou moins élaborée, elle vient atténuer les signes extérieurs de la cadavérisation et de ses abîmes en les cernant, en les esthétisant, en les théâtralisant momentanément. De la sorte, la toilette tient provisoirement les proches dans le « comme si » le mort était toujours vivant. Ce déni que l’on pourrait estimer tel ne l’est pas entièrement, car si on pressent que « faire comme si » vient symboliquement atténuer l’effraction de la mort, on ne se leurre pourtant pas sur elle : on joue. Le « comme si » prend alors fonction de tiers ou de médiateur entre l’effraction par la mort et son impact, comme un retardateur-coussin, un atténuateur de brutalité.
Par conséquent, laver enraie les effets numineux de la mort dans un échange prophylactique unissant vivants et morts. Il s’agit, d’une part, de prévenir la contamination des vivants du groupe social en lavant le cadavre, ainsi que soi-même, associé à ce mort, par exemple à titre de proche ; le geste est à la fois sanitaire et symbolique, technique et du registre de la piété filiale élémentaire. D’autre part, pour que les esprits nocifs n’assaillent pas le défunt, on le protège symboliquement en purifiant les alentours, ou encore en aspergeant le cadavre d’eau florale, quand ce n’est bénite. Cette purification inaugure d’ailleurs un jeu de coloris en damier, universel en soi, mais inversé : en Occident, le blanc, du linceul aux linges et aux broderies, afin justement de prémunir le défunt et d’en appeler de sa quiétude ; le noir, des habits des vivants, sous divers camaïeux de densité, aux rideaux, aux brassards et aux banderoles, afin de signaler le passage dans le sombre.
En somme, dans l’implicite, tout geste de purification prend assise sur cette violence à l’œuvre dans la matérialité du corps humain. (Ce geste empreint de douceur n’est pas rare de nos jours dans les unités de soins qui laissent un battement de temps pour les proches, afin que l’abord de cette violence ne soit davantage blessant et que celle-ci puisse être minimalement résorbée.) Cette dynamique sera cruciale dans l’exploration plus précise des rites dits de retenue, à composante affective complexe, au chapitre 3.
Mimer et répliquer
On ne va pas qu’acquiescer en affrontant, selon des règles de circonspection. Seconde stratégie, on va aussi accepter l’étrangeté du cadavre en le mimant. Tout enfant, mimer, adopter sans le savoir des traits de l’autre parce qu’on y est attaché, constituait une stratégie de base de l’identification ou de la constitution de notre identité. Ici, mimer provisoirement et certes partiellement l’état de l’autre nous fait nous identifier à la condition de mortel. Davantage, mimer la mort s’avère un mode de défense essentiel : toute identité vient s’y consolider sous son versant d’intégration en une unité.
Une des modalités de cette protection mimétique tient dans le linceul de lin. Le linceul, enveloppe et contenant universel, n’est pas uniquement équivalent à l’humilité devant l’égalité du so...