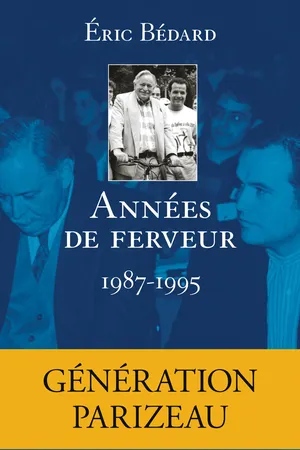1
« J’y arrivais… »
Petit, l’homme qui, quel que soit est son rang, est son propre but. Grand, quiconque accepte qu’il y ait plus grand que lui et s’y subordonne librement.
RÉGIS DEBRAY
Sept ans plus tôt, je me trouvais dans une salle surchauffée de l’est de Montréal. Une connaissance du collège de Maisonneuve m’avait refilé l’information : le candidat à la chefferie du Parti québécois s’adresserait à des jeunes. Comme j’aimais la politique et que je multipliais les lectures sur l’histoire récente du Québec, je n’allais pas manquer ce rendez-vous. J’aimais la politique, pourtant je préférais encore le football. Je ne m’étais jusque-là jamais engagé sérieusement dans un parti ou un mouvement. Je venais à peine de passer le cap des dix-huit ans. La mort de René Lévesque m’avait pris de court, quelques mois plus tôt. Pendant une semaine, la vie avait suspendu son rythme, les Québécois s’étaient recueillis. Sur nos écrans de télévision, nous avions vu les barons de l’indépendantisme québécois décrire, émus, la grandeur du personnage que j’avais connu sur son déclin. Camille Laurin, Jacques-Yvan Morin, Jean Garon et plusieurs autres défilaient, tous plus graves et solennels les uns que les autres. Je les écoutais religieusement, car ils m’impressionnaient beaucoup. Je vivais mon premier « deuil national ». Peu après cette disparition, les événements s’étaient précipités : Gérald Godin avait critiqué la tiédeur indépendantiste du chef Pierre Marc Johnson, qui avait aussitôt annoncé sa démission. Pour lui succéder, un seul candidat était sur les rangs : Jacques Parizeau…
C’était un dimanche de l’hiver 1988. Je suis arrivé seul avant l’heure indiquée, car je voulais avoir une bonne place. Comme je n’avais jamais milité au Parti québécois, je ne connaissais absolument personne. Je voyais des jeunes s’affairer aux tables d’accueil, vendre des cartes de membre, écrire avec soin des noms sur des listes. Ils appartenaient à un monde qui m’était encore étranger, mais auquel je brûlais de me fondre. Ils communiaient à un grand idéal et travaillaient à le rendre possible. Je les trouvais beaux et sains.
La vedette du jour se fit beaucoup attendre. André Boisclair et Gilles Baril tentaient de réchauffer la salle, sans grand succès. Ce n’étaient pas ces apprentis politiciens que nous étions venus voir, mais le grand Jacques Parizeau, légendaire ministre des Finances du gouvernement Lévesque. Lorsqu’il se présente enfin sur la scène, je reconnais le personnage que j’avais parfois aperçu à la télévision. C’était avant le décès de sa première femme, l’écrivaine Alice Poznańska ; avant son mariage avec Lisette Lapointe, qui allait transformer son look. Il portait encore un complet trois pièces très foncé. Avec ses cheveux lisses et ses rondeurs, il ressemblait davantage à un banquier suisse qu’à un chef indépendantiste. Il n’adoptait pas le style théâtral des « grands orateurs » à la Pierre Bourgault. Son débit était lent, son ton professoral, sa logique cartésienne. Ce qu’il nous expliquait avait été longuement mûri, et nous nous sentions privilégiés, nous, modestes cégépiens pour la plupart, d’être exposés aux thèses de ce savant professeur d’économie, diplômé de la prestigieuse London School of Economics.
Comme il s’adressait à une assemblée formée de jeunes, il tenait pour acquis que nous désirions connaître sa position sur le dégel des frais de scolarité – annoncé par le gouvernement libéral de l’époque. En soi, le sujet était important, mais il ne m’intéressait guère, car il était déjà établi que j’irais à l’université, hausse des frais de scolarité ou pas. Aussi, l’auditoire devant lui n’était pas formé de représentants du mouvement étudiant, mais de jeunes indépendantistes rêvant du Pays. Le professeur Parizeau ne l’avait apparemment pas bien saisi… Son développement sur les réformes de la Révolution tranquille et la gratuité scolaire me sembla tout simplement interminable.
Lorsqu’il s’interrompt brièvement pour prendre une gorgée d’eau de sa main tremblotante, une voix un peu rebelle retentit du fond de la salle : « Monsieur Parizeau, et la souveraineté dans tout ça ? » Impassible, notre orateur lève les yeux et toise ce camarade un peu frondeur qui avait crié tout haut la seule question que nous brûlions tous de lui poser. Son visage s’assombrit et ses yeux se froncent. Il baisse lentement la tête vers le lutrin qu’il entoure de ses deux bras. De longues secondes passent… Était-il en colère ? Allait-il donner des leçons de civilité à ce militant un peu trop fougueux ? Ou pire encore : allait-il tout simplement tourner les talons et retourner chez lui ? Nous retenions notre souffle… Concentré, rougeaud, M. Parizeau relève la tête et, le regard fixe, laisse tomber : « Justement… J’y arrivais… »
« J’y arrivais… » Ces mots, pleins de gravité, ont l’effet d’une décharge électrique. J’en ressens un grand frisson et me lève spontanément pour applaudir, comme tous les autres cégépiens de cette salle, gagnés comme moi par la ferveur militante. À partir de cet après-midi, j’allais suivre cet homme. Moi qui n’avais pas vraiment connu René Lévesque, je serais de la « génération Parizeau ». C’est ce « j’y arrivais » qui a tout déclenché. Dans ces mots, dans ce ton, dans ce regard, je sentais une force de conviction qui avait la solidité du roc. Cette conviction, cela tenait de l’évidence, n’était pas portée par un politicien de carrière en quête d’une cause pour se faire élire : c’était celle d’un universitaire patenté qui s’était jeté dans la mêlée parce qu’il y croyait vraiment. Je sentais, nous le sentions tous, que nous pouvions lui faire confiance et qu’il ne nous décevrait pas. Je ne me souviens guère de la suite de son discours. Après son fameux « J’y arrivais », il a dû probablement nous expliquer les raisons fondamentales de faire la souveraineté, raisons que la plupart d’entre nous connaissions déjà. Au fond, nous n’étions pas là pour réentendre l’argumentaire souverainiste, mais pour sentir la volonté d’un personnage d’envergure qui, par son action, pourrait transformer ce rêve en réalité.
C’est plus tard que j’ai compris ce qui m’avait tant attiré chez Jacques Parizeau dès cette première assemblée. Difficile de départager les perceptions que nous nous forgeons des êtres que nous croisons tout au long de notre vie. Difficile de comprendre pourquoi un personnage nous marque plus qu’un autre. J’ai saisi avec le temps que les idées ou les arguments ne sauraient à eux seuls tout expliquer. Le style, c’est l’homme, répétait Buffon, un savant du XVIIIe siècle. Lorsque nous décidons de suivre quelqu’un, nous n’appuyons pas seulement son programme, nous adhérons à sa personne, à ce qui émane d’elle. Or le style de Jacques Parizeau m’avait beaucoup impressionné. Il faut dire qu’il tranchait tellement avec l’air du temps. En théorie, il n’avait absolument rien pour plaire aux jeunes : il cultivait une certaine distance, vouvoyait ses plus proches collaborateurs, respirait le sérieux et la rigueur. Il n’avait rien du politicien cool et décontracté qui souhaite créer une fausse familiarité dès la première rencontre. À l’ère de la pédagogie du vécu, de l’authenticité à tout prix et des tripes sur la table, il semblait venir d’un autre âge. Ses références, son humour, ses manières surtout donnaient à voir un homme qui assumait totalement non seulement son âge, mais sa condition de bourgeois. Son arrière-grand-père avait cofondé la première chambre de commerce francophone de Montréal, son grand-père avait étudié la médecine à Paris, son père lancé une compagnie d’assurance et écrit des livres d’histoire sur notre XIXe siècle. Aucun complexe chez cet homme, mais aucun snobisme non plus. Son rire tonitruant, sa bonhomie pleine de distinction, son respect pour les arguments que, du haut de vos dix-huit ans, vous lui soumettiez m’avaient complètement conquis.
Le style de Jacques Parizeau, j’allais le comprendre plus tard, c’était aussi celui d’un homme qui n’opposait pas la réflexion à l’action – une opposition que j’allais souvent rencontrer en politique et à l’université par la suite. Aucun dualisme stérile chez lui : la pensée façonnait l’action en même temps que l’action nourrissait la pensée. Il n’y avait pas, d’un côté, les grands esprits qui contemplent le monde de haut mais qui ne condescendent jamais à s’y engager et, de l’autre, ces opérateurs frénétiques, certes branchés « sur le terrain », mais qui s’activent comme des poules sans tête. Son intelligence ne tournait pas à vide ; elle était en prise sur le réel d’un monde qu’il avait déjà contribué à changer durant la Révolution tranquille et les années Lévesque. Il avait à la fois une compréhension théorique et abstraite des enjeux qu’il abordait et une intelligence pratique qui lui permettait d’envisager des réformes concrètes. Son intelligence était conceptuelle et tactique ; non sans panache, il chevauchait le monde de l’esprit et celui de l’action.
À la fin de l’assemblée, j’ai signé ma première formule d’adhésion au Parti québécois. Enthousiaste comme un converti, j’allais installer, quelques semaines plus tard, une grande affiche noir et blanc de M. Parizeau dans ma chambre. Ce zèle d’adolescent me fait sourire lorsque je repense aux visages étonnés de mes parents et de mon frère cadet, Marc, avec qui je partageais ma chambre, sans parler des commentaires moqueurs de ma copine de l’époque, que le regard sérieux de « Monsieur » devait parfois distraire ! Comme bien des jeunes hommes de dix-huit ans, je rêvais d’un mentor, d’un guide. J’étais convaincu d’en avoir trouvé un. À l’occasion de cette assemblée de jeunes, il nous avait proposé de travailler avec lui, j’allais répondre à cet appel. Si j’étais déjà convaincu de la justesse d’une cause politique, désormais j’allais suivre un « grand homme ».
Cette adhésion aux « grands hommes » n’a pas très bonne presse aujourd’hui. Les féministes y voient un reliquat du patriarcat, les « progressistes » craignent les dérives fascisantes. L’époque semble complètement acquise à la philosophie égalitariste ; elle ne prise guère ces personnages qui s’élèvent au-dessus de la mêlée, sauf s’ils nous ressemblent et savent, transparence oblige, se montrer aussi faillibles que nous. Dans l’ordre politique n’ont de valeur que les sondages et les consultations ; n’ont raison que la société civile ou la majorité silencieuse, ces grandes masses anonymes qui détiendraient une sorte de vérité révélée. On oublie trop souvent que les idées, pour exister, ont besoin d’être incarnées ; que les peuples, pour grandir et avancer, ont besoin de chefs inspirants. J’admets que les enjeux sont complexes, qu’une démocratie saine doit cultiver une manière de délibérer pour qu’émergent des solutions rassembleuses. Mais la discussion ne doit pas être une fin en elle-même. Lorsqu’elle se prolonge indûment, les gens se lassent et retournent vaquer à leurs occupations. Vient un moment où il faut choisir un chemin et décider. Pour les décisions lourdes qui engagent l’avenir, il est humain de se tourner vers des êtres d’exception dont on respecte le jugement et l’expérience. Le plus souvent, ce sont eux qui auront inspiré la décision ; eux qui mettront en œuvre les changements souhaités. Dans la mesure où ces grands personnages ne se prennent pas pour Dieu et se soumettent aux règles d’une démocratie libérale, il est bon qu’il en soit ainsi. À la suite de Mathieu Bock-Côté, je crois qu’il est sain de sentir qu’une volonté humaine peut infléchir le cours de l’histoire. Le « grand homme » qui réoriente la destinée d’un peuple montre, par son action, que le monde est autre chose qu’une mécanique froide mue par des forces supérieures qui nous échappent. Grâce à ces êtres d’exception, ce sont les hommes qui font l’histoire.
***
Au matin de ma vie adulte, tout concourait à me convaincre que l’histoire n’avait rien d’un long fleuve tranquille. Nous assistions, presque en direct, à l’effondrement du bloc soviétique. Un soir de novembre 1989, je vis à la télévision de jeunes Allemands démolir des sections du mur de Berlin. Les uns après les autres, les pays d’Europe centrale tournaient le dos à la tyrannie communiste, parfois dans la fureur destructrice, comme en Roumanie, souvent dans la joie et l’allégresse, comme en Tchécoslovaquie. J’étais d’ailleurs très impressionné par les écrivains tchécoslovaques qui avaient résisté, par leur seule plume, à l’oppression. J’admirais particulièrement le grand Václav Havel, emprisonné pour ses écrits « séditieux », dont la Charte 77, un plaidoyer en faveur des droits de l’homme. J’avais lu et annoté les essais de ce poète qui deviendrait pré-sident de son pays un mois plus tard, à la faveur de la « révolution de velours ». Plus tard, je découvrirais sa conception « morale » de la politique :
La politique telle que je la comprends, écrivait-il, est une des manières de chercher et d’acquérir un sens dans la vie ; une des manières de protéger et de servir ce sens ; c’est la politique comme morale agissante, comme service de la vérité, comme souci du prochain, souci essentiellement humain, réglé par des critères humains. C’est là sans doute, dans le monde actuel, une conception très peu pratique et très ...