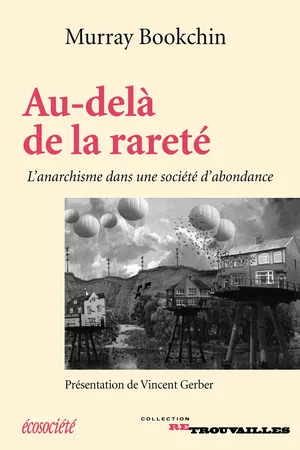![]()
Les événements de mai-juin 1968 en France. 1 – France: un mouvement pour la vie
(1968)
La qualité de la vie quotidienne
Le soulèvement de mai-juin 1968 fut l’un des événements les plus importants qui se soient produits en France depuis la Commune de Paris en 1871. Il a non seulement ébranlé les fondations de la société bourgeoise française, mais aussi soulevé des questions et proposé des solutions d’une importance sans précédent pour la société industrielle moderne. Il mérite l’étude la plus attentive et la discussion la plus approfondie de la part des révolutionnaires du monde entier.
Le soulèvement de mai-juin s’est produit dans un pays industrialisé, consumériste, moins développé que les États-Unis mais situé essentiellement dans la même catégorie économique. Il a pulvérisé le mythe selon lequel le bien-être et les ressources de la société industrielle moderne sont capables d’absorber toute opposition révolutionnaire. Les événements de mai-juin ont montré que les contradictions et les antagonismes du capitalisme ne sont pas éliminés par l’étatisation et les formes avancées de l’industrialisme, mais seulement modifiés dans leur forme et leur caractère.
Le fait que le soulèvement ait pris tout le monde par surprise, y compris les théoriciens les plus sophistiqués au sein des mouvements marxistes, situationnistes et anarchistes, souligne l’importance de ces événements et soulève la nécessité de réexaminer les sources de l’agitation révolutionnaire dans la société moderne. Les graffiti sur les murs de Paris – «L’imagination au pouvoir», «Il est interdit d’interdire», «Vivre sans temps morts», «Ne travaillez jamais» – constituent une analyse plus convaincante de ces sources que toutes les sommes théoriques héritées du passé. Le soulèvement a révélé que nous sommes à la fin d’une ère et bien engagés dans le début d’une nouvelle. Les forces motrices d’une révolution aujourd’hui, du moins dans le monde industrialisé, ne sont pas simplement la rareté et les besoins matériels, mais aussi la qualité de la vie quotidienne, l’appel à une libération des expériences, le désir de prendre le contrôle de sa propre destinée. Il importe peu que les graffiti sur les murs de Paris aient été initialement écrits par une petite minorité. De tout ce que j’ai vu, il résulte clairement que ces graffiti (qui forment maintenant le contenu de différents livres) ont saisi l’imagination de milliers de personnes. Ils ont touché le nerf révolutionnaire de la cité.
Le mouvement majoritaire spontané
La révolte fut un mouvement majoritaire au sens où il traversa presque toutes les classes sociales en France. Il a intégré non seulement les étudiants et les travailleurs, mais aussi les techniciens, les ingénieurs, les employés de bureau de presque toutes les couches de l’État, la bureaucratie industrielle et commerciale. Il a gagné les professions libérales et les ouvriers, les intellectuels et les joueurs de football, les présentateurs de télévision et les travailleurs du métro. Il a même touché la gendarmerie de Paris et a très certainement atteint la grande masse des conscrits de l’armée française.
La révolte fut d’abord initiée par les jeunes. Elle fut lancée par les étudiants universitaires, puis reprise par les jeunes travailleurs industriels, les jeunes chômeurs et les «blousons noirs» ou les jeunes dits «délinquants» des cités. Il faut mentionner particulièrement les lycéens et les adolescents, qui ont souvent montré plus de courage et de détermination que les étudiants universitaires. Mais la révolte s’est étendue aux personnes plus âgées, travailleurs cols-bleus ou cols-blancs, techniciens et experts. Même si elle a été catalysée par des révolutionnaires conscients, en particulier par des groupes d’affinité anarchistes dont personne ne soupçonnait même l’existence, la grande vague du soulèvement a été spontanée. Personne ne l’a «convoquée», personne ne l’a «organisée»; personne n’a réussi à la «contrôler».
Une atmosphère de fête a régné pendant toutes les journées de mai-juin, un réveil de la solidarité et de l’aide mutuelle, ainsi que d’une individualité et d’une expression personnelle qu’on n’avait plus vues à Paris depuis la Commune. Les gens se redécouvraient littéralement eux-mêmes et redécouvraient leurs semblables humains – ou se reconstruisaient. Dans de nombreuses villes industrielles, les travailleurs ont envahi les places, brandi des drapeaux rouges, lu avidement et discuté tous les tracts qui leur tombaient sous la main. La fièvre de vivre a contaminé des millions de gens, réveillé des sens qu’ils n’avaient jamais pensé posséder, fait éclater une joie et une exaltation qu’ils n’avaient jamais pensé pouvoir éprouver. Les langues étaient déliées, les oreilles et les yeux acquéraient une nouvelle acuité. On chantait en ajoutant aux vieux airs de nouvelles paroles, souvent grivoises. Les salles d’usine devenaient salles de danse. Les inhibitions sexuelles qui avaient glacé la vie de tant de jeunes gens en France se brisaient au fil des jours. Ce n’était pas une révolte solennelle, un coup d’État planifié bureaucratiquement et manœuvré par un parti «d’avant-garde»; c’était spirituel, satirique, inventif et créatif – et là réside sa force, sa capacité de mobilisation spontanée, son pouvoir de contagion.
Beaucoup de gens ont dépassé les limites étroites qui enfermaient leur vision sociale. Pour des milliers d’étudiants, la révolution a renversé le statut maniéré et coincé de l’universitaire, cet état privilégié et pompeux qui s’exprime aux États-Unis par la «déclaration de position» et par la sociologie guindée du document «analytique». Les travailleurs individuels qui sont entrés dans les comités d’action de Censier ont cessé d’être des «travailleurs». Ils sont devenus des révolutionnaires. Et c’est précisément sur la base de cette nouvelle identité que des personnes qui avaient passé leur vie dans des universités, des fabriques et des bureaux ont pu se rencontrer librement, échanger des expériences et s’engager dans des actions communes sans aucune considération pour leurs «origines» ou «antécédents» sociaux.
La révolte avait créé les prémices de sa propre société sans classes ni hiérarchie. Sa première tâche fut d’étendre ce nouveau règne au reste du pays, jusqu’à chaque recoin de la société française. Elle fondait son espoir sur l’extension de l’autogestion sous toutes ses formes: dans les assemblées générales et leurs formes administratives, dans les comités d’action, dans les comités de grève, dans tous les domaines de l’économie, et à vrai dire dans tous les domaines de la vie même. La conscience la plus avancée de cette tâche semble être apparue moins parmi les travailleurs des industries traditionnelles, où la CGT, contrôlée par les communistes, exerçait un pouvoir fort, que parmi ceux des industries techniquement plus avancées, comme dans l’électronique. (J’insiste sur le fait qu’il s’agit là d’une conclusion hypothétique, tirée d’un certain nombre d’épisodes dispersés mais influents qui m’ont été racontés par de jeunes militants dans les comités d’action étudiants-travailleurs).
Autorité et hiérarchie
La lumière que jette la révolte de mai-juin sur le problème de l’autorité et de la hiérarchie est de la plus haute importance. Elle a défié sur ce point non seulement les processus conscients des individus, mais aussi leurs principales habitudes inconscientes et socialement conditionnées. (Il est inutile de montrer longuement que les habitudes de l’autorité et de la hiérarchie sont instillées dans l’individu dès le tout début de la vie: dans le milieu familial, dans l’éducation de l’enfant chez lui et à l’école, dans l’organisation du travail, du loisir et de la vie quotidienne. Ce formatage de la structure du caractère par ce qui ressemble à des normes «archétypales» d’obéissance et de commandement constitue l’essence même de ce qu’on appelle la «socialisation» des jeunes.)
La mystique de l’«organisation» bureaucratique, celle des hiérarchies et des structures imposées, formalisées, pénètre les mouvements les plus radicaux dans les périodes non révolutionnaires. La remarquable disposition de la gauche à développer des tendances autoritaires et hiérarchiques révèle l’ancrage profond du mouvement radical dans la société dont il cherche expressément à se débarrasser. En ce sens, presque chaque organisation révolutionnaire est une source potentielle de contre-révolution. C’est seulement lorsque l’organisation révolutionnaire est «structurée» de telle manière qu’elle reflète les formes directes et décentralisées de la liberté initiée par la révolution, seulement lorsqu’elle encourage chez le révolutionnaire les modes de vie et de personnalité de la liberté, que ce potentiel contre-révolutionnaire peut être affaibli. Alors seulement il est possible que le mouvement révolutionnaire se dissolve dans la révolution pour disparaître dans ses nouvelles formes sociales directement démocratiques, comme un fil chirurgical dans une blessure cicatrisée.
La révolution en acte déchire tous les tendons qui maintiennent l’autorité et la hiérarchie dans l’ordre établi. L’entrée directe du peuple dans l’arène sociale est l’essence véritable de la révolution. La révolution est la forme la plus avancée d’action directe. Réciproquement, l’action directe en temps «normal» est une préparation indispensable à l’action révolutionnaire. Dans les deux cas, l’action sociale issue de la base se substitue à l’action politique située dans le cadre établi et hiérarchisé. Dans les deux cas, des changements moléculaires transforment les «masses», les classes et les couches sociales en individus révolutionnaires. Cette condition doit devenir permanente si l’on veut que la révolution réussisse – si l’on ne veut pas qu’elle se transforme en une contre-révolution masquée par l’idéologie révolutionnaire. Toute formule, toute organisation, tout programme expérimenté doit ouvrir la voie aux exigences de la révolution. Aucune théorie, aucun programme, aucun parti n’a de plus grande importance que la révolution elle-même.
Parmi les plus sérieux obstacles à l’insurrection de mai-juin se trouvaient non seulement de Gaulle et la police, mais aussi les organisations de gauche sclérosées, comme le Parti communiste qui asphyxiait les initiatives dans de nombreuses usines, et les groupes léninistes et trotskystes qui répandaient une si mauvaise odeur dans les assemblées générales de la Sorbonne. Je ne parle pas ici des nombreux individus qui s’identifiaient de façon romantique au Che, à Mao, à Lénine ou à Trotsky (et souvent aux quatre à la fois), mais à ceux qui ont abdiqué toute identité, initiative et volonté face à la discipline et à la hiérarchie des organisations. Même s’ils ont été bien intentionnés, leur tâche a été celle de «discipliner» la révolte, plus exactement de la dé-révolutionner en y intégrant les habitudes d’obéissance et d’autorité que leurs organisations avaient assimilées à partir de l’ordre établi. Ces habitudes, encouragées par la participation à des organisations fortement structurées – modelées en fait sur la société même à laquelle les «révolutionnaires» prétendaient s’opposer –, les ont menés aux manœuvres parlementaires, aux entrevues secrètes et aux tentatives de «contrôler» les formes révolutionnaires de la liberté créées par la révolution. Elles ont répandu dans l’assemblée de la Sorbonne le vent empoisonné de la manipulation. Beaucoup d’étudiants à qui j’en ai parlé étaient absolument convaincus que ces groupes étaient prêts à détruire l’assemblée de la Sorbonne s’ils ne parvenaient pas à la «contrôler». Ces groupes ne se préoccupaient pas de la vitalité des réalisations révolutionnaires, mais de la croissance de leurs propres organisations. L’assemblée, qui avait créé des formes authentiques de liberté dans lesquelles chacun pouvait exprimer librement son point de vue, aurait été parfaitement justifiée de bannir de son sein tous les groupes bureaucratiquement organisés.
Il reste pour toujours au crédit du Mouvement du 22 mars de s’être immergé dans les assemblées révolutionnaires et d’avoir virtuellement disparu en tant qu’organisation, sauf pour le nom. Dans ses propres assemblées, le Mouvement du 22 mars parvenait à toutes ses décisions par le «sens de l’assemblée», et il permettait à toutes les tendances en son sein de faire librement l’expérience de leurs positions dans la pratique. Une telle tolérance n’empêchait pas pour autant son «efficacité»: ce mouvement anarchique, de l’accord de presque tous les observateurs, a fait davantage pour catalyser la révolte que tout autre groupe étudiant. Ce qui distingue le Mouvement du 22 mars, et des groupes tels que les anarchistes et les situationnistes, de tous les autres, est qu’ils ne travaillaient pas pour la «prise du pouvoir», mais pour sa dissolution.
La dialectique de la révolution moderne
Les événements de mai et juin en France révèlent de manière saisissante et dramatique la remarquable dialectique de la révolution. La misère quotidienne d’une société est mise en lumière par les possibilités de réalisation du désir et de la liberté. Plus ces possibilités sont grandes, plus est intolérable la misère quotidienne. Pour cette raison, il importe peu que la société française ait été plus prospère ces dernières années qu’à n’importe quelle autre époque de son histoire. La prospérité, sous sa forme bourgeoise profondément faussée, indique seulement que les conditions matérielles de la liberté sont atteintes, que les possibilités techniques d’une vie nouvelle et libérée sont arrivées à maturité.
Il est évident maintenant que ces possibilités hantaient la société française depuis longtemps, même si la plupart des gens ne les percevaient pas. La consommation insensée de biens matériels illustre, à sa manière déformée, la tension entre la morne réalité de la société française et les possibilités libératrices de la révolution aujourd’hui, tout comme un régime abrutissant et une obésité excessive révèlent la tension dans un individu. Le moment arrive finalement où le régime consumériste devient sans saveur et l’obésité sociale insupportable. Le point de rupture est imprévisible. Dans le cas de la France, ce furent les barricades du 10 mai, ce jour qui secoua la conscience du pays entier et fit se poser la question aux ouvriers: «Si les étudiants, ces “fils de bourgeois”, peuvent le faire, pourquoi pas nous?» Il est clair qu’un processus moléculaire était en marche en France, totalement invisible même pour les révolutionnaires les plus conscients, un processus que les barricades ont précipité dans une action révolutionnaire. Après le 10 mai, la tension entre la médiocrité de la vie quotidienne et les possibilités d’une société libératrice a explosé dans la grève générale la plus massive de l’histoire.
L’étendue de la grève montre que presque toutes les couches de la société française étaient profondément mécontentes et que la révolution était ancrée non pas dans une classe particulière, mais en quiconque se sentait dépossédé, exclu, dépouillé de la vie. L’élan révolutionnaire venait d’une couche sociale qui, plus que tout autre, aurait dû «s’accommoder» de l’ordre existant: la jeunesse. Ce sont les jeunes qui ont été nourris de la pâtée de la «civilisation» gaulliste et qui n’ont pas vécu le contraste entre les aspects relativement attirants de la culture d’avant-guerre et la médiocrité de la culture actuelle. Mais cette pâtée n’a pas atteint son but. Son pouvoir de cooptation et d’absorption était finalement plus faible que ne le suspectaient la plupart des critiques de la société française. La société gavée de pâtée ne pouvait résister à la poussée vers la vie, en particulier chez les jeunes.
Il est tout aussi important de souligner que la vie des jeunes en France, comme en Amérique, n’avait pas été ravagée par les années de la Grande Dépression et par la quête de la sécurité matérielle qui a modelé la vie de leurs aînés. Ils prenaient la réalité actuelle de la vie française pour ce qu’elle était: médiocre, laide, égotique, hypocrite et spirituellement destructrice. Ce simple fait, la révolte de la jeunesse, est la preuve la plus accablante de l’incapacité du système à l’emporter sur son propre terrain.
La terrible décadence intérieure de la société gaulliste, décadence commencée bien avant la révolte, a pris des formes qui ne correspondent à aucune formule traditionnelle, économiquement orientée, de la «révolution». On a beaucoup écrit sur le «consumérisme» de la société française en tant que pollution de la stabilisation sociale. Le fait que les objets, les marchandises, aient remplacé les attachements subjectifs traditionnels, encouragés par l’église, l’école, les médias et la famille, aurait dû apparaître comme la preuve d’une décomposition sociale plus grave que celle qu’on supposait. Le fait que la conscience de classe traditionnelle soit en déclin dans la classe ouvrière aurait dû indiquer que les conditions étaient mûres pour une révolution sociale majoritaire, non pour une révolution de classe minoritaire. Le fait que les valeurs du «lumpen» en termes d’habillement, d’art et de modes de vie se soient répandues parmi les jeunes Français aurait dû faire voir que le potentiel de «désordre» et d’action directe se développait derrière une façade de protestation politique conventionnelle.
Par un remarquable retournement d’ironie dialectique, un processus de «désenbourgeoisement» était en marche au moment même où la France atteignait des records sans précédents de richesse matérielle. Quelle qu’ait pu être la popularité personnelle de de Gaulle, un processus de désinstitutionnalisation se produisait au moment même où le capitalisme d’État semblait plus ancré dans la structure sociale qu’il ne l’avait jamais été dans le passé. La tension entre la morne réalité et les possibilités libératrices se renforçait alors même que la société française semblait plus tranquille que jamais depuis les années 1920. Un processus d’aliénation s’amorçait au moment précis où les vérités de la société bourgeoise étaient plus assurées qu’à aucune autre époque de l’histoire de la république.
La raison en est que les questions qui créent l’agitation sociale avaient changé qualitativement. Les problèmes de survie, de rareté et de sacrifice avaient fait place à ceux de la vie, de l’abondance et du désir. Le «rêve français», comme le «rêve américain», s’érodait et se démystifiait. La société bourgeoise avait donné tout ce qu’elle pouvait, sur le seul terrain où elle était capable de donner quoi que ce soit: une pléthore de biens matériels médiocres obtenus au prix d’un travail absurde et abrutissant. L’expérience elle-même (et non les «partis d’avant-garde» ou les «programmes éprouvés») est devenue l’agent mobilisateur et la source de créativité du soulèvement de mai-juin. Et c’est ce qui devait se passer. Non seulement il est naturel qu’un soulèvement écl...