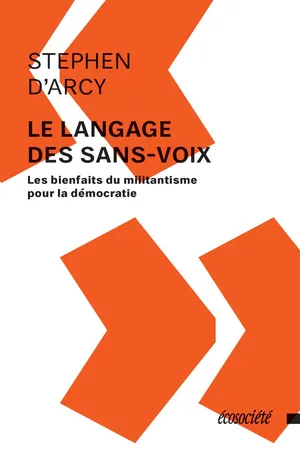![]()
DEUXIÈME PARTIE
Applications
![]()
CHAPITRE QUATRE
La désobéissance civile
EN PRATIQUE, la protestation militante est presque toujours illégale, parce que les autorités criminalisent la résistance aussitôt qu’elles commencent à en craindre l’efficacité. La désobéissance civile, toutefois, place le défi à l’autorité légale au centre de son action. Elle contrevient à la loi non pas en passant, en faisant autre chose, comme causer une perturbation ou endommager une propriété. En fait, elle défie directement la loi, et ce, dans le but de communiquer avec le public. Si ses adeptes voyaient leurs actions devenir légales du jour au lendemain, ils devraient s’arrêter et faire autre chose, l’illégalité étant un aspect crucial de ce que ces gens tentent d’accomplir.
Toutefois, la désobéissance civile est également la forme la moins controversée de protestation militante. Elle est particulièrement populaire auprès des philosophes politiques libéraux égalitaristes, comme John Rawls, Ronald Dworkin, et Jürgen Habermas, qui ont plutôt tendance à se méfier des autres styles de militantisme. Cela est dû, en partie du moins, au fait de l’association entre la désobéissance civile et une position stricte de nonviolence, qui, dans ce contexte, signifie l’exclusion de l’usage de la force physique. Des désaccords existent quant à savoir si ce style de manifestation doit être nonviolent par définition. Néanmoins, l’association «désobéissance civile/nonviolence» est bien établie puisque les deux plus importants adeptes de la désobéissance civile classique étaient des figures charismatiques et populaires, à savoir Mohandas Gandhi et Martin Luther King, qui accordaient tous deux une grande importance morale à la nonviolence, ou, comme le disait Gandhi, à l’ahimsa (littéralement, non-nuisance).
Les philosophes politiques libéraux sont aussi rassurés par la distance qui sépare, croient-ils, la désobéissance civile de la criminalité ordinaire ou du non-respect de la loi. La désobéissance civile est paradoxale: elle combine un défi ouvert de la loi et l’affirmation d’un respect sincère pour celle-ci. King soulignait ce point comme suit:
J’espère que vous pouvez voir la distinction que j’essaie de vous montrer. D’aucune façon je ne propose d’échapper à la loi (en général) ou de la défier, comme le ferait le ségrégationniste enragé. Cela mènerait à l’anarchie. Quelqu’un qui enfreint une loi injuste doit le faire ouvertement, avec amour… et doit être prêt à accepter la peine. Je soutiens qu’un individu qui enfreint une loi que sa conscience lui fait voir comme injuste, et qui accepte la peine en restant en prison pour conscientiser la communauté à l’injustice en cours, exprime en réalité le plus grand des respects pour la loi.
Cette combinaison particulière de défi envers des lois en particulier et de grand respect pour la loi en général différencie la désobéissance civile classique d’autres variétés de militantisme.
La chose même qui rassure les libéraux, toutefois, peut soulever des doutes chez les radicaux. La désobéissance civile ne serait-elle pas un peu trop respectueuse de la loi? Après tout, comme le soulignent des désobéissants comme Gandhi et King eux-mêmes, l’ordre légal sert souvent à instituer l’injustice ou à la protéger de l’opposition des protestataires. Les protestataires, pour la plupart, interagissent avec le système juridique sur un mode antagonique. Au moins depuis Marx, en fait, les radicaux ont souvent décrié l’existence de l’État comme un affront direct à l’autonomie du public. La désobéissance peut-elle en effet retirer du pouvoir aux gens en en cédant trop aux autorités par une forme de déférence inappropriée envers l’État?
Dans ce chapitre, j’explore le paradoxe de la désobéissance civile – son défi respectueux de la loi – et les problèmes éthiques qu’il soulève.
La marche du sel
L’exemple le plus célèbre de désobéissance civile à grande échelle est probablement la marche du sel, qui eut lieu en Inde en 1930, où de 60 000 à 90 000 personnes furent emprisonnées pour avoir défié la loi. Les lois concernant les taxes sur le sel, imposées à l’Inde par l’occupant britannique en 1882, assuraient un monopole britannique sur la production de sel en Inde. Ces lois empêchaient les Indiens et Indiennes les plus pauvres d’avoir accès au sel. Selon Gandhi, il y avait des raisons morales et stratégiques de cibler les taxes sur le sel. En tant que politique causant beaucoup de tort aux plus pauvres, et ce, au bénéfice exclusif d’occupants étrangers, cette taxe représentait une injustice grave et évidente. Puisqu’il s’agissait d’une source d’indignation pour des millions de personnes, et qu’elle fournissait un revenu non négligeable, elle pouvait constituer la base d’une opposition à grande échelle contre le régime et menacer les Britanniques à la fois matériellement, en s’en prenant à leur revenu, et symboliquement, en encourageant le défi de masse.
La marche du sel fut lancée quelques mois seulement après que le Congrès national indien eut déclaré l’indépendance – une déclaration rejetée par l’occupant britannique. Cela donna encore plus de poids à la contestation ouverte du régime britannique que représentait la marche.
Le plan était le suivant: Gandhi allait mener personnellement la marche jusqu’à la mer, où lui et des milliers de ses supporters allaient récolter du sel, contournant ainsi le monopole britannique, refusant de payer la taxe sur le sel et défiant ouvertement la loi qu’ils souhaitaient voir abolie. Gandhi et son groupe se mirent en route le 12 mars 1930, quittant son ashram près d’Ahmedabad pour se rendre jusqu’au village côtier de Dandi, une marche qui dura près de trois semaines et demie. Des milliers de personnes se joignirent à la marche, alors que des centaines de milliers, voire peut-être des millions d’autres, prirent part à la campagne de résistance aux lois sur le sel lancée par la marche. Le plan de Gandhi était de marcher le long de la côte, en encourageant d’autres personnes à joindre la campagne, jusqu’à ce que les Britanniques procèdent à son arrestation. Il avait l’intention de placer les Britanniques devant un dilemme:
Pour les autorités britanniques, chaque tournure possible des événements allait jouer un rôle dans la mise en scène de Gandhi. Si elles procédaient à l’arrestation des contrevenants à la loi sur le sel, elles créeraient des martyrs pour le mouvement nationaliste et confirmeraient les affirmations de Gandhi dénonçant leur intention d’opprimer. Si elles laissaient aller les choses, elles risquaient d’alimenter les doutes quant à leur propre volonté de forcer la résistance indienne à respecter les lois britanniques. D’une manière ou d’une autre, elles avaient quelque chose à perdre.
Après quelques semaines d’hésitation, les Britanniques décidèrent d’arrêter Gandhi. Mais d’autres figures bien en vue du mouvement prirent la relève, et la marche continua. Il y eut ensuite plusieurs arrestations de masse, souvent brutales et violentes. Dans un cas parmi d’autres, «lorsque la police montée arriva, les leaders ordonnèrent aux protestataires de se coucher au sol, et la police à pied se mit à les traîner par terre de force. Lorsque certaines personnes résistèrent, la police se mit à distribuer les coups de lathi [bâton] sur les marcheurs et marcheuses ainsi que sur des personnes qui observaient la scène. Plus d’une centaine de personnes furent blessées, dont plusieurs sérieusement, et le Congrès [national indien] affirma quant à lui qu’il y avait eu des morts».
De leur côté, les protestataires dévièrent quelques fois du modèle de désobéissance civile privilégié par Gandhi. Lors d’un incident où les autorités britanniques interdirent une marche locale initiée par le Congrès, «près de 400 policiers et soldats prirent d’assaut son quartier général, vidèrent les rues et abaissèrent le drapeau du Congrès. Les leaders annulèrent ensuite la marche». Plus tard, «des habitants en colère se mirent à poursuivre les policiers jusqu’à leur caserne […] lançant des briques, des pierres et des bouteilles, et finalement en appelant à mettre le feu au poste de police. Après environ une demi-heure, la police ouvrit le feu», et quatre protestataires furent tués.
Néanmoins, la majeure partie de la campagne de la marche du sel respecta les normes de ce que nous considérons maintenant comme de la désobéissance civile classique, en posant des défis nonviolents à grande échelle. De mars à mai 1930, entre «60 000 et 90 000 Indiens et Indiennes furent arrêtés, au moins cent furent tués par la police, et des milliers d’autres furent blessés».
Ultimement, les Britanniques ne reculèrent pas et la taxe ne fut pas abolie. Ils négocièrent néanmoins des concessions après la marche, notamment sous la forme de ce qu’on appelle «le pacte Gandhi-Irwin, qui permit aux gens de récolter du sel pour leur usage domestique». Tout compte fait, le point le plus important réside peut-être dans le fait que la marche du sel a constitué un tournant qui fit monter la pression contre les Britanniques, menaçant leur mainmise sur le pouvoir et affaiblissant leur légitimité déjà chancelante.
Plusieurs éléments clés de la désobéissance civile se retrouvent dans la marche du sel. Ceux et celles qui désobéissent défient la loi ou les autorités légales pour protester contre l’injustice; cet acte de défi symbolique est utilisé comme un moyen de communiquer avec le public, d’en appeler à leur sens de la justice ou de l’équité; il n’y a pas de recours à la force armée ou à d’autres types d’affrontement physique; et, finalement, il y a acceptation des peines qui découlent du non-respect de la loi, sans résistance aux arrestations ou tentative d’éviter les peines.
Comme le résume Rawls, la désobéissance civile «exprime la désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi. […] La loi est enfreinte, mais la fidélité à la loi est exprimée par la nature publique et nonviolente de l’acte, par le fait qu’on est prêt à accepter les conséquences légales de sa conduite».
L’obligation d’obéir à la loi
Avec le recul, plusieurs analystes, d’allégeance libérale ou conservatrice, sont plutôt sympathiques à la marche du sel et à d’autres cas historiques de désobéissance civile, comme le refus de Rosa Parks d’aller s’asseoir à l’arrière de l’autobus. Des plaques et des monuments ont été inaugurés pour commémorer ces événements. Ces mêmes analystes et les autorités publiques, par contre, n’accordent pas le même type de déférence aux gens qui pratiquent la désobéissance civile aujourd’hui.
En 2012, à l’Université Western de London, en Ontario, l’administration de l’université a réagi à une vigile silencieuse et nonviolente en bannissant deux des participants du terrain de l’université pour douze mois. Les deux manifestants, des journalistes de la station de radio du campus, s’étaient joints à un groupe de défense des droits humains du peuple palestinien qui se tenait là, manifestant dans le calme, la bouche recouverte de ruban adhésif. En réponse à la condamnation de l’Association canadienne des libertés civiles, l’université a défendu les sanctions en faisant valoir que les manifestants avaient «participé à une activité interdite», puisque la vigile avait été organisée sans l’obtention d’une permission au préalable. Autre cas semblable: lorsque l’environnementaliste Tim DeChristopher tenta, en 2008, de protester contre la vente de terres publiques pour l’exploitation de pétrole et de gaz en misant aux enchères sur 116 terrains dans l’Utah, sans aucune intention ou capacité de payer les 1,8 million de dollars pour le prix des terrains, il fut arrêté pour cet acte de désobéissance illégal, mais nonviolent. Il fut ensuite condamné à deux ans d’emprisonnement et reçut une amende de dix mille dollars, que le juge justifia en disant que la «désobéissance civile» ne saurait «être à l’ordre du jour». Ces réponses punitives sont aux antipodes de la célébration rétroactive de la désobéissance civile des générations précédentes.
Pourquoi ceux et celles qui pratiquent la désobéissance civile aujourd’hui sont-ils arrêtés, bannis, ou emprisonnés, au lieu d’être traités en héros? Pure hypocrisie? Ceux et celles qui jugent bon de punir les gens qui pratiquent la désobéissance civile, comme le constitutionnaliste conservateur Herbert Storing, affirment que les citoyens et citoyennes ont une obligation morale de se conformer à la loi, même si, personnellement, ils et elles estiment qu’elle n’est pas juste sur certains plans. Cette conception est répandue depuis au moins le Criton de Platon, où elle est justifiée de plusieurs manières, par exemple cette idée de la dette de gratitude que les citoyens et citoyennes ont envers l’État pour les bienfaits qui leur sont conférés, notamment l’ordre et la sécurité. Contrevenir à la loi et encourager les autres à faire de même, disent les critiques conservatrices, est un manquement au devoir de se conformer, et équivaut à se placer au-dessus de la loi, par le fait même au-dessus des autres citoyens et citoyennes.
Toutefois, le seul fait de penser aux lois et aux politiques, comme l’esclavage par exemple, qui seraient encore en place aujourd’hui si les mouvements sociaux pour la justice n’avaient pas depuis toutes ces années pratiqué la contestation juridique et les manifestations illégales, a de quoi faire frémir d’horreur. L’insistance des conservateurs sur le plus strict respect des lois semble presque calculée pour éviter toute opposition à une injustice qui soit digne de ce nom. Néanmoins, il vaut la peine d’articuler un argument raisonné et convaincant pour réfuter le conformisme légaliste. Pourquoi, exactement, devrait-on rejeter l’idée que tout le monde doit obéir à la loi simplement parce que c’est la loi?
Dans sa «Lettre de la geôle de Birmingham», le texte où King articule le plus en détail la base morale et politique de son appui à la désobéissance civile, il ne se plaint pas d’avoir été faussement accusé. Il affirme soutenir, plutôt que contrevenir, à la loi. La contradiction n’est qu’apparente, puisque King donne un sens double au mot «loi»: il y a, d’une part, la loi humaine et, de l’autre, la loi naturelle. Il peut s’avérer nécessaire en certaines occasions d’enfreindre des lois humaines pour respecter la loi naturelle. Dans sa lettre, King cite un argument important et influent qu’il tire de saint Augustin, mais qui remonte au moins jusqu’à Platon. Une loi injuste, selon cet argument, n’est tout simplement pas une loi, lorsque le mot «loi» ne signifie pas seulement des législations, mais aussi des verdicts judiciaires, des ordonnances du tribunal, des ordres donnés par des policiers et policières, etc. Selon la conception de la loi naturelle de King, enfreindre une loi injuste n’est à proprement parler aucunement contraire à la loi, puisque, lorsque la loi humaine est injuste ou protège l’injustice, elle ne remplit pas tous les critères (naturels) de validité. Dans Les lois, Platon nous donne une première articulation de cette affirmation: «ce ne sont pas là […] des lois véritables si elles n’ont pas été établies pour la communauté entière de l’État.»
La désobéissance civile défie presque toujours soit des lois qui sont elles-mêmes injustes (comme celles qui instituent la ségrégation raciale), soit des lois qui protègent d’autres lois injustes (comme les injonctions interdisant les manifestations). Enfreindre ces lois équivaut simplement à s’opposer à des lois invalides. La personne qui désobéit soutient en fait une loi plus élevée, que King considérait comme la loi naturelle, ou, selon lui, la «loi de Dieu».
Les gens qui désobéissent sont donc loin de se considérer au-dessus des lois; selon King, ce sont plutôt les autorités au sein même du système judiciaire, y compris les juges, les chefs de police et les geôliers, qui se rendent coupables de comportements peu respectueux de la loi. Bien que la désobéissance civile défie l’autorité de facto et la force brute de l’ordre en place, elle le fait au nom même de l’autorité morale de la loi. ...