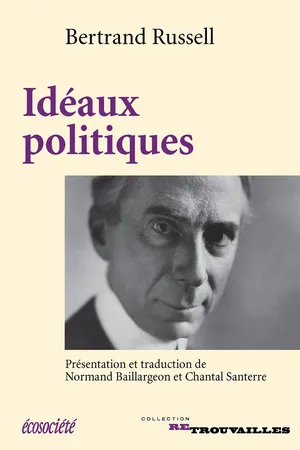![]()
CHAPITRE 4
Liberté individuelle et ordre public
I
La société ne peut exister sans loi et sans ordre, mais elle ne peut non plus avancer sans les innovations apportées par d’audacieux visionnaires. Cependant, la loi et l’ordre tolèrent mal les changements et les innovateurs, qui sont toujours, dans une certaine mesure, des anarchistes. Les personnes qui craignent un retour à la barbarie tendront à insister sur l’importance de la loi et de l’ordre, tandis que celles en qui domine l’espérance d’une avancée vers l’avènement de la civilisation tendront à être plus sensibles à la nécessité des innovations. Ces deux tempéraments sont nécessaires et complémentaires, et la sagesse nous demande de permettre à chacun d’eux de s’exprimer librement partout où leurs apports peuvent être bénéfiques. Mais les partisans de la loi et de l’ordre, ayant pour eux la force de la tradition et cet instinct qui nous pousse à maintenir le statu quo, n’ont guère besoin que l’on déploie des arguments en leur faveur. Ce sont les innovateurs qui ont du mal à exister et à travailler. Chaque nouvelle génération a tendance à croire que ce problème est chose du passé; mais chaque génération, précisément, n’est tolérante qu’envers les innovations passées. De sorte que les innovations du jour rencontrent les mêmes obstacles et les mêmes persécutions que celles d’hier, et tout se passe comme si on n’avait jamais entendu parler du principe de tolérance.
Westermarck a pu écrire: «Dans les sociétés primitives, les coutumes ne sont pas seulement des règles morales: ce sont les seules règles morales qui soient. Le primitif se conforme entièrement à cette injonction hégélienne qui demande de n’avoir aucune conscience privée. En voici un parfait exemple – on parle ici des Shanars de Tinnevelly: “Individuellement, on adopte rarement parmi eux de nouvelles opinions ou de nouvelles manières de faire, ils suivent la multitude pour faire le mal et ils suivent la multitude pour faire le bien. Ils pensent et agissent comme un troupeau.”»
Ceux et celles parmi nous qui n’ont jamais eu de pensée la moindrement différente de celle de leurs voisins, qui n’ont jamais fait quoi que ce soit de différent, ces personnes seront enclines à se féliciter de tout ce qui nous sépare de ces primitifs. Mais les autres, ceux qui ont réellement tenté de changer des choses, ne pourront s’empêcher de conclure que les gens qu’ils connaissent ne sont pas très différents des Shanars de Tinnevelly.
Au cours des dernières années, et sous l’influence du socialisme, une certaine hostilité envers la liberté individuelle s’est manifestée, même dans les cercles progressistes. Dans l’esprit des réformateurs, la liberté est associée au laissez-faire, à la Manchester School et à l’exploitation des femmes et des enfants causée par la supposée «libre concurrence». Toutes ces choses étaient condamnables et demandaient l’intervention de l’État; et de fait, il faut accroître l’intervention de l’État là où de semblables maux persistent. Pour tout ce qui a trait à la vie économique de la communauté, en ce qui concerne les conditions de la production et de la distribution des marchandises, il nous faut non pas moins, mais plus de contrôle public – j’ignore cependant quelle est la quantité supplémentaire de contrôle qui est souhaitable.
Il y a encore un autre domaine où il est pressant de substituer la loi et l’ordre au désordre existant, et c’est celui des relations internationales. En ce moment, chaque État souverain dispose d’une entière et totale liberté que seule la guerre peut éventuellement limiter. Si on souhaite mettre fin à la guerre, il faudra limiter cette liberté.
Mais dès que l’on quitte la sphère des possessions matérielles, on constate que les arguments que l’on pouvait avancer en faveur d’un contrôle public perdent presque toute pertinence.
Considérons la religion pour commencer. On admet généralement que c’est un domaine où l’État ne devrait pas intervenir. Qu’une personne soit de confession chrétienne, musulmane ou juive n’est aucunement d’intérêt public, tant et aussi longtemps qu’elle obéit aux lois; et les lois devraient être telles que les adeptes de toutes les religions puissent s’y conformer. Mais même ici des limites s’imposent. Aucun État civilisé ne pourrait tolérer une religion qui préconise des sacrifices humains. En Inde, les Anglais ont interdit le sati, en dépit de leur principe de non-intervention dans les coutumes religieuses autochtones. Et même si on est tenté de soutenir qu’ils ont eu tort d’interdire cette pratique, n’importe quel Européen aurait fait de même. Malgré tous les arguments théoriques que l’on peut avancer en faveur de la liberté religieuse, on ne peut véritablement douter du fait que de telles pratiques devaient être interdites.
Dans des cas comme celui-là, c’est une nation plus civilisée qui impose de l’extérieur une limitation à la liberté. Mais le cas le plus fréquent et aussi le plus intéressant est celui où un État indépendant intervient au nom de la coutume contre des individus qui s’acheminent vers des croyances et des institutions plus civilisées. Westermarck écrit encore: «Dans la Nouvelle-Galles du Sud, le premier né de chaque lubra était dévoré par la tribu lors d’une cérémonie religieuse. En Chine, dans le royaume de Khai-muh, selon un récit autochtone, il était d’usage de tuer et manger le fils aîné. Chez certaines tribus de Colombie-Britannique, le premier né est souvent sacrifié au Soleil. Selon Le Moyne de Morgues, chez les Indiens de Floride, on sacrifiait au chef le premier-né.»
Des exemples comme ceux-là remplissent des pages et des pages.
Il n’y a rien de semblable à tout cela chez nous. Lorsqu’on a annoncé à un premier-né en Floride que son roi et son pays avaient besoin de lui c’était par pure erreur; et quant à nous, nous ne commettons jamais d’erreur de ce genre. Mais il est quand même intéressant de se demander comment meurent de telles superstitions là où, comme dans l’exemple du royaume de Khai-muh, une influence externe est improbable. On peut supposer que certains parents motivés par une très égoïste affection parentale se sont peu à peu mis à douter que le Soleil serait véritablement en colère si on permettait à leurs aînés de vivre. Cette manifestation de rationalité aurait semblé aux autres quelque chose de très dangereux puisque cela causerait du tort aux récoltes. Une telle idée serait donc secrètement entretenue par des illuminés, qui n’oseraient jamais passer aux actes. Et puis, quelques parents sauveraient leur enfant de leur cruel destin, soit en les cachant, soit en s’exilant. On dirait d’eux qu’ils manquaient de sens civique et qu’ils étaient disposés à mettre la communauté en danger pour leur bonheur personnel. Mais peu à peu, on se rendrait compte que l’État n’était pas menacé et que les récoltes n’étaient pas moins bonnes. Et puis un jour, on inventerait quelque histoire selon laquelle un enfant serait tenu pour avoir été sacrifié si on l’avait solennellement dédié à l’agriculture ou à quelque autre cause d’importance nationale choisie par le chef. Il faudrait attendre encore plusieurs générations pour qu’il soit enfin permis à cet enfant devenu grand de choisir une occupation selon ses goûts et ses capacités. Et durant tout ce temps, on rappellerait aux enfants que c’est par faveur qu’on leur a permis de vivre, et leur vie tout entière serait menée dans l’ombre d’un devoir totalement imaginaire à rendre à l’État.
Le cas de ces parents, qui sont les premiers à ne pas croire que le sacrifice de leur enfant serait d’une quelconque utilité, illustre bien toutes les difficultés qui surgissent lorsque l’on s’efforce de concilier liberté individuelle et contrôle public. Parce qu’elles croient que les sacrifices sont nécessaires au bien de la communauté, les autorités en place insisteront pour en maintenir la pratique; les parents, de leur côté persuadés qu’ils sont inutiles, seront tentés de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leur enfant. Comment les deux parties devraient-elles agir dans un cas comme celui-là?
Le devoir d’un parent sceptique est évident: c’est de sauver l’enfant par tous les moyens possibles, de rappeler sans cesse l’inutilité de ces sacrifices et de subir patiemment les sanctions que la loi pourra lui imposer. Le devoir des autorités est cependant bien moins clair. Tant et aussi longtemps qu’elles demeurent fermement convaincues que le sacrifice du premier-né est indispensable, elles persécuteront quiconque cherchera à miner cette croyance. Mais si elles sont consciencieuses, elles examineront soigneusement les arguments de leurs opposants et admettront d’emblée qu’ils pourraient être valides. Elles se demanderont en outre, très honnêtement, s’il entre ou non une part de cruauté ou de haine des enfants dans leur croyance. Elles se rappelleront également que dans l’histoire du Khai-muh, il est arrivé d’innombrables fois où on a tué des gens qui étaient en désaccord avec le point de vue dominant et que l’on sait désormais que ces croyances étaient fausses. Enfin, elles se diront qu’alors que les croyances traditionnelles qui se sont avérées erronées sont souvent très répandues, les nouvelles croyances s’imposent rarement à moins d’être plus près de la vérité que celles qu’elles remplacent. De tout cela, elles concluront qu’une nouvelle croyance est probablement soit en avance sur son temps, soit si inoffensive et anodine qu’il y a peu de chances qu’elle se répande. Tout cela devrait les inciter à hésiter avant de recourir aux sanctions.
II
L’étude de l’histoire et l’examen des peuples primitifs montrent bien que les croyances traditionnelles des tribus et des nations sont presque toujours fausses. Il nous est difficile de nous couper complètement des croyances de notre époque et de notre culture; mais il n’est pas très difficile de maintenir à leur propos un certain scepticisme. Si toutes ses croyances étaient fondées, l’Inquisiteur qui brûlait des hommes sur le bucher agissait avec humanité; mais s’il était le moindrement dans l’erreur, il se montrait alors d’une grande et injustifiable cruauté. Dans des cas comme celui-là, une bonne règle pratique à suivre est celle-ci: n’ayez pas une confiance à ce point aveugle dans les croyances traditionnelles qu’elles devraient vous amener à poser des gestes aux effets désastreux si ces croyances ne se révélaient pas entièrement vraies. À moins de pouvoir proclamer Britannia rules the waves, l’Anglais moyen est persuadé que le monde sera dans un piteux état; l’Allemand moyen, de son côté, est persuadé que la phrase Deutschland über alles a exactement le même effet. Pour défendre ces croyances, l’un et l’autre sont disposés à détruire la civilisation européenne. Dans l’éventualité où ces croyances se révéleraient fausses, ce qui s’ensuit serait déplorable.
Une conclusion que l’on doit tirer de ce qui précède est qu’on ne devrait empêcher personne, et d’aucune façon, d’avoir des idées, d’exercer sa pensée et encore moins d’énoncer des faits. Un tel principe était un lieu commun parmi les penseurs libéraux; il n’a cependant jamais été entièrement mis en pratique dans les pays civilisés. Tout récemment, partout en Europe, il est devenu un dangereux paradoxe en vertu duquel de nombreuses personnes ont souffert ou ont été emprisonnées. Pour cette raison, il est nécessaire de le rappeler. Les raisons qui le justifient sont à ce point évidentes que j’aurais honte de les rappeler, si elles n’étaient à ce point méconnues. Mais dans le monde tel qu’il va, il est nécessaire de les rappeler.
De simples mortels ne peuvent prétendre parvenir à la vérité pleine et entière, mais il leur est permis de s’en approcher par des approximations successives. Sur tout sujet d’intérêt général, dans quelque communauté que ce soit, il existe à tout moment une opinion reçue, laquelle est acceptée comme allant de soi par tous ceux et celles qui ne se sont pas particulièrement penchés sur la question. Remettre en question cette opinion reçue suscite l’hostilité, et ce, pour plusieurs raisons.
La plus importante d’entre elles est cet instinct conformiste que l’on retrouve chez tous les animaux grégaires et qui les conduit souvent à tuer tout membre de la tribu qui leur semble trop différent.
La deuxième raison en importance tient au fait que de mettre en doute les croyances qui régulent nos vies génère de l’insécurité. Quiconque s’est risqué à essayer d’expliquer la philosophie de Berkeley à un individu lambda aura aussitôt aperçu dans sa forme la plus pure la colère que suscite ce sentiment. Ce qu’il conclut de la philosophie de Berkeley lorsqu’on la lui expose pour la première fois, c’est la désagréable présomption que rien n’est solide et qu’il est donc risqué de s’asseoir sur une chaise ou de s’attendre à ce que le plancher nous supporte. Cette idée est si inconfortable qu’elle nous indispose, à moins d’être de ceux qui tiennent pour insensés les propos de Berkeley. Et c’est un peu l’effet que produit la remise en question de ce que l’on tenait pour acquis: cela ébranle jusqu’à la tranquille certitude que nous avions d’être en terrain solide et suscite en nous une peur qui nous déconcerte.
Une troisième raison pour laquelle les êtres humains n’aiment guère les idées nouvelles tient au fait que des intérêts partisans sont intimement liés aux anciennes croyances. C’est entre autres pour cela que l’Église a mené son long combat contre la science, de Giordano Bruno à Darwin. Les échecs du socialisme d’autrefois lui sont entièrement attribuables. Mais ce serait une erreur de penser, comme ceux qui cherchent partout et toujours à tout expliquer par l’économie, que c’est là la cause principale de cette hargne envers les innovations dans le domaine des idées. Si c’était le cas, le progrès intellectuel serait bien plus rapide qu’il ne l’est en réalité.
Les trois facteurs que nous avons présentés contribuent tous ensemble à rendre difficile l’acceptation de nouvelles idées. Et il est d’ailleurs bien plus difficile d’avoir une telle idée que de la faire accepter: la plupart des gens pourraient passer leur vie entière à chercher une idée nouvelle sans jamais en trouver une seule.
Compte tenu de ces obstacles, il est peu probable qu’une société, quelle qu’elle soit, génère un grand nombre d’opinions hérétiques. Et ce l’est encore moins dans une société moderne, là où les conditions de vie changent rapidement et exigent de nous que nous nous y adaptions. On devrait donc encourager et non pas décourager l’expression d’idées nouvelles et la diffusion des savoirs sur lesquels elles reposent. Mais c’est en fait le contraire qui se produit. Dès l’enfance, tout est mis en œuvre pour rendre stériles et conformistes les cerveaux des hommes et des femmes. Et si malgré tout et par malheur il y subsiste une étincelle d’imagination, son infortuné propriétaire est montré du doigt comme un être dangereux dont on doit se méfier, qui ne mérite que mépris en temps de paix et la prison ou la mise à mort comme traître en temps de guerre. Et pourtant l’expérience nous apprend que ce sont ces personnes qui ont le plus apporté à l’humanité, et ce sont souvent elles que l’on célèbre aussitôt qu’elles sont mortes et devenues ainsi inoffensives.
Il ne saurait, ni ne devrait, y avoir de contrôle public sur la pensée et les opinions. Pour ceux et celles qui savent ce qui a été pensé et cru, ce domaine devrait être aussi libre et spontané qu’il est possible de l’être. L’État a le droit d’exiger que les enfants soient éduqués; mais il n’a pas celui de demander que leur éducation se fasse de manière à ce point uniforme qu’elle produit immanquablement des êtres d’un désolant conformisme. Ce dont la vie de l’esprit en général et l’éducation en particulier ont surtout besoin, c’est l’initiative personnelle. Le rôle de l’État devrait être d’exiger qu’on offre aux enfants une éducation – et si possible, une éducation qui produise des esprits indépendants et pas des esprits qui adhèrent aux positions adoptées par le gouvernement. Et ce rôle devrait s’arrêter là.
III
Les questions de morale pratique soulèvent des problèmes plus difficiles encore que ceux relatifs à l’expression d’opinions. Le criminel est sincèrement persuadé qu’il est de son devoir de commettre des meurtres, mais le gouvernement est en désaccord avec lui. L’objecteur de conscience soutient le point de vue opposé, mais cette fois encore le gouvernement est en désaccord avec lui. Tuer est une prérogative de l’État. Il est aussi criminel de le faire lorsque celui-ci ne l’exige pas que de refuser de le faire lorsqu’il l’exige. Il en va de même pour le vol, autorisé si c’est à grande échelle ou si celui qui le commet est déjà riche. Les criminels et les voleurs ont recours à la force dans leurs relations avec leurs semblables, et on devrait pouvoir convenir qu’en général utiliser privément la force devrait être interdit, sauf en de très rares exceptions et même là où des raisons de conscience sont invoquées. Mais un tel principe ne suffira pas à justifier qu’on impose à des gens d’avoir recours à la force parce que l’État l’ordonne, dans tous les cas où ils ne sont pas convaincus de la justification qu’on leur donne. De ce point de vue, punir les objecteurs de conscience apparaît clairement comme outrepassant les limites légitimes de la liberté individuelle.
On admet généralement sans se poser de questions que l’État a le droit de punir certaines pratiques sexuelles particulières. Personne ne doute que les Mormons croient sincèrement que la polygamie est une pratique souhaitable; et pourtant les États-Unis ont exigé l’abandon de sa reconnaissance légale, et il est probable que tout autre pays chrétien eût fait de même. Pourtant, je ne pense pas que cette interdiction soit sage. La polygamie est légale en de nombreux endroits de par le monde, mais elle n’est guère pratiquée, si ce n’est par des chefs et des potentats. Si les Européens ont raison de croire, comme c’est généralement le cas, que cette coutume est indésirable, il est probable que les Mormons l’auront bientôt abandonnée sauf peut-être dans quelques cas exceptionnels. Mais si, d’un autre côté, l’expérience s’avérait une réussite, le monde disposerait grâce à elle d’un savoir qui lui avait jusque-là échappé. Je pense que dans tous les cas semblables la loi ne devrait intervenir que là où un tort est infligé à une personne sans son consentement.
À l’évidence, les hommes et les femmes ne toléreraient pas que l’État choisisse pour eux leurs maris et leurs épouses, quoi qu’en disent les eugénistes. À ce propos, on a toutes les raisons de penser que l’opinion publique ne se trompe pas, pas tant parce que les gens sont sages, mais parce qu’un choix fait librement est toujours préférable à un mariage forcé. Ce qui vaut pour le mariage devrait valoir aussi pour le choix d’un métier ou d’une profession. S’il est vrai qu’en ces matières certaines personnes n’affichent aucune préférence marquée, la plupart des gens préfèrent de beaucoup certains métiers à d’autres et seront certainement des citoyens plus utiles en suivant leurs préférences qu’en étant contraints à une occupation par une autorité publique.
Le cas de la personne qui est profondément convaincue de ne devoir faire qu’un type particulier de travail est sans doute plus rare; mais il n’est pas à négliger, parce que c’est parfois le cas de personnes de grande importance. Jeanne d’Arc et Florence Nightingale ont défié les conventions sociales en étant fidèles à un sentiment de ce genre qui les ...