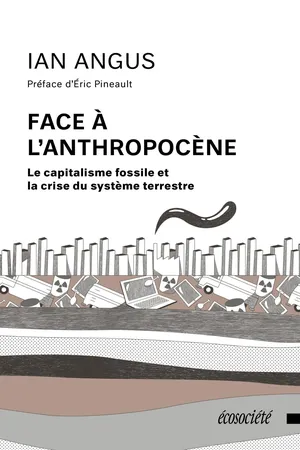![]()
DEUXIÈME PARTIE
Le capitalisme fossile
EN AVRIL 1856, dans un discours livré à des ouvriers lors d’une fête du journal des chartistes londoniens, Karl Marx décrit une contradiction profonde du développement capitaliste:
D’un côté, ce siècle a vu naître des forces industrielles et scientifiques qu’on n’aurait pas même pu imaginer à une époque antérieure. D’autre part, les signes se multiplient d’une déchéance telle qu’elle éclipsera même la fameuse décadence des dernières années de l’Empire romain. […] Cet antagonisme entre la science et l’industrie modernes d’une part, la misère et la décadence modernes de l’autre, cette contradiction entre les forces productives et les conditions sociales de notre époque est un fait, un fait patent, indéniable, écrasant.
À une autre occasion, Marx comparera le progrès sous le capitalisme à «cette hideuse idole païenne qui ne voulait boire le nectar que dans le crâne des victimes». Le thème de l’incapacité du capitalisme à créer sans détruire traverse toute l’œuvre du philosophe allemand, mais celui-ci n’aurait jamais pu imaginer l’ampleur que viendrait à prendre cette contradiction.
À l’ère capitaliste, la condition humaine s’est considérablement améliorée – la santé, la culture, la philosophie, la littérature, la musique et de nombreux autres domaines ont fait des progrès impressionnants. En revanche, le capitalisme a aussi semé la faim, la misère, la violence de masse, la torture et une foule d’autres maux, le tout à une échelle sans précédent. À mesure qu’il prenait de l’expansion et gagnait en maturité, sa dimension barbare devenait plus manifeste. En toutes circonstances, les puissantes forces productives dont il entraîne le déploiement sont aussi d’implacables forces de destruction.
Pendant 200 ans, le capitalisme et les combustibles fossiles ont contribué de façon spectaculaire à l’enrichissement et à la santé des humains. Aujourd’hui, ils sont en voie d’enrayer les processus biogéochimiques qui ont fait de la Terre un milieu propice au développement de l’humanité et de la civilisation pendant 10 000 ans. Ils nous précipitent dans une époque géologique nouvelle et menaçante, l’Anthropocène.
* * *
Les graphiques du chapitre 2 sur la grande accélération rendent compte de 12 tendances critiques du système terrestre de 1750 à nos jours. En soi ou en tant que mesure indirecte, chaque courbe se rapporte à une composante essentielle du système qui, au cours des 11 700 années de l’Holocène, s’est maintenue dans des limites strictes. Dans leur mise à jour de 2015, Will Steffen et ses collègues écrivent que, dans le cas de 9 des 12 composantes, «les données probantes montrent que les paramètres ont largement dépassé la plage de variation de l’Holocène»:
1, 2 et 3. Les concentrations atmosphériques de trois gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, protoxyde d’azote et méthane) sont nettement supérieures aux maximums propres à tout moment de l’Holocène.
4. Aucune donnée ne fait état d’une diminution importante de l’ozone stratosphérique pendant l’ensemble de l’Holocène.
5. Pour tout l’Holocène, aucune donnée n’indique que l’impact humain sur les écosystèmes marins, évalué en fonction du tonnage mondial de poissons pêchés, ait atteint une ampleur comparable à celle de la fin du XXe siècle.
6. Le cycle de l’azote a connu d’importantes transformations au XXe siècle; il se situe désormais bien au-delà de sa plage de variation durant l’Holocène.
7. Les océans semblent s’acidifier plus vite qu’à tout autre moment des 300 derniers millions d’années.
8. Le taux de perte de biodiversité s’approche de celui des grandes extinctions de masse.
9. De 1901 à 2012, la température moyenne de surface a augmenté de 0,9 °C environ. Il y a 6 000 à 8 000 ans, la température moyenne mondiale était d’environ 0,7 °C supérieure à celle de l’ère préindustrielle, ce qui semble indiquer que le climat mondial contemporain ne se situe plus dans la plage de variation de l’Holocène.
Les humains ont toujours transformé le monde, mais l’Anthropocène est un phénomène inédit. Les auteurs de la mise à jour soulignent que les changements passés, quelles qu’aient été leur ampleur et leur destructivité, n’ont jamais entraîné de «modifications importantes de la structure ou du fonctionnement du système terrestre dans son ensemble».
Ce n’est que pour la période qui commence au milieu du XXe siècle que des données probantes révèlent des modifications fondamentales de l’état et du fonctionnement du système terrestre qui (1) se situent à l’extérieur de la plage de variation de l’Holocène et (2) sont attribuables à l’activité humaine plutôt qu’à la variabilité naturelle.
«Le monde a atteint un stade où de nombreux indicateurs biophysiques ont dépassé les limites de variabilité de l’Holocène», concluent Steffen et ses collègues. Il est indéniable que le climat mondial se situe désormais à l’extérieur de la plage de variation de l’Holocène. Nous sommes en territoire inconnu, un territoire désigné sous le nom d’Anthropocène.
Dans la première partie, nous nous sommes penchés sur l’Anthropocène en tant que phénomène biophysique, c’est-à-dire en tant que transformation qualitative des caractéristiques physiques les plus fondamentales du système terrestre, laquelle a des conséquences profondes sur tous les êtres vivants, y compris les humains. Cette dimension est importante, mais, pour bien comprendre l’Anthropocène, il fait aussi l’analyser en tant que phénomène socioécologique, c’est-à-dire en tant que transformation qualitative de la relation des sociétés humaines avec le reste du monde naturel. Celle-ci découle directement, pour reprendre les mots de Marx, d’«une rupture irrémédiable dans le métabolisme [social] déterminé par les lois de la vie».
Dans cette deuxième partie, nous nous demandons pourquoi et comment 200 ans de développement capitaliste ont pu mettre fin à l’Holocène et «placer le système terrestre sur une trajectoire qui le rend plus hostile et qu’on peut difficilement corriger».
La recherche sur les origines sociales et économiques de l’Anthropocène est très différente de celle qui porte sur ses aspects géophysiques. Par sa nature même, la géologie cherche des preuves de transitions physiques dans la roche, les sédiments et la glace; elle peut ensuite y planter un «clou d’or» (un pieu en laiton, en fait), marqueur stratigraphique du passage d’une époque à une autre. Les sciences sociales ne sauraient se targuer d’une telle précision. Dans son fameux essai sur l’essor de l’impérialisme, Lénine écrivait: «Inutile de dire, évidemment, que toutes les limites sont, dans la nature et dans la société, conventionnelles et mobiles; qu’il serait absurde de discuter, par exemple, la question de savoir dans quelle année ou décade se place l’instauration “définitive” de l’impérialisme.»
Les transformations propres à la grande accélération n’ont pas été causées par un événement unique telle la collision avec une comète; elles marquent plutôt l’aboutissement de deux siècles de développement capitaliste. Alors que la géologie cherche à déterminer la décennie ou la journée précise où l’Anthropocène a commencé, l’analyse marxiste s’intéresse à la longue période de changements sociaux et économiques pendant laquelle la transition entre les deux époques s’est produite.
![]()
CHAPITRE 7
Temps du capital, temps de la nature
Le monde moderne vénère les dieux de la vitesse, de la quantité et du profit rapide et facile; de cette idolâtrie sont nés des maux monstrueux.
– Rachel Carson
CHAQUE JOUR SONT PUBLIÉS DES ARTICLES et des livres où des scientifiques et des environnementalistes révèlent les effets dévastateurs pour l’environnement d’une croissance économique sans fin. La nécessité compulsive de produire toujours plus sature les rivières de poison et l’air de gaz à effet de serre. Les océans se meurent, des espèces disparaissent à un rythme sans précédent, l’eau douce se raréfie et le sol s’érode plus vite qu’il ne peut se régénérer.
Mais la machine continue de rouler. Cadres, économistes, commentateurs, bureaucrates et bien sûr politiciens sont unanimes: la croissance est bénéfique et la non-croissance est néfaste. L’expansion matérielle à l’infini est une politique défendue en pleine connaissance de cause par les idéologues de toutes les familles politiques, des sociaux-démocrates aux ultraconservateurs. Au terme de la réunion du G20 tenue à Toronto en 2010, les dirigeants des pays les plus riches du monde ont déclaré à l’unanimité que leur priorité consiste à «jeter les bases d’une croissance forte, durable et équilibrée». Le mot croissance apparaît 29 fois dans leur déclaration finale.
Face à l’amoncellement de preuves démontrant que l’expansion incessante de l’extraction des ressources et de la production est en train de nous tuer, pourquoi donc les gouvernements et les milieux d’affaires persistent-ils à alimenter ce train fou en charbon?
Dans la plupart des écrits sur l’environnement, on avance l’une ou l’autre des explications suivantes: c’est la nature humaine; c’est une erreur.
La thèse de la nature humaine occupe une place centrale dans la science économique orthodoxe. Celle-ci qualifie notre espèce d’Homo œconomicus (homme économique), que John Stuart Mill définit comme «un être qui choisit nécessairement de faire ce qui lui permet d’obtenir le plus de biens essentiels ou de luxe possible en échange du moins de travail et de sacrifices physiques possible». L’être humain en veut donc toujours plus, et la croissance économique est simplement le moyen que prend le capitalisme pour satisfaire ce désir fondamental. Assez n’est jamais assez.
Cette thèse amène souvent ses défenseurs à conclure que la seule façon de ralentir ou d’arrêter le pillage de Mère Nature consiste à freiner ou à stopper la croissance démographique: plus il y a d’humains, plus on doit produire; moins il y en aura, moins on devra produire. L’argument antipopulationniste n’est généralement pas plus étoffé que cela. Le fait que les pays dont les taux de natalité sont les plus élevés soient ceux qui ont les niveaux de vie les plus bas et génèrent le moins de pollution enlève toute crédibilité à cette thèse: si les trois milliards d’êtres humains les plus pauvres se volatilisaient du jour au lendemain, la destruction de l’environnement ne ralentirait pratiquement pas.
Ensorcelés par une idéologie trompeuse?
L’autre thèse couramment invoquée par les verts pour expliquer l’acharnement à promouvoir la croissance économique veut que les humains aient été ensorcelés par une idéologie trompeuse. Le professeur de sciences de l’environnement Robert Nadeau affirme par exemple que les dirigeants politiques et économiques sont sous l’emprise d’«un système de croyances quasi religieuses», et que la solution passe donc par leur conversion. «Si les dirigeants […] réalisaient qu’ils servent de faux dieux et décidaient de mettre en œuvre les mesures qui s’imposent pour régler la crise écologique, le monde pourrait vite devenir très différent», écrit-il. D’autres auteurs comparent la poursuite de la croissance à un fétichisme, à une obsession, à une dépendance ou même à un envoûtement.
Pour l’économiste et ingénieur en électronique Fawzi Ibraham, ces auteurs considèrent l’inexorable tendance du capitalisme à l’expansion non pas comme la conséquence inévitable d’un système basé sur le profit, mais plutôt comme «une obsession qui relève de la psychologie, une sorte de lubie collective qui ensorcelle tous les gouvernements et économistes de la planète, voire une conspiration mondiale élaborée».
Le fait d’accorder de l’importance à la croissance […] est considéré comme un phénomène autonome, un choix individuel […] ou collectif qui peut être confirmé ou annulé. C’est sans doute la première fois dans l’histoire qu’une nécessité est perçue comme un fétiche. Penser que le capitalisme a la croissance pour fétiche est tout aussi absurde que d’affirmer que les poissons sont des fétichistes de l’eau. La croissance est tout aussi essentielle au capitalisme que l’eau l’est aux poissons. Privé d’eau, le poisson meurt; privé de croissance, le capitalisme meurt.
Pendant des millénaires, pratiquement toute la production était destinée à l’usage, essentiellement local; c’est pourquoi le monde n’était guère propice à la croissance économique telle qu’on la connaît de nos jours. Dans le système capitaliste, en revanche, la plus grande partie de la production est destinée à l’échange: le capital exploite le travail et la nature pour produire des biens qui peuvent être vendus à un prix supérieur à leur coût de production, ce qui rend possibles son accumulation et la répétition du processus. C’est pourquoi l’idéologie de la croissance n’est pas la cause de l’accumulation sans fin, mais bien sa justification.
La raison d’être du capital
Chaque dirigeant d’ExxonMobil, de Volkswagen et de n’importe quelle autre grande entreprise polluante espère sans doute que ses enfants et ses petits-enfants vivront dans un environn...