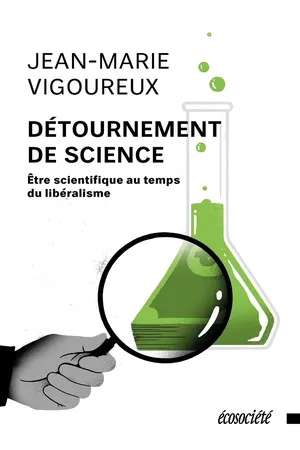1
L’utopie scientiste
Le droit au bonheur
Depuis le début du XVIIIe siècle, par de lentes et douloureuses transitions, l’Europe est en train de passer du vieux monde rural à celui des villes tentaculaires, du travail manuel à la machine-outil, de l’atelier à la manufacture et à l’usine. Peu à peu, des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sans ressources désertent la campagne et s’exilent vers les centres industriels en plein développement. Sous l’effet de ce flot d’immigration continu, les villes se développent avec une vitalité exceptionnelle. Paris qui ne compte que 630 000 habitants en 1789 en comptera un million avec ses faubourgs en 1830, le double en 1860 et le triple en 1890. Évaluée à 220 000 en 1830, sa population ouvrière est presque 4 fois plus importante 30 années plus tard.
Tous, certes, trouvent du travail, mais dans des conditions de vie inhumaines: les manufactures n’ont besoin que de leurs bras. Quand les riches, protégés dans les centres-villes par des loyers inabordables, bénéficient peu à peu des découvertes techniques, les pauvres, eux, restent rejetés dans des banlieues surpeuplées, logeant jusque dans des caves ou parqués dans des courées insalubres sans eau ni assainissement, sans approvisionnement d’aucune sorte. Orphelins de la terre qui autrefois leur apportait ses fruits, ils sont à la merci du moindre «coup dur». Qu’un accident survienne, qu’une maladie les arrête et c’est la catastrophe pour toute leur famille. Perdant leur emploi, ils se trouvent alors livrés à l’indigence, condamnés à mendier et à errer dans les rues.
Le 14 juillet 1789, parce que des siècles ont associé l’autorité à l’arbitraire, parce que l’injustice est devenue insupportable, la foule envahit les rues et, dans un sursaut de dignité, le peuple de France, affamé, relève la tête et prend la Bastille. Fait exceptionnel et sans doute unique dans l’histoire, les catégories les plus favorisées acceptent l’idée de renoncer à leurs privilèges et, pendant la longue nuit du 4 août, les représentants des trois ordres de la nation – le clergé, la noblesse et le tiers état –, font un premier pas vers l’abolition des droits féodaux. Trois semaines plus tard, ils publient la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et proclament la liberté et l’égalité de tous.
L’abolition des privilèges, pourtant, ne suffit pas pour supprimer la misère. En 1792, la famine tenaille les corps alors que les esprits rêvent des montagnes de pain et de nourriture qui, dit-on, empliraient les greniers royaux. Voyant la bourgeoisie s’enrichir en spéculant sur le prix des denrées essentielles, le prêtre Jacques Roux, leader du groupe révolutionnaire les Enragés, s’en prend violemment aux profiteurs dans un discours à la Convention nationale:
La liberté n’est qu’un vain fantôme quand une classe d’hommes peut affamer l’autre impunément. L’égalité n’est qu’un vain fantôme quand le riche, par son monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. La République n’est qu’un vain fantôme quand la contre-révolution s’opère, de jour en jour, par l’augmentation du prix de denrées que les trois quarts des citoyens ne peuvent s’offrir sans verser des larmes…
Fait marquant de cette Révolution en cours: pour la première fois de son histoire, le peuple estime avoir le droit de réclamer sa part de bonheur. Dans une adresse désormais célèbre, présentée à la Convention le 13 ventôse an II (3 mars 1794), Louis-Antoine de Saint-Just, à peine âgé de 26 ans, exprime sa joie de voir le bonheur apparaître enfin comme «une idée neuve en Europe». Il reconnaît cependant lui aussi qu’une telle idée est insuffisante pour rétablir la justice:
Tant que les gouvernements resteront sourds aux réclamations des peuples en oubliant les principes mêmes auxquels ils ont prêté serment, le bonheur restera juste une idée.
Cet objectif d’un bonheur équitablement partagé n’est pas celui de la seule Révolution française. Un même espoir de justice et de liberté souffle en effet sur le monde. De l’autre côté de l’Atlantique, quelques années plus tôt, le 4 juillet 1776, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson se sont eux aussi référés à ce même droit au bonheur dans leur préambule de la Déclaration d’indépendance des États-Unis:
Tous les hommes ont été créés égaux. Le Créateur leur a conféré des droits inaliénables, dont les premiers sont le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit au bonheur […]. C’est pour s’assurer la jouissance de ces droits que les hommes se sont donnés des gouvernements […]. Lorsqu’un gouvernement, quelle que soit sa forme, s’éloigne de ces buts, le peuple a le droit de le changer ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement en le fondant sur ces principes et en l’organisant en la forme qui lui apparaîtra la plus propre à lui donner sécurité et bonheur.
Si le peuple s’éveille ainsi à la conscience de ses droits, la Révolution pourtant ne répondra pas à ses espoirs. En permettant l’unification administrative de la France, en proclamant les grandes libertés contemporaines parmi lesquelles la liberté économique, la liberté d’entreprise et, partant, celle du profit, elle va permettre à la nouvelle bourgeoisie marchande et industrielle de s’imposer: en 1793, devant la gravité de la situation, tant aux frontières qu’à l’intérieur du pays, Robespierre, qui souhaite par-dessus tout sauvegarder l’unité de la Révolution, essaie de satisfaire les uns sans trop décevoir les autres. Pourtant sincère dans sa lutte contre l’injustice, il ne veut pas affoler cette bourgeoisie montante. Lui que l’on surnomme «l’incorruptible» estime d’ailleurs que la vertu suffira pour éliminer à terme la spéculation et l’égoïsme des nouveaux profiteurs. Il décide ainsi d’exclure du projet révolutionnaire les systèmes de taxes et de régulations économiques jugés par d’autres indispensables. Après sa chute, durant l’hiver 1796, Gracchus Babeuf, chef de la Conjuration des Égaux, tentera, mais en vain, de réglementer la vie économique et sociale et paiera de sa vie son opposition aux puissances d’argent.
La Révolution est ainsi confisquée par une nouvelle classe sociale, mais l’Europe qui, dans la crainte ou l’envie, n’a d’yeux que pour elle, en retiendra pourtant cette soif de justice. En 1798, à Königsberg, Emmanuel Kant, lui aussi révolté par l’extrême misère de son pays, avait mis ses espoirs dans la révolte du peuple de France. Malgré sa déception, il écrit:
Un tel phénomène dans l’histoire du monde ne s’oubliera jamais, car il a découvert au fond de la nature humaine une possibilité de progrès moral qu’aucun homme n’avait jusqu’à présent soupçonné. Même si le but poursuivi n’a pas été atteint, […] ces premières heures de liberté ne perdent rien de leur valeur. Car cet événement est trop immense, trop mêlé aux intérêts de l’humanité et d’une trop grande influence sur toutes les parties du monde pour que les peuples, en d’autres circonstances, ne s’en souviennent pas et ne soient pas conduits à en recommencer l’expérience.
Cette expérience, c’est celle de revendiquer une justice et un bonheur équitablement partagé. Le bonheur, certes, est une aspiration aussi vieille que l’humanité, mais c’est à l’époque de la Révolution que, pour la première fois, les plus malheureux ont pu enfin s’accorder le droit d’en réclamer leur part comme un dû. C’est à cette époque que l’idée du bonheur de chacun et de tous est entrée dans les textes constitutionnels comme un droit inaliénable. L’article premier du Préambule de la Constitution de 1793 le proclame: «Le but de la société est le bonheur commun», avant de souligner que c’est au gouvernement de garantir ce bonheur.
L’impact de la physique newtonienne
Si le droit au bonheur apparaît comme une idée neuve, il en est une autre qui prend une ampleur nouvelle: c’est l’idée que la raison est incarnée par la science.
Un siècle avant la Révolution, le 8 mai 1687, les Principes mathématiques de la philosophie naturelle sortaient de chez l’imprimeur. Newton y exposait la théorie de la «gravitation universelle» et y donnait une explication claire de phénomènes apparemment aussi différents que celui des marées, de la forme de la Terre, de la chute des corps ou du mouvement des planètes. Malgré son succès, cette découverte resta cependant longtemps controversée. En exprimant l’influence réciproque de toutes les masses de l’univers, elle posait en effet d’immenses questions: comment un corps fait-il pour «sentir» à distance la présence des autres et tenir compte de leurs mouvements «pour décider du sien propre»? Quelle «secrète et mystérieuse vertu» possède-t-il pour agir ainsi sur ses lointains voisins? Ces questions étaient d’autant plus troublantes que Newton affirmait l’action mutuelle des masses «malgré le vide et à travers lui», donc sans aucun support matériel: comment concevoir que deux objets puissent interagir sans être reliés par «quelque chose»; comment expliquer qu’un corps puisse agir sur un autre autrement que par contact ou par choc?
Ces questions sur le «mécanisme» de l’action des masses à travers le vide se compliquaient d’ailleurs par une autre, liée à l’affirmation du caractère universel de la gravitation: si tel était le cas, les étoiles devraient tomber les unes sur les autres et le système solaire devrait se disloquer sous l’effet des perturbations mutuelles des planètes. Comment l’univers fait-il pour ne pas s’effondrer sur lui-même et comment le système solaire peut-il rester stable depuis la nuit des temps?
Newton n’avait pas formulé d’hypothèse pour tenter d’expliquer le «mécanisme» de la gravitation. Pressé de toutes parts, il était resté fidèle à l’esprit de la science naissante en ne s’aventurant jamais au-delà des seules données de l’expérience ou des impératifs de calculs. Il avait ainsi refusé de spéculer sur les causes cachées des phénomènes. «Hypothese non fingo», avait-il écrit dans ses Principes mathématiques, «je ne feins pas d’hypothèse». Vous me dites que je n’explique rien? Cela est vrai, je ne sais pas comment les choses se passent et je ne fais pas semblant de le savoir. Je ne puis rien dire de la nature de ces forces. J’étudie seulement leurs effets et cela me permet de décrire ce qui existe et de prévoir ce qui se passera dans n’importe quelles circonstances, c’est tout.
Quant à la question de la stabilité du système solaire et de l’univers, il s’en était rapporté à Dieu disant qu’il intervenait certainement pour éviter les catastrophes et tout garder en ordre: «Sans une puissance divine pour le soutenir, l’univers s’effondrerait», écrit-il, la gravitation rend donc son existence nécessaire; plus encore, elle la prouve. L’action à distance a d’ailleurs bien les caractéristiques du divin puisqu’elle est omniprésente et simultanément active en tous lieux. Dans sa conclusion des Principes, Newton rendait ainsi hommage à cette action divine permanente: «Les lois de la mécanique sont les lois du Dieu de l’espace infini et du temps éternel qui, après avoir créé l’univers matériel, s’y manifeste par les miracles et par son action continuelle pour maintenir le monde en ordre de marche.»
À...