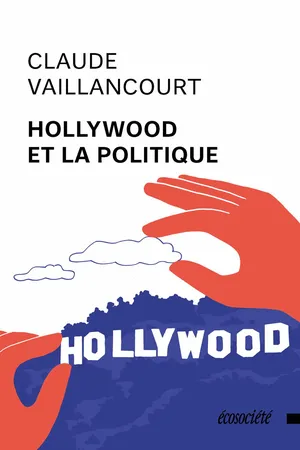7
La critique détournée
AINSI QU’ON L’A VU, Hollywood puise abondamment dans l’histoire récente des États-Unis. Cela offre l’avantage de fournir au public des sujets qui sont à la fois relativement familiers et qui abordent des questions sensibles à propos desquelles toute la vérité n’a pas été dite. Ce genre de films, que ce soit par le biais de la fiction ou par celui d’une histoire qui passionne d’autant plus qu’elle est présentée comme «vraie», emportera le spectateur dans les coulisses du pouvoir et permettra de saisir des enjeux complexes qui lui avaient échappé au moment de l’événement en question. Par ailleurs, les films inspirés de faits réels se comparent d’une certaine manière aux suites d’un grand succès: leur mise en marché est facilitée puisqu’ils racontent une histoire déjà connue du public. Ils éliminent ainsi certains risques liés au fait de se lancer dans un récit entièrement nouveau qui déplaira peut-être. Ils flattent le besoin d’être rassuré, d’avancer en territoire connu, de ne pas se confronter à une matière trop nouvelle exigeant davantage d’efforts de compréhension. Un peu comme le personnage principal du film Les enfants (1984) de Marguerite Duras, le public n’aime pas toujours «qu’on lui apprenne ce qu’il ne sait pas». Mais à partir d’un sujet familier, toutes les explorations sont possibles et la découverte d’une vérité cachée devient nécessairement captivante. Ces films donnent aussi l’impression aux gens occupés et à ceux qui se méfient des pièges de la pure fiction de ne pas perdre leur temps avec de purs produits de l’imagination, de s’adonner à une activité utile, qui consiste à s’instruire, à recevoir une leçon de politique et d’histoire contemporaine.
D’autres films, très nombreux, se contentent d’une certaine assise dans la réalité, qui sert d’inspiration à un récit en général réaliste, mais dont l’évolution et les personnages principaux relèvent de la fiction. L’histoire s’appuie sur de nombreuses balises reconnaissables, accentue certains traits des personnages, concentre l’action, se prête à quelques exagérations, mais dans l’ensemble, reste vraisemblable; elle raconte ce qui aurait pu se produire et élabore des hypothèses sur lesquelles il est pertinent de réfléchir. La réalité contemporaine ne se comprend pas uniquement à partir des choses qui se sont réellement passées, mais aussi à partir de toutes les autres directions qui ont été évitées et dans lesquelles l’histoire contemporaine aurait pu s’engager, si mille hasards ne l’avaient pas menée dans une voie désormais familière.
Ces histoires vraies ou inspirées de la réalité ont pour dénominateur commun de rendre quasiment impossible le récit neutre et objectif. Déjà, la prétention des historiens à l’objectivité est largement contestée: chacun raconte et interprète l’histoire avec le bagage accumulé dans sa vie, ses convictions, ses préjugés, son héritage culturel – son «habitus», selon Pierre Bourdieu –, dont il est impossible de se débarrasser totalement. Au cinéma, la vision personnelle des auteurs est accentuée par le fait que tout récit fait largement appel à l’émotion. Cette subjectivité, que met en scène plus ou moins habilement le réalisateur, s’ajoute à celle des personnages principaux, qui servent de guides à l’histoire – une histoire vécue selon leur point de vue. Les émotions du spectateur s’accordent à celles du personnage principal, auquel il s’identifie, personnage lui-même interprété par un acteur et, en amont, par un réalisateur – et parfois aussi par un producteur –, qui ne résistent pas toujours à l’envie de faire part de leurs préoccupations. Tout cela, ne l’oublions pas, s’instaure dans le contexte particulier d’Hollywood, qui demeure une industrie culturelle avec une forte exigence de rentabilité, soumise aux intérêts de l’entreprise capitaliste et qui cherche à plaire à un public éclectique dans différents pays.
Certes, quelques réalisateurs restent préoccupés par une volonté de ne pas grossir le trait, de présenter une vision non partisane des faits, avec des personnages qui défendent divers points de vue et des situations qui provoquent le questionnement. Certains films déclenchent des débats qui soulèvent des problèmes d’ordre éthique et entraînent d’importantes remises en cause d’idées reçues. Mais dans un nombre élevé de films, les cinéastes transmettent bel et bien, peut-être même au-delà de leurs intentions, des messages qui ont d’autant plus de portée que le sujet est social ou politique, et que les personnages de l’histoire sont familiers aux spectateurs.
La critique et ses limites
Les drames qui inspirent certains films ont leurs responsables, et ces derniers ne sont pas toujours de sombres bandits ou des fous dangereux. Si bien qu’il devient naturel, voire sensé, au cinéma, de blâmer ceux qui ont volontairement ou non provoqué un malheur, même s’ils se retrouvent aux échelons les plus élevés de la société: un propriétaire terrien, un directeur d’entreprise, un sénateur, un chef de police peuvent être eux aussi possédés par l’esprit du Mal et agir contre l’intérêt collectif, motivés par leur égoïsme, leur soif de pouvoir et leur méchanceté naturelle. Critiquer certains aspects défaillants du système, c’est aussi faire preuve de lucidité: les citoyens des États-Unis, comme ceux de tous les autres pays, ne sont pas aveugles devant certaines faiblesses et erreurs des puissants; ils apprécient que les fautes soient dénoncées, dans l’espoir qu’elles ne se reproduisent plus.
Les cinéastes qui choisissent de s’engager dans cette voie doivent se poser des questions fondamentales: jusqu’où peuvent-ils se lancer dans la dénonciation? Jusqu’où désirent-ils aller? Dans quelle mesure s’opposent-ils à l’ordre et à ceux qui le représentent? Et dans quelle mesure le cinéma – celui d’Hollywood en particulier, mais plus généralement le cinéma en tant que forme d’art – peut-il devenir un canal pour transmettre le mécontentement? À ces questions, le système d’Hollywood n’offre pas de réponses aussi claires qu’on pourrait le croire. On connaît peu de cas de véritable censure. Les projets trop subversifs sont plutôt étouffés dans l’œuf; le contrôle s’effectue aussi par le biais d’une autocensure constante qui restreint les ardeurs des cinéastes et scénaristes et détourne un propos de prime abord séditieux vers une conclusion inoffensive et rassurante.
Mais le cinéma hollywoodien s’est aussi ingénié à faire reculer les tabous: titiller le public avec de l’interdit et de l’inédit peut s’avérer dans certains cas une recette rentable. L’élimination du code d’autocensure Hays (adopté en 1930 et mis en vigueur de 1934 à 1966), qui limitait dans les films les actes et propos grossiers, la représentation de la sexualité, la nudité et la violence, s’est faite petit à petit, à force d’offensives acharnées et toujours plus audacieuses, alors que la population devenait plus tolérante et en redemandait. Comme le disait le poète Jean Cocteau, «il faut savoir jusqu’où on peut aller trop loin». Et cela demande «du tact dans l’audace», ce qui restera toujours difficile à mesurer pour un cinéaste hollywoodien.
Si bien que la voie la plus facile devient la suivante: se permettre certaines critiques, certaines dénonciations, mais ne pas dénoncer le système lui-même, ne pas remettre en question les valeurs collectives largement partagées. Les films qui correspondent à cette approche s’amorcent le plus souvent sur un constat désolant: un mal en provenance d’un vice réel de société et d’abus d’individus haut placés, ou d’actions injustifiables tolérées par le pouvoir en place, affecte une partie importante de la population. Quelques exemples: un grand propriétaire qui se comporte en tyran, une multinationale malhonnête qui pollue ou exploite les gens, des élites corrompues et complaisantes envers le crime organisé, des médias sensationnalistes et obsédés par les cotes d’écoute. Ces phénomènes déplorables occupent une place qui peut varier d’un film à l’autre et, dans les cas qui nous intéressent, ils ne provoqueront pas de dénonciation forte et significative d’un problème de société, mais permettront le châtiment cruel qui convient à celui qui l’a bien mérité. Les cinéastes acceptent de détourner leurs propos en transformant un constat choquant en quelque chose d’acceptable. Parmi les façons de concevoir ces détournements, les trois suivantes nous semblent les plus fréquentes:
- Désamorcer sa propre critique afin de la rendre inopérante. On y parvient le plus souvent en offrant des arguments qui viennent contredire les critiques amorcées, en rendant les «méchants» sympathiques et inoffensifs, en se moquant des personnages offusqués, etc. La médiocrité (souvent voulue) d’un film nuit aussi à sa cause: une démonstration faible, maladroite, insignifiante, peu convaincante est forcément inoffensive.
- Changer de cible. On découvre à la fin du film que le vrai responsable du drame n’était pas la grande compagnie exploiteuse ou l’avocat véreux au service des puissants, mais un détraqué quelconque, un amoureux fou ou même un enfant, qui n’avait rien à voir avec le problème évoqué au départ et auquel on cesse de s’intéresser. Ou encore, le problème social s’efface derrière une histoire d’amour ou de réconciliation familiale.
- Réduire le problème à un phénomène conjoncturel. Le Mal dénoncé dans le film relève de l’exception et non pas de la norme. Après sa dénonciation et la condamnation des coupables, il existe peu de chance qu’il se reproduise – du moins d’une manière semblable.
Les deux premières façons restent les plus efficaces pour se débarrasser du problème dénoncé. Elles ramènent le film hollywoodien à sa pure fonction de divertissement: on ne doit pas ennuyer trop longtemps avec des questions sérieuses. Le Mal dépeint au départ est un appât, stimule l’intérêt du spectateur qui y voit une dénonciation à laquelle il est vaguement sensible. Le reste de l’histoire lui rappellera qu’il a tort de s’intéresser à de pareils sujets, que tout n’est pas si grave, que le véritable problème relève surtout de passions humaines – parfois nobles, dans le fond – sur lesquelles il n’existe aucun contrôle efficace. La troisième manière permet d’aller plus loin dans la dénonciation et soulève le plus souvent d’intéressantes réflexions. Mais la conclusion de tels films laisse le spectateur satisfait et l’incite à se désintéresser de problèmes désormais réglés.
Lobbying et société du spectacle
Thank You for Smoking (2006) de Jason Reitman aborde un sujet particulièrement pertinent: le lobbying. Il est désormais reconnu que les lobbyistes des grandes compagnies s’affairent dans les grandes capitales, et plus particulièrement à Washington, pour influencer les élus afin qu’ils n’adoptent pas des réglementations qui nuiraient à leurs clients ou à l’obtention de contrats. Ces lobbyistes en surnombre et grassement payés s’activent derrière des portes closes; leur activité constante, conjuguée avec le financement massif des partis politiques par les grandes entreprises, est sans doute l’un des plus grands obstacles au bon fonctionnement de la démocratie. Dans Thank You for Smoking, on met de l’avant l’une des plus inexcusables entreprises de lobbying, celle des compagnies de cigarettes – dont le défenseur se solidarise avec d’autres lobbyistes de «marchands de la mort», une collègue représentant celui des alcools et un autre, celui des armes à feu.
L’humour franc du film vient accentuer son aspect irrévérencieux. Mais tout n’est qu’apparence, et ce film s’avère surtout très conformiste; son réalisateur refuse de s’engager dans un examen honnête et bien fait du métier de lobbyiste. Dans le film, l’action politique du lobbyiste ne s’exerce pas de façon discrète, par un contact personnel avec les élus, mais par le biais d’une consultation publique sur une éventuelle loi qui forcerait les compagnies de tabac à afficher une tête de mort sur les paquets de cigarettes. En vérité, le combat est inégal: il oppose un vieux sénateur bigot, ridicule, extrémiste et maladroit (en faveur de la loi) à un lobbyiste jeune, sexy et dynamique qui, dans un vibrant plaidoyer, prétend qu’il n’appartient pas à un gouvernement de prévenir les populations des dangers qui les menacent – des dangers qui se trouvent associés aussi bien aux transports, par exemple, qu’à la cigarette. On le comprend: ce lobbyiste sympathique et plein d’esprit, dont le discours est acclamé, se fait ainsi défenseur de la déréglementation et du «moins d’État», discours doux à l’oreille des patrons d’Hollywood. Le film aura aussi écorché au passage le journalisme d’enquête – une jolie journaliste va jusqu’à coucher avec le pauvre homme pour lui soutirer de l’information – et les militants antitabac, qui ont recours à l’enlèvement et à la violence pour faire avancer leur cause. Pendant ce temps, le lobbying reste un métier cool, drôle, sympa, pas toujours au service de bonnes causes, mais qui est tout à fait estimable s’il est exercé avec talent.
Wag the Dog (Des hommes d’influence, 1997) de Barry Levinson est souvent cité comme un film irrévérencieux qui fait une critique incisive du grand spectacle offert par les médias au service de la classe politique. Le film a semblé d’autant plus pertinent qu’il a anticipé un événement majeur: une guerre (celle en Irak) déclenchée sous un faux prétexte de menace terroriste. Dans Wag the Dog, un habile conseiller du président invente de toutes pièces une guerre, avec une Albanie qui alimenterait le terrorisme, pour distraire l’attention du public d’un scandale qui affecte le président quelques jours avant les élections: celui-ci aurait eu des relations sexuelles avec une mineure – ce qui, à l’époque, rappelait, en pire, le scandale de la liaison entre le président Clinton et la stagiaire Monica Lewinsky. Le film, habilement scénarisé entre autres par David Mamet, ne se prive pas de donner quelques coups de griffes: on y constate qu’une bonne guerre sert parfois à distraire le public d’un événement gênant; que les médias reprennent en boucle les mêmes nouvelles sensationnalistes sans en vérifier l’exactitude; que l’opinion et le consentement se fabriquent à coup d’images fortes et en jouant sur les émotions; que l’information télévisée est un spectacle qui se met en scène comme un film hollywoodien. Mais peut-être le film se prend-il au piège de son ton bon enfant? Une campagne électorale est abordée sans soulever de questions sous-jacentes: son financement, la publicité négative, l’influence des lobbies tant en politique intérieure qu’extérieure, etc. Certes, il est juste d’accorder une grande place à la question de l’image pendant une élection. Mais ces images se fabriquent avec jubilation et avec une facilité déconcertante, dans une joyeuse insouciance qui dilue un peu le propos. La fin du film, qui montre jusqu’où on peut aller pour empêcher la vérité d’éclater au grand jour, laisse cependant le spectateur dans un état de malaise. Ce film curieux et inclassable, avec sa conclusion cynique, passe du propos juste et cinglant à la caricature légère ...