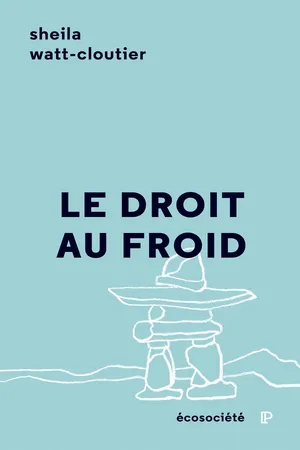![]()
CHAPITRE 1
Ma tendre enfance sur la banquise
Malgré les défis qui m’attendaient et l’avenir incertain de mon pays arctique, j’ai connu une enfance heureuse. L’amour et la sérénité dont je fus entourée ont nourri mon profond sentiment d’appartenance. J’ai grandi auprès de femmes fortes et indépendantes, au sein d’une communauté qui, aux prises avec de grands changements, demeurait unie, inclusive et solidaire.
À ma naissance, en 1953, ma famille vivait dans l’ancien village de Fort Chimo, une petite communauté du Nord-du-Québec, cette région qui allait devenir le Nunavik. Le nom de Fort Chimo venait de la prononciation déformée de saimuuq, qui signifie poignée de main, et fut attribué à la communauté par la Compagnie de la Baie d’Hudson. En inuktitut, le lieu était appelé Kuujjuaq, qui voulait dire grande rivière, en raison de sa localisation au bord de la rivière Koksoak (appellation due aux missionnaires moraves, sans doute une déformation de Kuujjuaq).
La petite agglomération de Kuujjuaq est située à la limite des arbres, dans un milieu au relief vallonné où résistent encore quelques mélèzes et épinettes noires. Durant notre courte saison estivale, à travers les herbes et les arbrisseaux de la toundra, on découvre les baies de chicoutai, les bleuets, les atocas arctiques et la camarine noire. Au-dessus du dense tapis de mousse, de lichen et de campanules bleues, on peut voir onduler sous le vent léger les duveteuses fleurs blanches de la linaigrette et les grappes d’un vif rose pourpre de l’épilobe. L’hiver venu, le paysage se transforme en un saisissant panorama de glace et de neige qui s’étend à perte de vue sous l’immensité bleutée des ciels arctiques.
Niché dans ce paysage grandiose, l’ancien Fort Chimo était à l’origine un poste de traite, établi par la Compagnie de la Baie d’Hudson dans les années 1800. La communauté avait commencé à s’étendre avant 1950, mais lorsque j’étais enfant elle ne comptait toujours qu’un petit nombre de maisons familiales; en réalité de simples abris de contreplaqué peint, chauffés à l’aide d’un poêle à l’huile ou au bois, sans eau courante et sans électricité. Le reste du village était composé d’un comptoir de la Baie d’Hudson et de ses entrepôts, de la mission catholique, d’une infirmerie et d’une station météo, tous également de modestes bâtiments faits de contreplaqué. Je ne me souviens pas d’avoir vu des automobiles à l’ancien Fort Chimo. À l’occasion, les employés de la Baie d’Hudson ou des représentants du gouvernement traversaient le village à bord d’une version archaïque de la motoneige de Bombardier: un lourd véhicule entièrement fermé et mû par des chenilles. Nos moyens de transport à nous, les Inuit, étaient les qimutsiit (les attelages de chiens) et nos jambes.
La population de Fort Chimo s’élevait alors à quelques dizaines de personnes seulement. La plupart des familles vivaient encore en déplacement dans leurs territoires de chasse, de pêche et de piégeage, à plusieurs jours de marche du village. On ne voyait ces familles nomades qu’au moment où elles venaient au comptoir de traite, échanger leurs fourrures pour de la nourriture et des munitions. Quand j’étais encore un bébé, il n’y avait pas de chasseur dans ma proche famille, aussi ma grand-mère demeurait-elle auprès du poste de la Baie d’Hudson.
Nous avons vécu dans l’ancien Fort Chimo jusqu’à ce que j’atteigne ma quatrième année, puis nous avons déménagé au nouveau Fort Chimo, de l’autre côté de la rivière. Le nouvel établissement avait d’abord été l’emplacement d’une base de l’armée étatsunienne appelée Crystal I, bâtie lors de la Seconde Guerre mondiale. La base était une composante de la Crimson Route, une série de pistes d’atterrissage reliant la Grande-Bretagne à l’Amérique du Nord, une façon pour les États-Unis de soutenir la Royal Air Force. En tout, quatre bases furent construites en Amérique du Nord et trois au Groenland. Fort Chimo était d’une importance stratégique pour les États-Unis, à mi-chemin de l’Europe. Nos communautés inuit de Fort Chimo, de Frobisher Bay (Iqaluit) et de Padloping Island permettaient une traversée à saute-mouton.
Une fois les Étatsuniens partis, plusieurs années après la fin de la guerre, les avions de ravitaillement en provenance du Sud ont continué d’atterrir sur la piste de Fort Chimo. S’y rendant en canot l’été et en traîneau à chiens l’hiver, les hommes de notre communauté trouvaient à s’approvisionner à l’ancienne base militaire. Nous y allions de temps à autre quand j’étais enfant, pour y prendre le courrier et faire nos achats. Mais il s’avérait malcommode pour tout le monde de traverser la rivière pour le courrier et les provisions, aussi tous les services, dont les missions anglicane et catholique, de même que l’infirmerie, furent relogés au nouveau Fort Chimo et une école y fut construite. Les familles de l’ancien établissement suivirent. Au moment où ma famille déménagea, il ne restait plus à l’ancien emplacement que le magasin de la Baie d’Hudson et la famille de mon oncle, qui travaillait pour la compagnie. Le magasin et mon oncle finirent eux aussi par déménager.
Le nouveau Fort Chimo prospéra rapidement au cours de la décennie suivante, alors que de plus en plus de familles inuit s’y installaient. Les bâtiments militaires abandonnés furent d’abord récupérés pour loger les services et les familles, mais furent bientôt remplacés par des maisons et des édifices construits par le gouvernement. Les traces de la présence étatsunienne demeuraient toutefois visibles. Les militaires avaient laissé sur place des centaines de barils de goudron, sans doute utilisés pour la construction de la piste d’atterrissage, qui furent enfin enlevés lorsque la municipalité de Kuujjuaq s’acquitta de la tâche, alors que j’avais atteint l’âge adulte. En plus des barils épars dans l’environnement, le sol était marqué par les traces des chars et des poids lourds de l’armée; des traces encore visibles de nos jours. Au fur et à mesure de la croissance du nouveau Chimo, les automobiles devinrent plus habituelles. Quand j’atteignis l’adolescence, Kuujjuaq regroupait plusieurs centaines de personnes. Aujourd’hui, sa population dépasse les 2000 habitants.
Avec les années, notre famille allait faire partie d’une population inuit sédentaire de plus en plus nombreuse au nouveau Fort Chimo. Toutefois, dans l’ancien village nous avions été un peu isolés de la famille élargie et du reste de la communauté. Cela tenait en grande partie au fait que notre famille était différente, au temps de mon enfance comme au temps des jeunes années de ma mère.
Aux alentours de 1920, la mère de ma mère s’était éprise de William Watt, un Écossais venu dans le Nord pour travailler comme apprenti commis à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ma grand-mère et lui eurent trois enfants. Puis, à l’été 1926, William Watt quitta Fort Chimo et sa petite famille inuit. Ma mère, Daisy, avait alors cinq ans seulement. Sa sœur, Penina, faisait ses premiers pas et son frère, mon oncle Johnny, allait naître après le départ de son père, en novembre.
En ce temps-là, il n’était pas coutumier pour les employés qallunaat de la Baie d’Hudson de s’établir et de marier les femmes inuit avec lesquelles ils avaient eu des enfants. Quand un gestionnaire était muté à un poste dans une autre localité, il partait le plus souvent en laissant derrière lui ses enfants et leur mère.
Il semble toutefois que mon grand-père avait demandé à ma grand-mère de le suivre. Il lui écrivit une lettre après son départ, se disant convaincu qu’elle aimerait le lieu où il vivait désormais. Mais, autant ma grand-mère ne voulait pas perdre l’homme qu’elle aimait assurément, et qui était le père de ses enfants, autant elle ne pouvait s’imaginer partir vivre au Sud. Elle avait le sentiment de devoir rester et laisser partir mon grand-père. Il s’agissait certainement d’un choix difficile. On m’a raconté que ma grand-mère aurait dit à William Watt: «Pars si tu dois partir, mais si tu dois te marier ne prends pas une Inuk ou une Indienne pour femme. Cela me ferait encore plus de peine.» Elle apprendrait plus tard qu’il s’était marié et qu’il était retourné dans une autre communauté du Nord, avec sa femme blanche et un fils, mais il ne reprit jamais contact avec ma grand-mère. Des décennies plus tard, lorsque William Watt se confia en entrevue à propos de son expérience en milieu nordique, il ne fit pas mention de sa famille inuit.
Bien que le départ de mon grand-père fût considéré comme normal à l’époque, cela n’en était pas moins éprouvant. Ma mère était abandonnée par un père qu’elle avait aimé et mon oncle ne connaîtrait jamais son père. Ma grand-mère, quant à elle, se trouvait devant un douloureux dilemme. Elle n’avait plus les moyens de nourrir et de prendre soin comme il se doit de ses deux fillettes et elle attendait un autre enfant. Le seul moyen qui s’offrit à elle pour assurer le bien-être de tous ses enfants fut de confier à une autre famille de la communauté, les Shipaluk, la petite Penina âgée de deux ans. Ma grand-mère était une personne douce et aimante. Il est difficile de se représenter à quel point la décision dut être difficile pour elle. Quant à Penina, même si les Shipaluk furent pour elle de bons parents adoptifs, et malgré qu’elle ait grandi à proximité de sa mère et de sa fratrie, avec qui elle demeura liée, de toute sa vie elle ne put effacer de sa mémoire le fait que sa famille n’avait pas été en mesure de la garder.
Même si Penina était confiée aux soins d’une autre famille, ma grand-mère était en difficulté. William Watt a sans doute fourni une aide matérielle pendant quelque temps (et quand mon oncle Johnny atteignit l’âge de travailler, il se fit embaucher par la Compagnie de la Baie d’Hudson), mais cela n’était pas suffisant. Le ménage ne pouvait pas compter sur le soutien d’un chasseur. Ma grand-mère, disposant d’un minimum d’équipement, arrivait à capturer quelques proies faciles comme les lagopèdes, mais elle devait chasser dans les environs immédiats du poste de traite. Elle ne pouvait laisser ses enfants et se joindre aux hommes en déplacement sur le territoire pendant de longues périodes. Elle n’eut pas d’autre option que de rester à Fort Chimo et de faire des travaux ménagers au magasin de la Baie d’Hudson. Quand ma mère atteignit l’âge de dix ans, elle commença à contribuer à la survie familiale en accompagnant sa mère au magasin, où elle pouvait recevoir de la nourriture en échange de son travail. Dès que Johnny fut adolescent, des proches plus âgés lui enseignèrent les rudiments de la chasse et, comptant par ailleurs sur son salaire de la Baie d’Hudson, il put lui aussi participer au soutien de la famille.
Étant mère célibataire, ma grand-mère devait travailler plus fort que la plupart des femmes pour faire vivre sa famille. Ma mère allait se retrouver dans la même situation.
Ma mère eut trois enfants: Charlie, puis Bridget, six ans plus tard, puis enfin moi, Sheila (Siila), quatre ans après Bridget, tous issus de liaisons différentes. Les trois géniteurs qallunaat quittèrent ma mère après la naissance de leur enfant. Le dernier d’entre eux était mon père. Ma mère et ma grand-mère adoptèrent aussi un garçon de douze ans, Elijah, avant ma naissance. Aussi, ma mère eut à trimer durement pour assurer notre subsistance à tous.
Cependant, ma mère possédait un atout dont ma grand-mère avait été dépourvue. Elle avait appris à parler anglais en bas âge, sous la tutelle d’un missionnaire catholique dénommé Umikutaak, c’est-à-dire «longue barbe». Elle était une des rares Inuit de l’époque à maîtriser suffisamment la langue anglaise pour être considérée comme bilingue. Au moment de ma naissance, cette rare compétence lui valut un emploi d’interprète auprès du personnel de l’infirmerie de Fort Chimo et pour les équipes sanitaires aériennes de passage au Nunavik.
Comme sa mère avant elle, ma mère dut rester avec sa famille à l’ancien poste de Fort Chimo, pendant que les autres familles gagnaient leurs territoires de chasse et de pêche. Nous n’avons pourtant jamais eu le sentiment de manquer de quoi que ce soit. Ma grand-mère et ma mère endossèrent toutes deux le double rôle de mère et de père pour nous et, entourés de leurs bons soins, nous nous sentions en sécurité. En vérité, ma mère et ma grand-mère furent des modèles pour moi. Elles étaient des femmes remarquablement pleines de ressources. Je ne les ai jamais vues en situation de détresse ni en train de se plaindre, malgré l’absence de luxe et le peu de confort dans leur vie. Elles démontraient plutôt de la dignité et de l’intégrité; elles étaient fortes et persévérantes. Elles ne se contentaient pas de survivre en tant que mères célibataires, elles étaient épanouies.
L’esprit d’entreprise de ma mère s’exprima de manière éclatante lorsqu’elle prit la décision de construire sa propre maison. J’avais alors environ sept ans.
À notre arrivée au nouveau Fort Chimo, nous avions d’abord habité une partie d’un ancien bâtiment de l’armée américaine. C’était une construction longue, recouverte de papier goudronné noir; la surface habitable comportait un coin-cuisine, mais pas de véritable salle de bain. J’ignore si une famille vivait dans l’autre section du bâtiment. En fait, ce logis ne nous est jamais apparu comme un véritable chez-soi, peut-être parce que nous savions qu’il était temporaire. Notre famille eut bientôt droit à l’une des maisons à charpente alors octroyées aux Inuit par le gouvernement. C’étaient de minuscules maisons, à l’espace intérieur restreint et ressemblant un peu à des tentes. (D’autres maisons de forme plus carrée fournies par le gouvernement étaient baptisées les «boîtes d’allumettes», en raison de leur format réduit.) Ces logements gouvernementaux étaient dotés de l’électricité, mais pas de l’eau courante. Une demi-cloison séparait l’aire de couchage de la cuisine et de la salle de séjour, tandis que, dans une petite pièce séparée, un seau récupéré que l’on vidait chaque jour tenait lieu de toilettes. Bien que la maison fût exiguë (nous étions tout de même six à y vivre), elle nous paraissait confortable, nous rappelant davantage notre logis de l’ancien Fort Chimo que le sombre et terne bâtiment étatsunien.
Après quelques années dans la maison du gouvernement, ma mère se lança avec l’aide de mon frère Elijah dans le projet inusité de construire sa propre maison. Ils parvinrent à obtenir le bois récupéré de la démolition d’un bâtiment ayant abrité des installations électriques à l’ancien Fort Chimo. Elijah, aidé par quelques autres, transporta le bois de l’autre côté de la rivière en canot. Le reste des matériaux nécessaires fut acheté par ma mère.
Elijah avait acquis une solide expérience de la construction sur les chantiers de plusieurs édifices érigés au nouveau Chimo au cours des ans. Il avait été guidé par oncle Johnny, un charpentier chevronné qui avait lui aussi construit sa propre maison. (La majorité des Inuit étaient déjà à ce moment-là des ouvriers aux qualifications diverses. Forts de leur ingéniosité et de leurs compétences techniques héritées de la vie traditionnelle, ils excellaient à développer les nouvelles compétences requises pour construire une maison, faire la mise au point d’une fournaise ou réparer un moteur de motoneige.) Ma mère participait aux travaux avec Elijah, souvent jusque tard dans la soirée, en plus d’un ou deux hommes de l’équipe de construction du gouvernement, qui venaient donner un coup de main après leur journée régulière. Quand ce fut terminé, nous eûmes une maison avec une cuisine séparée de la salle de séjour, plus trois chambrettes, une salle de bain et une véranda. Il y avait un poêle à l’huile dans la cuisine et un appareil de chauffage à l’huile dans le séjour. Si nous n’avions toujours pas l’eau courante (ma mère n’aurait pas accès à ce confort avant que j’atteigne mes vingt ans), nous pouvions au moins chauffer l’eau sur le poêle pour les bains, la lessive et la vaisselle.
Emménager dans la maison construite par ma mère inspira à toute la famille beaucoup de fierté et de contentement. Il était rare que les Inuit construisent leur maison, encore plus rare une femme inuit, et nous en étions bien conscients. Voilà qui en disait long sur le caractère et l’aplomb de ma mère.
En fait, ma mère était en avance sur son temps. Elle assumait admirablement son rôle de soutien de famille, veillant à ce que ses enfants ne manquent jamais du nécessaire et jouissent aussi de petits luxes, comme des vêtements au goût du jour et toutes ces nouveautés dont les jeunes raffolent. (Quand j’étais adolescente, pour nourrir mon amour de la musique et de la danse, elle m’avait offert un tourne-disque à piles.) Elle était aussi farouchement indépendante et ne se gênait pas pour faire connaître son opinion. Les adultes en général prenaient garde à tous les enfants de la communauté, mais ma mère allait plus loin et n’hésitait pas à inciter un enfant à rentrer chez lui si elle estimait qu’il était dehors à une heure trop tardive. Il pouvait aussi lui arriver, alors qu’elle accompagnait l’équipe médicale en tournée, de faire des remontrances à des personnes au sujet de leur hygiène personnelle. Elle était assurément une extravertie.
D’un autre côté, elle pouvait se montrer renfermée et elle avait du mal à montrer son affection à ses enfants. Bien qu’elle eût un vif sens de l’humour et qu’elle puisse se montrer enjouée et drôle avec les enfants, elle ne nous témoignait pas souvent son affection. (Toutefois, elle fut toujours affectueuse avec ses petits-enfants.) Sa réserve était particulièrement marquée avec moi. En de rares occasions, elle me confia quelques souvenirs de ses relations avec les deux premiers hommes de sa vie, les géniteurs de ma sœur et de mon frère, mais elle demeura muette au sujet de mon père. Il était évident que ce troisième abandon subi par ma mère avait été particulièrement douloureux. Je pense que sa froideur envers moi était due à la carapace laissée autour de son cœur par cette blessure.
Si je ressentis parfois un manque d’affection de la part de ma mère, celui-ci fut largement compensé par la douceur attentionnée de ma grand-mère. Quand ma mère travaillait, ma grand-mère était là pour nous choyer de sa rassurante et aimable présence. Tous les matins, j’étais réveillée par le son de la radio. En même temps que les voix de la station du Groenland ou du Service du Nord de Radio-Canada parvenaient à mes oreilles, j’entendais grand-mère préparer pour moi le thé, le gruau d’avoine et la banique du déjeuner. Plus tard dans la journée, si nos proches ne venaient pas à la maison partager le thé et la banique, nous sortions ensemble leur rendre visite. Au temps de ma jeunesse, les Inuit adultes n’étaient pas prodigues de marques d’affection entre eux, mais ils distribuaient à profusion aux bébés et aux petits enfants les câlins, les caresses et les kuniit (baisers inuit, sortes de petits reniflements sur la joue). Aux enfants un peu plus âgés, on démontrait de l’affection par les mots, les regards et les gestes attentionnés. On produisait entre autres un son de gorge doux et apaisant, une manière de caresse vocale. Les heures passées avec ma grand-mère et les autres adultes de la communauté furent toujours habitées de cette sonorité rassurante.
Quand j’étais encore toute petite, dans notre maison de l’ancien Fort Chimo, je me tenais tous les soirs sur le rebord de la fenêtre pour guetter le retour de ma mère de son travail. Je garde aussi le souvenir impérissable de ma grand-mère me racontant des histoires ou me lisant la bible pour m’endormir. Quand je fus un peu plus âgée, je me familiarisai avec l’écriture inuktitut en lisant le vénéré livre de cantiques de ma grand-mère, écrit en qaniujaaqpait (écriture syllabique, élaborée à l’origine pour transcrire la langue des Cris).
Cadette de la famille, j’étais choyée par ma sœur et mes frères. Dans beaucoup de familles inuit, un enfant est favori et cela ne soulève aucun reproche, c’est tout simplement accepté. Chez nous, il ne faisait aucun doute que Bridget était la favorite de ma mère, mais ma sœur n’en était pas toujours heureuse. Je pense que Bridget était spécialement gentille avec moi, plus mère poule que sœur aînée, parce qu’elle se savait préfé...