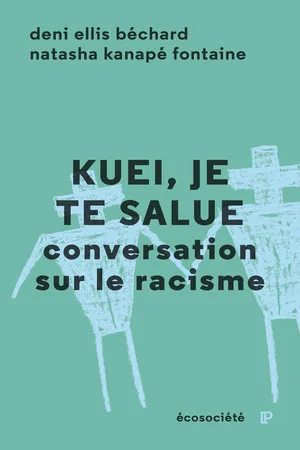
- 212 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
En 2016, la poète Innu Natasha Kanapé Fontaine et le romancier québéco-américain Deni Ellis Béchard entamaient une conversation sans tabou sur le racisme entre Autochtones et Allochtones. Comment cohabiter si notre histoire commune est empreinte de honte, de blessures et de colère? Comment faire réaliser aux Blancs le privilège invisible de la domination historique? Comment guérir les Autochtones des stigmates du génocide culturel?? Ces questions traversent leurs échanges: Natasha raconte sa découverte des pensionnats autochtones, son obsession pour la crise d'Oka, la vie dans la communauté de Pessamit; Deni parle du racisme ordinaire de son père, de la ségrégation envers les Afro-Américains, de son identité de Québécois aux États-Unis.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Kuei, je te salue par Deni Béchard,Natasha Kanapé Fontaine en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Literatur et Literarische Briefe. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
LiteraturSujet
Literarische Briefe1
Kuei Natasha,
Je te salue dans ta langue pour souligner à quel point la distance entre les peuples allochtones et autochtones demeure importante. Au fil des années, j’ai su dire bonjour en espagnol, italien, roumain, allemand, persan, arabe, hindi, japonais, chinois, lingala et swahili – même en latin de la Rome antique!–, mais pas dans une seule des langues des peuples qui vivent en Amérique du Nord depuis des millénaires.
Cela n’est que le symptôme d’un problème qui est difficile à aborder, pour les Allochtones. Nous trouvons ça amusant de voyager en Amérique latine pour les vacances ou de discuter du multiculturalisme, mais nous sommes généralement ignorants de la réalité des Autochtones. Souvent même cette réalité nous terrifie. En construisant un mur d’ignorance entre nos peuples, nous avons fait naître une peur immense. Mais plus nous avons peur, moins nous nous connaissons, et cette peur croît comme un cancer. Nous devenons alors tellement préoccupés par la maladie que nous ne nous soucions plus que de nous-mêmes, et nous oublions la source du problème.
C’est pour cette raison que je t’écris. Nous sommes devenus amis à Sept-Îles, le printemps dernier, pendant le Salon du livre de la Côte-Nord, ta région natale. Tu t’y rendais pour confronter une écrivaine québécoise populaire qui avait, dans un blogue du Journal de Montréal, décrit la culture autochtone comme «mortifère» et «antiscientifique».
Tu voulais seulement lui lire une lettre qui exprimait ton point de vue: lui dire combien ses mots étaient blessants, combien ils perpétuaient une image fausse et raciste contre laquelle ton peuple lutte depuis des siècles. Mais quand tu as essayé de lui parler, elle t’a coupé la parole et a pris son microphone pour parler plus fort que toi.
Je me suis dit qu’elle aurait dû te tendre le micro, même si elle n’était pas d’accord avec tes idées – surtout, il me semble, dans un espace comme un salon du livre, créé spécialement pour le partage intellectuel. Au contraire, elle s’est mise à te lire la définition d’un «Amérindien» contenue dans un livre qu’elle avait elle-même publié. Quelle ironie! Quelle arrogance! Comme tu étais arrivée sur place avec d’autres femmes autochtones, elle aurait pu en profiter pour ouvrir un dialogue avec vous et obtenir de l’information directement à la source, mais elle a préféré parler à ta place.
À ce moment, j’ai compris quelque chose. Nous, les Allochtones, sommes persuadés que nous avons toujours raison, que notre domination sur le monde est le signe de la justesse de nos pensées et de nos actions. Cette croyance est encodée dans notre culture, enracinée dans nos inconscients. Or, nous ne savons pas écouter. Nous condamnons au silence tous ceux et celles qui sont différents de nous, et nous parlons à leur place en faisant semblant de les entendre.
Je t’écris cette lettre pour ouvrir un dialogue entre nos peuples, et non pour culpabiliser les Allochtones de cette culture raciste. Aucun d’entre nous ne l’a inventée. Nous en avons hérité. Toutefois, nous sommes responsables de la comprendre et de la changer. Ce n’est pas facile, car nous avons de la difficulté à percevoir ce qui nous semble aller de soi. Nous vivons dans notre culture comme nous respirons l’air qui nous entoure; nous la tenons pour acquise.
Peut-être est-ce plus facile pour toi de percevoir cette réalité, toi qui as vécu à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la culture des Allochtones. Alors, en t’écrivant, j’ai deux buts: que les lettres que nous allons rédiger au cours de cet échange épistolaire forment ultimement un livre plein d’honnêteté ainsi qu’un livre de questions: pour comprendre le vrai problème, il faut raconter de vraies histoires et celles-ci nous feront parfois mal à tous les deux, car le racisme affecte ceux qui vivent de chaque côté de la barrière. En niant l’humanité complexe de l’autre personne, nous empêchons l’épanouissement de notre propre humanité: notre intelligence, notre compassion – et toutes les qualités qui font de nous des êtres humains. Ainsi, en réduisant une autre personne à une idée ou à une série de préjugés, nous réduisons notre capacité à vivre pleinement notre propre humanité. Ceux qui caricaturent les autres deviennent eux-mêmes des caricatures.
Surtout, il faut s’écouter. Il faut que les Allochtones apprennent à partager l’espace de la parole pour trouver un équilibre entre la leur et celle des Autochtones. J’aurai beaucoup de questions à te poser. Mais pour commencer, j’aimerais savoir comment tu as vécu l’histoire du Salon du livre.
Et, enfin, comment est-ce qu’on dit «à bientôt» dans la langue Innu?
Deni
2
Kuei kuei mon ami,
En écrivant ces mots qui ouvrent ma toute première lettre, j’ai eu le réflexe de me demander pourquoi j’avais choisi de dire «kuei» au lieu de «bonjour».
C’est justement pour approfondir ce genre de questionnement que nous nous sommes donné rendez-vous devant nos écrans, après l’expérience que nous avons vécue ensemble au Salon du livre de la Côte-Nord. Pour écrire sur les relations entre nos peuples. Autant tu manifestes de l’intérêt à me poser des questions sur mes perceptions, autant j’en ai à te répondre, à échanger avec toi et à apprendre à distinguer le vrai du faux afin que nous puissions, peut-être, guérir notre inconscient collectif. J’aimerais apprendre de toi, aussi.
Tu te souviens de ce 27 avril? Je te raconte, car tu ne sais pas toute l’histoire. Je te l’ai rapportée trop vite, ce jour-là, tellement j’étais anxieuse. J’avais vu l’indignation gagner mes réseaux sociaux autochtones. Quand cette conférencière a écrit cette chronique horrible dans les pages de ce journal – qui est le plus lu au Québec, tant au sein des communautés québécoises qu’autochtones –, j’étais triste de constater l’infamie qu’on se permettait de servir aux citoyens du Québec. Selon mes valeurs et mes principes, sans doute issus de ma culture traditionnelle, je ne pouvais pas croire qu’on puisse offrir cela à penser à ses contemporains, aux gens de sa collectivité. Du racisme. Je me suis à nouveau sentie blessée par tant d’ignorance. C’est ce qui m’a poussée à cosigner cette lettre ouverte écrite par des ami.e.s du milieu culturel autochtone, tant Autochtones qu’Allochtones. Et bien, c’est exactement pour cette raison, cette indignation partagée avec la grande majorité de mes ami.e.s et de leurs proches, dans les communautés plus ou moins éloignées de la Mauricie, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, que j’ai voulu donner une voix à ceux et celles qui ne maîtrisent pas la parole publique ou, simplement, la langue française. Car, parfois, dans cette société, faire partie d’une minorité visible signifie ne pas savoir parler la langue dominante…
Mon peuple, les miens, venait d’être sali publiquement. En 2015, je ne pouvais pas laisser passer ce genre de propos nauséabonds sans y répondre. Je te parlerai plus tard de cet «instinct de survie» qui m’anime parfois. Dans ces moments, je vois souvent l’image d’une louve blanche qui défend sa meute.
J’ai donc décidé de me rendre au Salon du livre de la Côte-Nord la fin de semaine suivante. J’ai concocté une intervention publique devant cette femme afin de prouver le parfait contraire de ce qu’elle venait de déclarer à propos de mon peuple: son inertie. Je me motivais en me disant que les miens pourraient voir qu’il est possible de se tenir debout et de parler publiquement pour se défendre. Autrement dit, j’utilisais ma parole «ouverte» pour montrer l’exemple. Par la non-violence, d’abord, et, surtout, par la dignité et l’humanité.
Des femmes Innu étaient au rendez-vous, avec toute leur fierté d’être femmes, d’abord, puis Innu. Au moment où je me suis avancée vers la conférencière, elles se sont toutes levées, tel qu’elles s’étaient passé le mot. Quelle sensation! J’avais l’impression de me retrouver des siècles plus tôt, debout, avec les femmes de ma nation; être plusieurs, mais à la fois une seule. Malgré toute la légitimité de notre action, nous avons eu droit à la condescendance de cette conférencière. J’avais été prévenue, j’avais donc pu l’anticiper. N’empêche que je venais de me buter au gouffre humain de l’ignorance et de l’orgueil.
Personne n’a besoin d’être puni pour cette culture raciste, en effet. Nous devrions plutôt servir à la collectivité de la bonne nourriture pour l’esprit. Je persiste à dire aux Québécois et aux autres peuples issus d’ancêtres colonisateurs que ce n’est pas de leur faute. La faute repose sur ceux qui ont créé ce pays sur la base du racisme et de la discrimination, ainsi que sur les gouvernants qui ont perpétué ce système. Cela a été prouvé. Nous, les Autochtones, le savons depuis le début. Nous l’avions vu même dans nos oracles et nos feux du soir, bien avant l’arrivée de «l’homme pâle» sur le continent.
Étrange, je sais, mais cherche sur Internet la Prophétie des Sept feux. Elle aurait été révélée au peuple Hopi par des entités spirituelles, il y a environ sept générations. Elle prédisait que d’autres êtres humains à la peau pâle viendraient de la mer et que nous verrions des animaux à cornes se multiplier (les vaches), des serpents de métal traverser le pays (les chemins de fer et les pipelines), une grande araignée faire sa toile partout sur la Terre (l’Internet). Elle affirmait que si toutes ces prédictions se réalisaient, alors le peuple des hommes pâles aurait conquis toute la terre de l’île de la Tortue (nom donné traditionnellement au continent d’Amérique du Nord). La prophétie raconte aussi que la septième génération après celle qui a reçu les Sept feux se lèvera pour réveiller le cœur et l’esprit de ces premiers peuples ayant vécu l’oppression. À ce moment, l’humanité se trouvera placée devant un choix: soit continuer sur le chemin de la croissance illimitée, du matérialisme, de l’exploitation des ressources humaines et naturelles, soit prendre le chemin de la spiritualité (car tout humain a un esprit), retrouver sa relation originelle avec la nature et honorer à nouveau les femmes de son clan afin de perpétuer les traditions, les peuples et, finalement, l’humanité. Le grand réveil.
Mais, même prévenus, nous n’avons rien pu faire. Voilà où nous en sommes, Deni. Alors, parfois, je me questionne sur le destin. Cela relève peut-être d’une autre légende, d’une autre prophétie.
Nos contemporains ont besoin d’honnêteté. Toi et moi écrivons, nous avons le pouvoir de l’écriture et de la parole. Profitons-en. Servons-nous-en pour la bonne cause: l’humanité des êtres, de nos congénères. De nos peuples qui n’en peuvent plus de ne pas se parler, de ne pas savoir comment se parler.
J’apprendrai également, de mon côté. Je parle haut et fort depuis si longtemps que j’oublie peut-être déjà d’écouter. Mais j’écouterai. Nous avons de moins en moins peur. Nous avons longtemps été persécutés et penchés sur nos douleurs et, malgré la frayeur d’être à nouveau trahis ou insultés, nous devons maintenant tendre l’oreille. Je tendrai l’oreille. Parle-moi. Parlons-nous.
Chez nous, on dit couramment «niaut» pour «au revoir». À Mani-Utenam et au-delà, en continuant vers le nord sur la route 138, tu entendras surtout «iame». Et pour dire «à bientôt» dans le sens de «nous nous reverrons bientôt», on dit «iame uenepeshish» que je traduis littéralement par «au revoir, pour un petit temps».
Iame uenepeshish nuitsheuakan,
Natasha
3
Kuei kuei encore,
Aujourd’hui, je pense beaucoup à la peur et au silence, et il me semble que les deux sont inextricablement liés, au moins dans le cas du racisme. Le racisme repose entièrement sur le silence de ceux et celles qu’on rejette et dont on a peur. Quand deux peuples se disputent sur des questions de pouvoir, de territoires et de ressources – comme on le voit dans plusieurs pays –, leur humanité n’a plus d’espace pour s’exprimer. Leurs préjugés les empêchent de voir leurs similitudes fondamentales: comment on doit travailler pour se tailler une place dans le monde, comment on s’aime, comment on fait ses deuils… Bref, tous les plaisirs et douleurs de la vie.
Une fois qu’on a compris à quel point les peuples partagent des traits communs, leurs différences paraissent dès lors insignifiantes; et pourtant, c’est sur ces différences que se fondent les préjugés racistes. Il existe une grande beauté dans la différence, une beauté que j’apprécie davantage avec le temps, une riche diversité de façons de penser et d’être sur Terre. Ces perspectives peuvent nourrir notre créativité et nous inspirer de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes.
Pourtant, quand il s’agit des grandes questions que l’on se pose sur l’existence, on veut se persuader qu’on a raison, que notre groupe d’appartenance, parmi les millions qui ont existé sur Terre, a trouvé la seule et bonne façon de vivre. Quelle arrogance! Et quelle ignorance de l’histoire! On persiste tout de même à proférer à la face du monde qu’on a raison, avant même d’avoir écouté d’autres points de vue ou expérimenté d’autres façons de vivre.
Alors, le silence. Plusieurs aspects de notre culture réduisent tous ceux qui sont différents au silence. Les médias ont tendance à nous montrer surtout ce qui est négatif chez les autres et cela nous incite à les percevoir comme un groupe, pas comme des individus. Si un Blanc commet un vol, je ne dis pas spontanément: «Les Blancs sont comme ça. Ils sont des voleurs.» Mais quand une personne faisant partie d’un groupe marginalisé fait un vol, on réagit tout de suite en affirmant: «Ils sont comme ça. Ce sont des voleurs!» On efface toute la richesse de leur individualité.
Le problème, c’est que la voix d’un groupe est en vérité la voix de tous les individus qui le constituent et si on refuse d’accepter qu’un groupe est composé d’une diversité d’individus, on nie la possibilité d’entrer en communication avec eux. C’est pour ça que l’article du Journal de Montréal m’a tant choqué. La journaliste ne parlait pas d’individus. Elle faisait une généralisation outrancière sur les Autochtones et leurs valeurs, pourtant diverses et complexes. Elle aurait pu écrire sur les actions de quelques individus particuliers ou sur une loi à laquelle elle est opposée, en expliquant son point de vue. Et elle aurait pu poser des questions à des Autochtones bien placés pour y répondre. Au lieu de cela, son article a eu pour effet de réduire les peuples autochtones à une caricature et de renforcer le racisme, car le racisme est toujours basé sur la simplification. Pour les Autochtones qui essaient de se faire entendre et qui luttent quotidiennement contre les stéréotypes et les préjugés, l’article n’était qu’un autre signe de fermeture de la part des Allochtones. Et pour les racistes du Québec, ceux qui se sentent justifiés d’entretenir des idées négatives sur les Autochtones, l’article ne faisait que confirmer leurs croyances, sans ajouter de nouvelles informations ou offrir d’autres perspectives. Je ne m’attends pas à ce qu’on soit tous d’accord, seulement qu’on accepte d’écouter les voix différentes sans tomber dans une généralisation réductrice.
C’est pour cette raison qu’on s’écrit, Natasha: pour briser la frontière du silence. Peut-être que «silence» n’est pas le mot juste, ici, car c’est plutôt les voix d’un peuple qui étouffent celles d’un autre. Les Allochtones entendent surtout ce qu’ils disent eux-mêmes. Comme cette auteure au Salon du livre de la Côte-Nord qui a pris son livre pour te lire la définition d’un «Amérindien»… Sûrement qu’il était rassurant, pour elle, d’entendre des choses qu’elle pense déjà. Cela la confortait dans ses idées. Entrer en discussion avec d’autres aurait été plus difficile. S’ouvrir à d’autres points de vue est souvent déstabilisant et, pour bien le faire, il faut avoir de l’humilité et du respect pour ceux et celles qui n’ont pas la même histoire et qui ne voient pas le monde de la même façon que nous.
Alors, vos peuples, Natasha, de quoi se méfient-ils? Comment perçoivent-ils les Allochtones? En ont-ils peur? Et, si oui, comment vivent-ils cette peur et ce silence?
Iame uenepeshish,
Deni
P. S. Qu’est-ce que ça veut dire, «nuitsheuakan»?
4
Mon cher Deni,
«Nuitsheuakan» signifie mon ami.
Chez nous, se réjouir de voir l’autre va de soi. Il n’y a pas d’autres façons d’être. Être Innu. Je ne sais pas comment l’expliquer. Peut-être voulons-nous éviter les énergies négatives. Lorsque nous sommes heureux, nous parlons fort, nous rions fort et nous rions tout le temps. Lorsque nous sommes tristes, ...
Table des matières
- Couverture
- Kuei, je te salue
- Crédits
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Chronologie des évènements
- Quelques mots d’Innu-aïmun
- Questions à l’intention des jeunes
- Notes
- Titres de la même collection