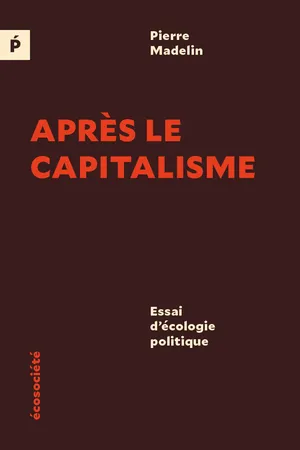![]()
1 Que se passe-t-il ?
SI LES DEUX GUERRES MONDIALES, l’extermination des Juifs d’Europe, l’explosion des bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki et la décolonisation figurent parmi les événements les plus marquants du XXe siècle, la crise écologique mondiale en sera certainement l’avènement décisif, plaçant l’humanité dans une situation sans précédent. Pour paraphraser la brillante formule de Günther Anders, disons que si le progrès nous avait jusqu’à présent promis l’avènement d’un royaume sans apocalypse, il nous menace désormais d’une apocalypse sans royaume. Car l’on peut dire sans exagération de cette crise protéiforme – dont le réchauffement climatique, la sixième extinction massive des espèces ainsi que la prolifération des nuisances et des autres pollutions sont les traits les plus saillants – qu’elle est le plus grand défi auquel ait jamais été confronté l’homo sapiens dans toute son histoire. Même si elle ne menace probablement pas les conditions de possibilité matérielles de la survie de l’humanité en tant qu’espèce (sauf dans le cas où se réaliseraient les prévisions les plus pessimistes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – GIEC, qui appréhendent un réchauffement de six degrés en 2100), elle risque non seulement d’exacerber les inégalités et les conflits sociaux, mais aussi de renforcer la concentration des pouvoirs politiques et de détruire durablement les conditions biologiques et sociales nécessaires à l’épanouissement des facultés physiques, intellectuelles et spirituelles de l’ensemble des êtres humains.
Bien qu’elle affecte durablement de nombreux écosystèmes, espèces et composantes de la nature, et si nous sommes par ailleurs convaincu qu’il est nécessaire d’accorder à ceux-ci une valeur intrinsèque, indépendante de l’utilité qu’ils présentent pour les êtres humains, cette crise n’est cependant pas une crise de la nature. À l’échelle du temps long de l’histoire, la capacité de la Terre à se régénérer et à se réinventer n’est pas menacée. Ce qui est menacé, c’est la capacité des écosystèmes à s’autorégénérer à un rythme suffisamment rapide pour que la Terre puisse continuer à être habitable pour les êtres humains. Car même la durée de vie des déchets nucléaires, qui s’étend pour certains sur plusieurs centaines de milliers d’années, ce qui est évidemment considérable à l’échelle de l’histoire humaine, n’est rien à l’échelle des temps géologiques. Cette crise est une crise de l’humanité ou, pour le dire autrement, de la civilisation.
C’est donc bel et bien dans une perspective anthropocentrée qu’il convient de repenser notre relation au monde, à condition toutefois que l’anthropos de cet anthropocentrisme ne soit pas réduit à l’Homo œconomicus, au calculateur rationnel et utilitariste qui est l’objet exclusif de l’anthropologie philosophique moderne. Il nous semble en effet qu’une grande partie de la philosophie de l’environnement, en insistant sur la critique de l’anthropocentrisme, a cédé au fantasme d’une humanité indifférenciée. Or l’humain qui «triomphe» dans l’anthropocentrisme moderne n’est pas n’importe quel humain: c’est un être mutilé, amputé, atrophié. Car en instituant un rapport au monde fondé sur la domination et l’instrumentalisation, et en réduisant la nature à la qualité de marchandise, l’anthropocentrisme moderne réduit également l’humain à son agir technique et économique, occultant par là-même les autres potentialités de son être (sociales, poétiques, spirituelles, etc.). En outre, la destruction de la nature implique aussi la destruction de la qualité du monde vécu par l’être humain, ce qui l’affecte lui aussi directement. Si l’on veut qu’une relation à la nature fondée sur le respect et sur la gratitude se substitue à une relation fondée sur la domination, il n’est donc pas suffisant de revaloriser la nature et de remettre l’être humain à sa juste place, il est également indispensable de redéfinir son humanité dans un sens moins restrictif.
Même si l’expansion démographique n’y est sans doute pas entièrement étrangère, comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin, la crise écologique résulte avant tout d’un imaginaire de domination rationnelle du monde. La généalogie de cet imaginaire fait encore débat, mais on s’accorde généralement à penser qu’il se met définitivement en place avec l’avènement de la science et de la philosophie modernes, notamment dans les œuvres de Francis Bacon et de René Descartes. La phrase programmatique et mille fois citée du philosophe français, «nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature», portait en elle le germe de ce que serait par la suite l’aspect déterminant du capitalisme naissant dans sa relation à la nature: considérer celle-ci comme un ensemble de ressources ou de matières premières manipulables et exploitables à l’infini sous forme de marchandises.
Une révolution paradigmatique est donc nécessaire pour rompre avec cet imaginaire, ses présupposés et ses corollaires: arraisonnement de la nature à la technique, métaphysique du progrès, idéologie de la croissance et du développement, etc. Nous pensons, même si nous avons conscience qu’il s’agit d’une affirmation discutable tant les résistances académiques sont encore nombreuses, que cette révolution paradigmatique est en marche. En Allemagne (Anders, Jonas, Hösle, etc.) comme en France (Charbonneau, Gorz, aujourd’hui Descola ou Pelluchon, pour n’en citer que quelques-uns), en Scandinavie (Naess) comme aux États-Unis (Leopold, Shepard, Bookchin, Cronon et bien d’autres), en Amérique latine (Boaventura de Sousa, Leonardo Boff, etc.) comme en Asie (Vandana Shiva par exemple), de plus en plus de penseurs admettent que «la vision moderne du monde a tiré sa révérence» et «qu’une autre, encore à l’état d’ébauche, émerge petit à petit» (Callicott). Ces penseurs sont évidemment très différents, et ils se sont parfois critiqués sévèrement les uns les autres, mais ils partagent néanmoins une vision du monde où, pour le dépeindre à grands traits, la conception mécanique de la nature cède la place à une Terre vivante, où l’être humain n’est plus une créature autosuffisante surplombant une planète-objet, mais un être en relation avec une communauté socioécologique qui le constitue et le dépasse.
Dans le présent ouvrage, nous ne prétendons pas apporter une pierre à l’édifice de cette indispensable révolution paradigmatique, mais nous pensons que cette transformation majeure de nos imaginaires demeurera ineffective si elle ne s’accompagne pas d’une révolution sociale et politique. Or rien n’indique que celle-ci, pourtant indispensable et urgente, est imminente. C’est donc avant tout à l’examen des possibilités «révolutionnaires» (au sens politique du terme) du présent et des différentes stratégies et scénarios qui s’offrent à nous que ces pages sont consacrées. Nous avons bien conscience que la crise écologique plonge ses racines dans un passé lointain: pour certains le christianisme et plus largement le monothéisme, pour d’autres la révolution néolithique ; pour d’autres encore les comportements écocides sont consubstantiels à l’espèce humaine, comme l’atteste l’extinction de la mégafaune provoquée par les populations du pléistocène. Si elle n’est donc pas exclusivement liée à la dynamique du capitalisme, c’est bel et bien cette dynamique qui est aujourd’hui le principal facteur de dévastation de la Terre. D’un point de vue politique, et en amont des nécessaires reconfigurations intellectuelles que nous avons évoquées, c’est le capitalisme qui doit être désigné comme l’ennemi à abattre.
Depuis l’effondrement de l’Union soviétique et la fin de la guerre froide, dans lesquels certains ont voulu voir la fin de l’histoire, le capitalisme, quel que soit le système politique auquel il se trouve associé, a triomphé à la surface de la Terre, devenant ainsi le seul dispositif techno-économique encore porteur de cet imaginaire de domination rationnelle du monde. Par conséquent, seules une rupture et une sortie du capitalisme pourront nous permettre de réinventer une relation moins conflictuelle avec la Terre, en mesure d’assurer à l’ensemble des êtres humains des conditions de vie décentes. Sortie de la crise écologique et sortie du capitalisme peuvent donc être considérées comme synonymes, à condition bien sûr que le capitalisme ne soit pas remplacé par un autre système porteur de ce même imaginaire, comme ce fut le cas au cours des expériences «socialistes» du XXe siècle. Toute réflexion politique se voulant radicale mais ignorant la question écologique se condamne au ridicule, et toute écologie politique réformiste ou «environnementaliste» qui se limiterait, par exemple, à mettre en place des politiques de protection de la nature se condamne à l’impuissance.
Néanmoins, l’histoire n’est pas un processus unilatéral. Identifier l’avènement d’un imaginaire de domination rationnelle du monde au début de ce qu’il est convenu d’appeler la modernité et tenir cette rupture pour l’une des causes de la situation présente de l’humanité n’exigent pas de substituer à une philosophie du progrès une philosophie du déclin, comme si l’évolution des sociétés humaines depuis quatre siècles devait être condamnée dans son ensemble. Jean-Claude Michéa a exprimé cette position de façon brillante dans L’empire du moindre mal:
Il ne s’agit plus d’envisager la modernité comme une étape nécessaire et cohérente de l’évolution historique, qu’il faudrait par conséquent accepter ou rejeter en «bloc». Il convient, au contraire, de la considérer dans sa complexité contingente et d’en démêler les lignes de force et les articulations afin de distinguer, autant qu’il est possible, ce qui, en elle, émancipe les hommes et ce qui les aliène (et donc, par contrecoup, ce qui dans l’héritage du passé peut ou doit être préservé).
En réalité, l’on pourrait dire avec Cornelius Castoriadis que la modernité est traversée par une tension entre deux grandes significations imaginaires: une de domination rationnelle du monde, que nous venons d’évoquer, et une d’autonomie. Pendant longtemps – c’est tout le sens des philosophies progressistes de l’histoire – l’on a pensé que ces deux significations imaginaires étaient indissociables l’une de l’autre, que l’émancipation des êtres humains passait nécessairement par la soumission de la nature. Aujourd’hui, nous savons qu’il n’en est rien. Non seulement l’autonomie se trouve menacée là même où elle s’était affirmée avec le plus de vigueur depuis deux siècles, c’est-à-dire dans l’espace politique (quelles que soient les imperfections de la «liberté» dans les régimes libéraux, la laïcité marque bien une autonomie du politique par rapport au religieux, les libertés fondamentales une autonomie de l’individu par rapport au corps social, etc.), mais notre maîtrise croissante de la nature et l’avancée du capitalisme qui l’accompagne détruisent également l’autonomie des individus et des sociétés dans leurs espaces domestiques et communs, comme s’est employé à le montrer Ivan Illich dans l’ensemble de son œuvre.
Jamais société n’avait porté l’étendard de la liberté avec autant d’ardeur et jamais pourtant elle n’avait détruit avec autant de zèle les formes concrètes de la liberté et de l’autonomie. Jamais en effet notre vie quotidienne n’avait été à ce point asservie à des structures hétéronomes ; aujourd’hui, la satisfaction du moindre de nos besoins fondamentaux – l’eau, l’électricité, l’habitat, la nourriture, le chauffage… – est tributaire de systèmes politiques, industriels et économiques complexes et fragiles sur lesquels nous n’exerçons aucun contrôle. Non seulement l’autonomie n’est pas la fille du progrès des sciences et des techniques, mais il semble au contraire que chaque progrès dans la possession de la nature s’accompagne d’une avancée proportionnelle dans la dépossession de la capacité des individus et des communautés à assurer eux-mêmes leur reproduction matérielle et symbolique.
En critiquant l’héritage de la signification imaginaire de domination rationnelle du monde, tout en assumant celui de la signification imaginaire de l’autonomie, l’écologie politique s’affirme clairement comme une réflexion critique de la modernité sur elle-même, et non – la nuance est cruciale – comme une critique de la modernité en soi, comme le voudraient ceux et celles qui entendent la réduire à une pensée réactionnaire. Critique, parce que tout en admettant que l’ordre social est toujours auto-institué et en refusant l’hétéronomie caractéristique des sociétés traditionnelles et religieuses, l’écologie politique s’oppose au projet moderne d’une table rase et d’une autofondation rationnelle de la société qui ne tiendrait pas compte des relations socioécologiques qui nous constituent: s’il ne peut y avoir de table rase ou d’arrachement définitif au passé, c’est au premier chef parce que toute société est structurellement dépendante d’une réalité qui la précède et dont elle hérite indépendamment de sa volonté, c’est-à-dire de façon hétéronome: la nature. Moderne, parce que l’écologie politique ne considère pas pour autant que cette réalité irréductiblement hétéronome qui est au cœur de toute vie humaine doive fonder les institutions sociales et parce qu’elle demeure au contraire attachée à la perspective proprement révolutionnaire d’une transformation radicale de la société.
Toute attitude révolutionnaire authentique impliquera néanmoins une dimension conservatrice parce que son but premier devra être de conserver le monde en tant que monde, en le préservant du «bouleversement incessant» et destructeur auquel la logique capitaliste le soumet. Car «ce qui distingue l’époque bourgeoise de toutes les précédentes, c’est le bouleversement incessant de la production, l’ébranlement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l’instabilité et du mouvement», le triomphe de ce que Zygmunt Bauman a nommé la «vie liquide». Aussi la révolution ne doit-elle plus être conçue comme un processus d’accélération de l’histoire, de nécessaire «liquéfaction» de tout ce qui manifeste encore une forme de permanence.
Toutes les sociétés humaines étant historiques, c’est-à-dire marquées par un processus d’auto-altération et traversées par des conflits, des tensions et des mutations significatives, il ne s’agit pas d’opposer de façon tranchée une modernité dynamique à une tradition statique ou encore des sociétés chaudes à des sociétés froides. De même, il n’existe pas d’ordre immuable dans la nature, mais plutôt un ensemble d’évolutions géologiques, climatiques, biologiques et écologiques constantes, même si elles demeurent le plus souvent imperceptibles aux êtres humains.
La révolution ne doit pas non plus être conçue comme une «opération de remise en ordre», pour reprendre une expression de Charles Péguy, ou comme l’établissement d’un ordre social enfin respectueux de l’ordre naturel. Il ne peut y avoir d’ordre définitif ni dans la nature ni dans l’histoire humaine, ni dans un passé qu’il faudrait rétablir ni dans un futur qu’il faudrait instaurer. L’histoire humaine et l’histoire naturelle ne forment pas une succession d’étapes débouchant sur un climax, aussi ne peuvent-elles avoir de terme. Dans une perspective écologiste, l’attitude révolutionnaire doit se comprendre non seulement comme un nouveau rapport à l’espace et aux lieux, comme une «respatialisation» et une «reterritorialisation» de notre rapport au monde, mais aussi comme l’invention d’une temporalité nouvelle, qui ne soit pas celle de la «vie liquide» du capitalisme.
![]()
2 «Le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle»
Le monde moderne est essentiellement parasite. Avec un aplomb imperturbable, le monde moderne vit presque entièrement sur les humanités passées, qu’il méprise et feint d’ignorer. La seule fidélité du monde moderne, c’est la fidélité du parasitisme, car il ne tire sa force, ou son apparence de force, que des régimes qu’il combat, des mondes qu’il a entrepris de désintégrer.
– CHARLES PÉGUY
NOUS NE SOMMES PAS spécialiste des dynamiques économiques complexes du capitalisme, notamment en matière de spéculation financière, et nous ne prétendons pas apporter une réponse tranchée et assurée à la question de savoir si le capitalisme est entré dans une période de crise dont il ne se remettra pas. Au vu des nombreuses erreurs qui ont émaillé l’histoire des pronostics portant sur la fin du capitalisme, on peut de toute façon douter que quiconque soit véritablement qualifié pour répondre à cette question. Dans ce chapitre, il s’agira donc avant tout de confronter des opinions divergentes et de présenter une position personnelle sans prétention à faire autorité sur les contradictions et les contraintes systémiques inhérentes au système capitaliste. Schématiquement, on peut dire que les penseurs contemporains distinguent trois limites possibles à la reproduction de ce système:
- Une limite/contradiction interne. Pour des théoriciens comme Imanuel Wallerstein, Paul Jorion et Anselm Jappe (dont les perspectives sont par ailleurs très différentes), le capital...