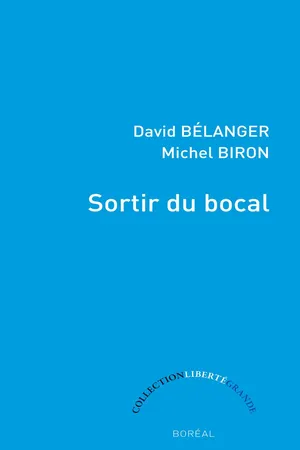![]()
Par rapport au déchirement, l’ironie est l’annonce d’une harmonie possible ; et par rapport à l’harmonie, c’est la conscience d’un déchirement réel. L’ironie indique toujours l’envers de la médaille.
Italo Calvino, Ermite à Paris
![]()
1er mai 2020
Cher David,
Comme je te l’ai indiqué dernièrement, j’ai eu le goût de mettre par écrit certaines réflexions à partir de nos discussions de corridor autour de l’ironie dans la littérature contemporaine, en particulier au Québec, où elle me semble devenue une sorte de basse continue, même si j’entends de plus en plus parler de « post-ironie ». Au départ, j’avais des notes, que j’ai ensuite tenté d’organiser comme pour un article ou une communication. Puis je ne sais pas trop pourquoi, sans doute en raison du confinement, j’ai senti le besoin de m’adresser à quelqu’un, de cesser d’écrire dans le vide ou pour quelque lecteur abstrait. Et donc j’ai repris mon texte sous forme de lettre adressée à un certain David Bélanger, jeune stagiaire postdoctoral, romancier, nouvelliste, critique, auteur d’une thèse passionnante sur la littérature québécoise contemporaine. Il me semble t’avoir déjà cité l’exemple de l’échange épistolaire entre les critiques Gilles Marcotte et André Brochu, paru en livre sous le titre La Littérature et le Reste . C’était une autre époque, bien sûr : le courrier électronique n’existait pas, les Canadiens gagnaient Coupe Stanley après Coupe Stanley, les Expos de Montréal n’étaient pas très bons, mais ils étaient beaux à voir. La littérature québécoise était toute pimpante, comme surprise d’exister à ce point, et les deux professeurs d’université pouvaient partir de la ferveur générale pour parler de tout et de rien. Nous n’habitons plus un tel monde, mais j’aime la formule ancienne de la lettre, qui permet de penser en parlant à quelqu’un, à un lecteur « de qualité », lui-même un auteur qui, s’il accepte le jeu, pourrait répondre, donc relancer la réflexion. Comme ça, la critique redevient une chose vivante plutôt que cette espèce d’épouvantable soliloque qu’elle est devenue dans nos innombrables événements « savants ». Je suis vraiment curieux de m’adresser à un vrai lecteur, de surcroît un lecteur d’une autre génération, peut-être même d’une autre sensibilité littéraire ou intellectuelle. Un lecteur qui m’interdise de prendre de haut la littérature d’aujourd’hui, puisque cette littérature, quelles que soient la signification et la valeur qu’on lui donne, constitue notre monde.
Mon but n’est pas d’arriver à une lecture consensuelle ni d’avoir raison, mais de sortir de l’ornière de la critique « monologique » ou de la critique de type « chambre d’échos », celle qui ne s’adresse finalement qu’à des semblables, à des gens qui pensent tous à peu près la même chose. Je dirais que mon but est simplement de trouver un interlocuteur « substantiel », comme René Char parlait jadis des « alliés substantiels ». J’insiste : un interlocuteur qui ne me ressemble pas trop, qui ne vient pas du même sérail, qui m’oblige à sortir de mon milieu habituel – sans me forcer à me renier pour autant, tu le devines bien. Tu me diras que nous nous ressemblons quand même beaucoup : deux universitaires francophones, spécialistes de littérature québécoise, deux hommes blancs, hétérosexuels, deux Québécois dits de souche, discutant ensemble de livres écrits surtout par des Québécois blancs… C’est vrai. On ne pourra pas changer ces données biologiques ou sociologiques, et peut-être sommes-nous d’emblée disqualifiés du fait même que nous parlons depuis un « lieu commun ». Mais la différence générationnelle est pour moi déterminante, et l’exercice que je propose me semble à la fois difficile et stimulant, du moins à titre exploratoire.
Je pars d’un livre que tu connais bien : Document 1 de François Blais, paru en 2012 à L’Instant même. Ce roman fait partie des vingt meilleurs romans québécois publiés depuis l’an 2000, selon la revue L’Inconvénient. C’est toi-même qui as rédigé la justification de ce choix dans le palmarès : je présume donc que tu aimes ce roman et que, si tu avais à écrire l’histoire de la littérature québécoise contemporaine, tu lui réserverais une place importante. Dans ta thèse, il faisait d’ailleurs partie de la trentaine d’œuvres de fiction que tu as analysées – et François Blais, sauf erreur, s’y taillait la part du lion, puisque quatre autres de ses romans (Nous autres ça compte pas, La Nuit des morts-vivants, Sam et Cataonie) se trouvaient dans ton corpus. Rien de plus normal : il est beaucoup question de littérature dans l’œuvre de François Blais, particulièrement dans Document 1, et tu traitais précisément de la représentation de la littérature dans ta recherche. L’occasion est belle, me semble-t-il, non pas de revenir sur ta thèse, dont j’ai déjà eu l’occasion de souligner l’originalité et l’audace puisque j’ai été membre de ton jury de soutenance, mais de réfléchir à ce que devient la littérature, justement, à l’ère contemporaine.
Ta brève présentation de Document 1, dans L’Inconvénient, se conclut par ces mots : « Voilà en quoi le roman fascine. » Tu parles d’un « rapport libéré à la littérature » et je sens bien, à te lire, à quel point cette libération t’apparaît salutaire. Comme si la littérature avait été jusque-là une prison, une contrainte, une activité inauthentique ou conventionnelle, menée par des gens prétentieux et, dans plusieurs cas, socialement privilégiés, des gens qui auraient globalement bénéficié de conditions matérielles confortables – la question matérielle est au cœur de tes réflexions sur la littérature, et il faudra y revenir. Tu te dis fasciné par Document 1 et tu notes, au tout début de ton texte, que tu n’es pas le seul, car ce roman « suscite l’enthousiasme immédiat des étudiants en lettres ». Soit. Mais les autres lecteurs, ceux qui n’étudient pas la littérature, qu’en pensent-ils ?
Comme un zeugme partagé entre amis Facebook, l’ironie de François Blais amuse les littéraires. On y trouve toutes sortes de références à notre monde des lettres, aux éditeurs québécois en particulier et à quelques écrivains-vedettes, comme VLB ou Bryan Perro. Le ton est drôle, moqueur, à la limite du cynisme mais jamais grinçant, plutôt léger même. L’auteur écrit dans une langue vive, directe, pleine de tournures orales, de mots anglais, de remarques métatextuelles. Si un personnage emploie un terme un peu littéraire, comme velléitaire, le narrateur, ou plutôt la narratrice, en fait tout un plat. Quand celle-ci joue à faire des arabesques ou des acrobaties formelles, elle s’arrête, explique en long et en large en quoi consiste sa pirouette, comme s’il s’agissait de mettre le lecteur bien à l’aise, de lui dévoiler les trucs du métier, de ne rien lui cacher. No « bullshit », pour emprunter un mot qu’aime bien François Blais. Ne pas se prendre pour un autre, ne pas jouer à l’écrivain : telle est la règle de base de ce roman par ailleurs archi-littéraire, d’où l’ironie constante et les adresses répétées à un lecteur lui-même amateur d’ironie.
Je résume ce roman pour moi-même, pour te montrer ce que j’en ai retenu ; tu me diras si j’oublie quelque chose d’important. Il tourne autour d’un vrai projet de faux récit de voyage, intitulé par défaut « Document 1 » comme tout nouveau fichier Word. Écrire « par défaut », c’est l’ironie même que pratique François Blais, qui choisit de ne pas choisir, qui accepte la réalité telle qu’elle s’offre à lui, sans y adhérer mais sans la rejeter non plus. Cette écriture « par défaut » ne cherche pas à être originale, scandaleuse. Bas les masques ! semble-t-elle dire constamment. Mais c’est une écriture rusée, qui sait très bien que la représentation symbolique du réel est une affaire compliquée, pleine de pièges. Et qu’écrire pour écrire ne rime à rien : c’est aussi pour cela que j’écris ceci en m’adressant à toi, en ayant un vrai lecteur en tête, comme au temps pas si lointain où on écrivait de vraies lettres. Jacques Brault note dans Au fond du jardin (1996) : « Écrire à quelqu’un : c’est une définition de la lettre ; que l’on moque ces temps-ci ; tant pis. Comment ne pas écrire à quelqu’un ? »
Autre parenthèse : je me demande si, en t’écrivant, je n’écris pas aussi à l’auteur, à François Blais lui-même, que je ne connais pas du tout. J’ai l’impression qu’un immense fossé s’est creusé entre les praticiens et la critique. À une époque pas si lointaine, les écrivains et les critiques habitaient le même monde, ils parlaient le même langage. Gilles Marcotte a accompagné les écrivains de la Révolution tranquille, non pas du haut de son magistère mais à leur côté. Et il n’y avait pas alors un océan entre la critique journalistique et la critique savante (la subventionnée, celle qui s’organise en vastes équipes, comme celles des laboratoires scientifiques). Curieusement, aujourd’hui, alors que tant d’écrivains sont passés par l’université (est-ce le cas de François Blais ? Sur Wikipédia, on ne mentionne rien de sa vie, sinon qu’il est né le 3 janvier 1973, qu’il cumule les petits métiers dans la région de Grand-Mère, en Mauricie, où il vit depuis toujours), je ne vois rien qui ressemble à la critique d’accompagnement qui se pratiquait jadis. Mais tu me diras que je suis « déconnecté » du monde d’aujourd’hui, n’étant pas sur Facebook, ne suivant l’actualité littéraire qu’à la manière ancienne, par le truchement des livres imprimés, des journaux, des revues, et en t’écrivant une lettre comme le faisaient les anciens Canadiens.
Je reviens à nos moutons. L’écriture de François Blais, je le répète, est en apparence très simple, limpide, accessible, décontractée, décomplexée, comme on le dit souvent de la prose contemporaine au Québec. Elle ne craint ni les anglicismes, ni les gros mots, ni même les maladresses. À ce propos, j’avoue que j’ai trébuché plus d’une fois en m’accrochant les pieds dans des phrases à la syntaxe incongrue, comme ici : « On ignore quel était le nom en question, pas plus que le motif du refus. » Mais passons. Ce que tu apprécies dans cette prose allègre et que je trouve moi aussi souvent sympathique, c’est qu’elle sait d’où elle parle, elle connaît les conventions qui la sous-tendent. Il ne suffit pas de dire qu’elle en joue, comme on l’a dit d’à peu près toute la littérature moderne et postmoderne. Curieusement, l’écriture y semble d’autant plus souveraine (ou libre) qu’elle s’amuse à se déclarer servile, à copier des modèles. L’écrivain hérite d’un siècle et demi d’autonomie littéraire, mais il tient à présent à ce que l’écriture performe. Non pas au sens où elle doit éblouir, plutôt au sens pragmatique : écrire, c’est faire, pour pasticher un titre célèbre.
Dans le cas de Document 1, François Blais attribue une fonction explicite à l’écriture, et c’est seulement à défaut d’une autre solution que les deux personnages principaux s’emparent de cet outil – car l’écriture est ici véritablement un instrument – auquel ils n’avaient pas du tout songé au départ. L’écriture se révèle à la fois centrale et secondaire : on n’y arrive que par un chemin détourné, qui n’a rien à voir avec la gloire littéraire ni même avec le rêve de faire de l’écriture un métier. L’intrigue se résume à trois fois rien : les deux personnages sont malheureux et rêvent tout bonnement de s’évader, de faire un voyage, un road trip à la Kerouac, mais ils calculent avoir besoin de dix à quinze mille dollars pour y parvenir. L’argent, je l’ai signalé, est important chez François Blais, qui nous ouvre les livres pour ainsi dire en nous dévoilant le salaire de la narratrice, employée à temps partiel chez Subway (grosso modo mille dollars par mois), de même que le montant de la prestation mensuelle que touche son compagnon, qui vit « sur le bien-être social ». Ensuite viennent les calculs des dépenses fixes (le compte d’Hydro-Québec, le loyer, etc.), les coûts d’une chambre pour deux, d’une voiture d’occasion, etc. Surgit alors « l’idée du siècle » pour financer leur projet : ils vont demander une bourse d’écriture en proposant de raconter leur voyage. L’écriture, pour eux, est donc tout entière subordonnée au désir de partir quelque part en Pennsylvanie, dans un lieu choisi au hasard pour son nom étrange (Bird-in-Hand), un lieu sans intérêt touristique, retenu lui aussi « par défaut », pour le plaisir de jouer avec les mots. Une boucle paradoxale se forme : l’écriture renonce à son prestige, elle devient instrumentale avec le plus grand enthousiasme, mais les mots n’en sont que plus déterminants, au point où seule leur réalité compte vraiment aux yeux des deux « héros », un peu comme l’Amérique de papier que traversait Jack Waterman, le héros de Jacques Poulin dans Volkswagen Blues, une Amérique irréelle, peuplée de fantômes, de bibliothèques, de fantasmes ; une Amérique non pas livresque mais saturée de symboles d’une Histoire enfouie ; mais je m’égare, ce pourrait être le sujet d’une autre lettre.
Le roman de François Blais se lit donc comme une parodie de récit de voyage. Un clin d’œil à Kerouac, une plongée dans une certaine Amérique à la fois archi-littéraire et populaire. Mais nous n’irons pas à Bird-in-Hand, le projet échouera, comme de raison. Les deux personnages sont des losers, sympathiques certes, mais surtout des losers ordinaires, incapables de s’élever à la hauteur des héros de la beat generation. Ils savent bien qu’ils n’appartiennent pas à cette époque glorieuse, ils savent qu’ils arrivent après. La découverte de l’Amérique, ils la font depuis chez eux, en « googlant », en se promenant sur certains sites web comme « familywatchdog.us », qui indique les adresses de toutes les personnes condamnées pour crimes sexuels, en dressant des listes des noms de ville les plus étonnants (comme Why, Climax, Boring, etc.), en comparant les plus grands centres commerciaux du continent (« Ah ! voir Pumkin Center et mourir ! »). Leur Amérique est médiocre comme tant de petites villes québécoises. Devant le centre-ville de Phoenix sur Google Street View, ils s’exclament : « Ouache ! C’est donc bien laid, Phoenix : on dirait Trois-Rivières-Ouest avec des palmiers ! » Mais rien ne les décourage, ils ne rêvent pas de refaire Kerouac : ils vivent et écrivent après lui. Ce n’est ni une chance ni une malédiction : c’est ainsi. Il y a dans l’ironie impondérable de François Blais non pas de la nostalgie ou de la colère mais un désir de lire le monde tel qu’il est devenu, sans mépris et sans lyrisme.
Les protagonistes incarnent une Amérique à la fois virtuelle et bien réelle. Ils sont deux, comme André et Nicole dans L’Hiver de force de Réjean Ducharme, auxquels ils font en effet beaucoup penser, mais leurs prénoms viennent de plus loin : elle s’appelle Tess ; lui, Jude. Ils n’ont pas de nom de famille. Les références aux deux romans de Thomas Hardy (Tess d’Urber...