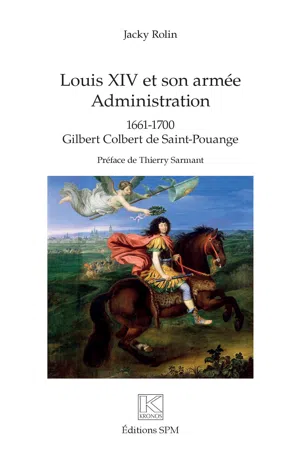![]()
CHAPITRE I
Logement et contributions
Ainsi que l’écrit Jean-Jacques Clamageran : « Depuis le Moyen Âge la monarchie française a pris l’habitude de confier à des particuliers la perception de certains revenus, surtout les impôts indirects, selon le procédé de la ferme1. »
Il précise que de 1598 à 1653, soit en 55 ans, on compte cent quatre-vingt-dix-sept actes de fermage retrouvés dans différentes archives. Ce nombre correspond à plus de trois contrats passés entre l’État et des financiers par an. Il s’agit là d’une très vieille institution qui remonte au Moyen Âge et qui s’apparente au contrat de fermage agricole entre le propriétaire d’une terre et le fermier, homme libre, qui cultive une terre moyennant une certaine redevance à son propriétaire. Cette redevance généralement annuelle, peut être forfaitaire, ou calculée sur les produits des récoltes et élevages. Elle peut être versée en numéraires ou en nature.
L’affermage des perceptions de divers droits indirects et du paiement des fournitures de tous ordres fait l’objet de baux ou de concessions donnés à des financiers particuliers ou des compagnies de financiers qui signent des contrats avec l’État (en général en la personne d’un ministre ou du contrôleur général des Finances). Dans ces contrats appelés traités, les fermiers ou trésoriers s’obligent d’exécuter des opérations financières publiques pour le compte de l’État. Pour la perception des droits indirects, il s’agit de contrats d’affermage par lesquels le fermier s’engage à percevoir les impôts prévus au contrat, et d’en faire son affaire totale en employant à son compte les personnels dont il a besoin. Il doit verser dans les temps impartis, soit une somme globale forfaitaire (le fermage à forfait), soit la totalité de ce qu’il peut percevoir (fermage en régie). Dans le premier cas, le fermier bénéficie du surplus des fonds qu’il a pu prélever par rapport au forfait qu’il verse à l’État. Dans le second cas, qui est plus bénéfique pour le Trésor public, il ne garde pour lui qu’une somme déterminée, fixée à l’avance par le traité, et qui représente les intérêts que l’État laisse au traitant en fonction des fonds avancés. La pratique de l’affermage, qui dure jusqu’à la Révolution, est très critiquée parce qu’elle laisse à des personnes privées le soin de gérer des fonds publics. De plus les fermiers prélèvent plus que l’État ne perçoit, et enfin, ces perceptions donnent parfois lieu à des menaces, voire des violences de la part des percepteurs, qui sont les commis des fermiers et qui ont la réputation de n’avoir aucune pitié pour les contribuables. Les fermiers, financiers ou compagnies financières, chargés de percevoir les impôts indirects, disposent du droit d’entretenir de véritables milices privées, pour lutter contre toutes les fraudes et contrebandes (par exemple les gabelous qui traquent les faux sauniers au profit de la ferme de la gabelle). Ces gardes privés sont très souvent armés et n’hésitent pas à faire feu sur les contrevenants, et ceci sans aucun contrôle et en toute impunité dans le royaume. Tout est fait pour protéger les fermiers et leurs revenus. C’est ainsi que le 15 décembre 1670, le prince Eugène-Maurice de Savoie, comte de Soissons, colonel général des troupes suisses et des Grisons prend une ordonnance prescrivant :
« L’intention du Roy estant d’obvier aux abus qui pourroient arriver au grand dommage de ses fermes, et particulièrement de celle du sel, par ses gens de guerre tant François que Suisses, Nous, en conformité d’icelle, mandons à tous capitaines, et officiers, tant du régiment des Gardes Suisses, que des compagnies franches suisses ou grisonnes, estant sous notre charge et commandement, de tenir la main à ce que leurs soldats, ou autres dépendans, ne transportent du sel dans les villes, ou autres lieux de son royaume, où la gabelle y est établie, au préjudice desdites fermes, sous peine d’être punis. Défendons ausdits officiers de s’intégrer dans ledit transport du sel en manière quelconque ; Et leur enjoignons de souffrir la visite que les commis desdites fermes voudront faire dans leurs équipages, sans aucune contradiction et sous peine de désobéissance2 ».
Les droits ainsi accordés aux employés de cette ferme sont tels qu’un personnage aussi important, commandant des troupes très valeureuses, dont les hommes sont engagés dans une relation contractuelle avec le roi3, leur demande de ne pas se livrer au faux saunage, mais en plus leur donne l’ordre de laisser les gardes de la ferme du sel fouiller leurs bagages. En règle générale, les militaires ne répondent que devant la justice prévôtale, et en plus les gardes suisses bénéficient en matière de poursuites de garanties propres à leur statut particulier dans l’armée. Ces instructions du comte de Soissons, qui lui ont certainement été demandées par le roi, ou l’un de ses ministres, montrent quelle est l’importance accordée à cette ferme par le pouvoir royal. En 1682, la pression doit être encore plus forte de la part de la compagnie fermière, puisque une ordonnance royale défend aux cavaliers, dragons et soldats de commettre le faux saunage, sous peine des galères4. Il en est de même pour le tabac. En 1688, une ordonnance5 défend aux cavaliers dragons et soldats de se pourvoir en tabac ailleurs que dans les bureaux des fermes, et d’en acheter plus d’une once à la fois. Non contents d’obliger les militaires de se fournir dans les établissements des fermes, ils ne peuvent en acheter qu’environ une trentaine de grammes actuels. Cette mesure est établie afin qu’ils ne puissent organiser de commerce parallèle au sein de l’armée. Acheter de grandes quantités de tabac pour le revendre aux autres soldats, lorsque la campagne entraîne les troupes hors du royaume pourrait rapporter de bons bénéfices à un militaire. Il peut être surprenant qu’au moment où le royaume se lance dans une guerre vitale, ce genre de détail fasse l’objet d’un texte du niveau d’une ordonnance royale. Ces exemples montrent la pression que peuvent exercer les financiers détenteurs de contrats de fermage avec l’État. Un autre exemple de cette pression des fermes sur l’État se trouve dans l’ordonnance du 18 octobre 1690 : « Ordonnance portant défense expresse à tous militaires revenus dans le royaume et allant dans les lieux des garnisons et quartiers d’hiver, de se charger d’aucunes marchandises étrangères, tabac, ni de faux sel [sel de contrebande], et qui permet aux officiers, commis et gardes des gabelles et cinq grosses fermes de fouiller dans leurs équipages6 ».
Ces termes sont repris pratiquement dans les mêmes conditions en 1694 avec l’ordonnance qui « défend aux militaires français ou étrangers repassant en France de se charger de marchandises étrangères, tabac, ni faux sel et qui permet de fouiller dans leurs équipages7 ».
Les textes très comminatoires sont très précis quant aux pouvoirs accordés aux agents de ces fermes par rapport aux soldats qui viennent de se battre dans une guerre très dure. On peut imaginer que ces militaires ne doivent pas se laisser ainsi facilement contrôler. Il faut certainement de très gros moyens en personnels armés, et peut-être même des mises en garde de la part des officiers pour les contraindre à laisser ainsi contrôler leurs bagages.
La privatisation de la fiscalité indirecte débouche sur de très lourdes pertes de substances entre les versements des contribuables et les rentrées dans les caisses de l’État, mais elle n’est pas la seule source de déperdition pour le Trésor royal. L’appel aux financiers pour leur concéder les fournitures de matériels et de services nécessaires à la bonne marche de l’État entraîne également des pertes importantes de fonds publics. Or, il s’agit souvent des mêmes compagnies qui, fermiers, gèrent la fiscalité, et, concessionnaires en qualité de munitionnaires, assurent les dépenses pour les fournitures à l’armée. C’est ainsi que ces financiers, lorsqu’ils gèrent bien leurs affaires, gagnent sur les perceptions et sur les dépenses, toutes opérations effectuées au nom et pour le compte de l’État.
La situation des concessionnaires, fournisseurs de matériels, de nourriture, d’animaux ou d’armes est plus délicate que celle des fermiers dans la mesure où ces financiers doivent d’abord avancer les fonds pour respecter leur contrat et ensuite il leur faut se faire rembourser par le Trésor royal. En fait, comme le souligne Daniel Dessert8, le jeu de l’offre et de la demande par la voie des enchères est faussé pour les grandes fonctions financières du royaume tels que fermier général, trésorier général ou receveur général des finances.
Les compagnies financières qui traitent habituellement en qualité de munitionnaires font des propositions de contrat de fournitures, dans lesquelles sont précisées les quantités et qualités des produits à fournir, les délais et modes de livraison, les prix pratiqués et les modes de paiement. Il est clair que ces propositions de contrats ne sont pas fortuites et correspondent à des besoins réels des armées, parce que les financiers en sont informés. Ils apprennent souvent les besoins réels des troupes par les militaires avec lesquels ils sont en relation. Ils peuvent être informés directement par des agents du département de la Guerre, ou parfois par le ministre lui-même. Enfin, dans les familles et les cercles de relations, ces informations peuvent circuler très facilement. Dès lors, le financier peut faire ses offres de services au roi. Par exemple, le Conseil du roi du 22 novembre 1695 fait état de la réception d’une proposition d’un nommé Jean Marchand :
« Reçu par le Roy en son Conseil d’État, les offres et propositions faites par M. Jean Marchand, bourgeois de Paris de faire la fourniture des estapes aux troupes qui passeront et séjourneront l’année prochaine 1696 dans la généralité de Soissons, à raison sçavoir la ration de fantassin...