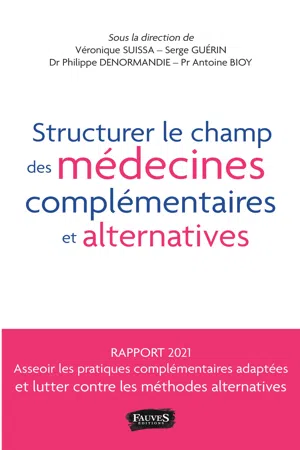![]()
1. CONTEXTUALISATION
GÉNÉRALE
![]()
1.1 État des lieux international :
un sujet porté par l’OMS et le Parlement européen
Impulsée par l’OMS (2002), une dynamique internationale en faveur de l’intégration des MCA se déploie, traduisant les évolutions scientifiques, culturelles et sanitaires qui s’opèrent dans le monde. À ce titre, il est important de rappeler que la Médecine Traditionnelle (MT) demeure une référence pour de nombreux pays émergents, tandis qu’elle a peu à peu perdu sa légitimité au profit du système médical officiel dans les pays développés. Cela étant, et tel que le soulève l’OMS (2014), les pays sont de plus en plus nombreux à prendre conscience des apports des médecines complémentaires sur la santé. Face à l’engouement mondial envers les Médecines Non Conventionnelles (MNC), les États engagent ainsi de nouvelles politiques en la matière et considèrent de façon croissante l’intérêt de leur intégration dans leur propre système de santé. Cependant, la législation dans le domaine reste variable d’un pays à l’autre conduisant à un processus complexe et inégal de redécouverte de certaines MCA traditionnelles ou contemporaines. Les traditions et cultures locales jouent aussi un rôle dans les approches déployées envers les MCA. Par conséquent, il existe un ensemble de divergences et d’approches étatiques selon trois systèmes répertoriés par l’OMS :
1. Un système intégratif (MNC reconnues et intégrées dans l’offre de soins) : les MNC sont remboursées, accessibles dans les structures de soins et s’insèrent dans la recherche et l’enseignement. Ex. : Chine, République de Corée, Vietnam…
2. Un système inclusif (MNC reconnues sans être intégrées dans tous les aspects de l’offre de soins) : les MNC sont accessibles sans pour autant être remboursées. Des moyens permettant d’assurer leur innocuité sont déployés, tandis que leur réglementation reste partielle, de même que les dispositifs d’enseignement et de formation. Ex. : Canada, Royaume-Uni…
3. Un système tolérant (centré sur la médecine occidentale tout en acceptant certaines MNC) : certaines MNC font l’objet d’une forme de tolérance de la part du système de soins s’illustrant par une dynamique d’intégration plus ou moins formelle. Ex. : France.
En Europe, devant les problématiques que soulève le manque de régulation des MNC, une proposition en faveur de leur encadrement est présentée en 1994 au « Comité pour l’Environnement, la Santé Publique et la Protection du consommateur »5. En 1997, un projet visant à encourager la reconnaissance des MNC sera adopté par la « Commission des Affaires sociales, de la Santé Publique et de la Protection du consommateur ». Finalement, une première résolution présentée le 29 mai 1997 sera adoptée par le Parlement européen6. Ce texte préconise une démarche européenne en la matière. Il rappelle que le système de soins dominant est celui de la médecine occidentale tout en soulevant l’intérêt d’un processus de reconnaissance des MNC qui auront fait la preuve de leur efficacité à travers des programmes de recherche qu’il préconise. Une seconde résolution sera adoptée par le Conseil de l’Europe le 11 juin 19997 permettant de renforcer la précédente. Le texte appelle ainsi à une intégration des MNC au niveau européen, fixe l’accès aux pratiques et incite au développement de la recherche.
Si l’adoption de ces résolutions ne comporte aucun caractère obligatoire, les principes régissant ces textes ont été le moyen pour certains États tels que la France, de se saisir du sujet et d’analyser la situation à l’intérieur de leurs frontières.
De nos jours et tel que le soulève la HAS (2006), si la réglementation des MNC peut varier d’un pays à l’autre, leurs conditions générales comportent dans leur principe de grandes similitudes. Schématiquement, deux conceptions opposées coexistent actuellement en Europe :
1. La première impliquant les pays du Sud : les MNC, dans leurs dimensions thérapeutiques, doivent être dispensées uniquement par certains professionnels de santé. Les praticiens sont principalement médecins, parfois issus d’autres professions pour lesquelles certains actes peuvent être pratiqués sous leur propre responsabilité ou celle d’un médecin. Au-delà, il y a exercice illégal de la médecine. Ex. : France, Belgique, Luxembourg…
2. La seconde engageant principalement les pays du Nord : les MNC peuvent être dispensées par tout praticien qui le souhaite, mais réserve certains actes aux médecins. Les médecins détiennent l’autorité en matière de politique de santé, tandis que les praticiens de MNC ont le droit de dispenser un soin non conventionnel dès lors qu’ils ne prétendent pas au titre de Docteur en médecine. Ex. : Pays-Bas, Grande-Bretagne, Irlande ou encore les pays scandinaves.
![]()
1.2. Situation nationale :
une double politique à l’œuvre
En France, l’attrait croissant des citoyens à l’égard des MNC conduit actuellement l’État à clarifier le statut de certaines d’entre elles. La légalisation le 4 mars 2002 de l’ostéopathie et de la chiropraxie illustre l’avènement de professions reconnues, autonomes et réglementées. Néanmoins, en n’étant plus exclusivement rattachées au monopole médical, ces deux spécialités ne sont pas pour autant totalement intégrées au système de santé. Dans une perspective analogue, l’acupuncture et l’homéopathie sont ainsi reconnues par le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) comme des orientations médicales. Réservées aux médecins et à certains professionnels de santé, ces pratiques se déploient en milieu médical, contribuant à l’essor d’une médecine plus intégrative. Cette démarche se renforce par le développement de formations universitaires et réglementaires à destination de professionnels du soin (ex. Diplôme universitaire) ou de praticiens non soignants (ex. formation inscrite au Répertoire national des Certifications professionnelles). C’est dans ce contexte que de nombreuses pratiques telles que la méditation, la sophrologie ou encore l’art-thérapie s’intègrent de façon croissante dans les centres sanitaires et médico-sociaux comme dans les associations et les réseaux de santé.
Par arrêté du 3 février 2009, la Direction générale de la Santé (DGS) fonde le Groupe d’Appui Technique (GAT) dédié à la prise en compte des Pratiques Non Conventionnelles à Visée Thérapeutique (PNCVT). Présidé par le Directeur Général de la Santé (DGS), ce groupe a pour mission la conception, la mise en œuvre et le suivi de la politique de repérage des PNCVT potentiellement prometteuses ou dangereuses. Les travaux du GAT permettront notamment la mise à disposition d’informations et de ressources documentaires ciblées destinées au grand public. Ils permettront également de renforcer les connaissances scientifiques de certaines de ces pratiques à travers la mise en place dès 2010 par la DGS, d’un programme pluriannuel d’évaluation confié à l’INSERM. Mais la cessation en 2020 des activités du GAT freine la réflexion salutaire initiée par le Gouvernement.
De plus, la temporalité sur le terrain n’est pas celle de la recherche. Les citoyens, et en particulier les patients, s’orientent de façon croissante vers les MCA tandis que le manque de régulation des pratiques et la disparité des formations des praticiens complexifient des orientations adaptées et personnalisées. Autrement dit, l’intégration de ces pratiques véhicule plus couramment une attitude de réserve chez les médecins. Le manque de clarification dans le domaine (évaluation, formation, réglementation, délimitation des interventions, etc.), mais également l’essor incontrôlé de pratiques douteuses, participent incontestablement à la confusion envers les MCA.
C’est dans ce contexte que se développe parallèlement une politique nationale essentielle de vigilance à l’égard de certaines de ces pratiques. Elle est portée par la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (Miviludes). L’instance a peu à peu investi le champ des MCA dans une logique de prévention et de répression des pratiques déviantes. En effet, la prolifération des mouvements sectaires dans le champ de la santé constitue une réelle menace pour les malades qui abandonnent parfois leurs traitements au profit de pseudo MCA. La question de l’emprise mentale, au cœur du phénomène sectaire, est un sujet majeur notamment lorsqu’elle engage la santé de personnes fragiles.
Mais les dérives de certaines MCA ne sont pas nécessairement de nature sectaire, elles relèvent le plus souvent de dérives thérapeutiques. En effet, si la majorité de ces praticiens n’a pas vocation à exercer une emprise mentale ou à se substituer à la démarche médicale, les théories parfois psychologisantes, les recommandations inappropriées ou les croyances mystiques issues de leurs méthodes interrogent sur l’instauration d’un cadre qui se veut thérapeutique. En outre, si les dérives sectaires en santé font l’objet d’une politique de vigilance, la question de la « dérive thérapeutique » impliquant certaines MCA reste actuellement peu investie.
En définitive, l’engouement des Français pour les MCA conduit à l’essor de la recherche et d’une politique nationale d’intégration tandis que le manque de régulation participe à l’émergence de méthodes douteuses et à la mise en place d’une politique de vigilance. Face à cette double réalité, l’enjeu de santé publique est celui de la structuration de ce champ en faveur d’une intégration cohérente, délimitée et sécurisée des pratiques.
![]()
1.3. Création de l’A-MCA :
un lieu de structuration des MCA
Le recours grandissant aux Médecines Complémentaires et Alternatives (MCA) en France soulève un enjeu de santé publique majeur : comment organiser un parcours de soins plus intégratif en favorisant l’accès des approches ayant montré leur efficacité sur la santé et la qualité de vie tout en luttant contre la multiplication des méthodes douteuses qui relèvent du charlatanisme ? C’est dans ce contexte qu’est née l’Agence des Médecines Complémentaires et Alternatives (A-MCA), un lieu de réflexions et d’actions visant à structurer le champ des MCA. Sa création répond à la nécessité d’asseoir une culture du soin centrée sur le care en santé en favorisant l’essor structuré et sécurisé des MCA et plus largement du soin relationnel et non médicamenteux.
En France, si certaines Thérapies Non Médicamenteuses font l’objet de travaux par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui en recommande l’intégration, les MCA sont un champ peu investi par les Autorités sanitaires. Actuellement, seules certaines Universités8 et organisations scientifiques9 engagent des travaux dans le domaine. Cette situation conduit à un décalage entre les « réalités de terrain » marquées par un processus d’intégration des MCA et le « manque de régulation » conduisant à une absence de repères pour les institutions comme pour les usagers.
Dans ce cadre, l’A-MCA a pour objectif de porter des réflexions transverses, de proposer des pistes d’actions multiaxiales et de diffuser de l’information éclairée. Elle vise à informer, conseiller, guider sur ces pratiques tout en développant la recherche dans le domaine. Il s’agit de consolider les connaissances sur ces pratiques, leurs effets et leur niveau d’efficacité. C’est dans ce contexte qu’elle élabore une stratégie d’information, accompagne des projets de recherche, contribue à différentes publications scientifiques et porte des projets à thématiques en partenariat avec des Universités et laboratoires de recherches.
L’A-MCA a également pour but d’aider à organiser l’enseignement et la formation des pratiques validées et de soutenir, sur le terrain, leur mise en œuvre de façon cohérente et adaptée. Dans cette optique, elle accompagne des groupes médico-sociaux, des associations nationales et des entreprises dans leur stratégie de déploiement des MCA au bénéfice des différents publics (patients, aidants, soignants, salariés, etc.).
L’Agence entend aussi lutter contre les dérives des MCA, en particulier les dérives thérapeutiques non sectaires, volontaires ou non, et dont les mécanismes restent complexes à identifier. Peu connues du grand public, les « dérives thérapeutiques » représentent un danger qu’il importe d’étudier et de prévenir en complément de l’action essentielle de la Miviludes centrée sur les dérives sectaires. Sectaires ou non, les conséquences de ces dérives en santé peuvent être dramatiques.
Il s’agit donc de débroussailler et d’aider à la structuration des MCA en apportant un cadre à des pratiques aux effets réels pour certaines ou relevant au contraire pour d’autres, de charlatanisme. Une telle dynamique implique de s’inscrire dans une double perspective d’intégration sécurisée de pratiques complémentaires adaptées et de lutte contre toutes les formes de dérives et d’approches alternatives.
![]()
1.4. Écosystème de l’A-MCA :
un décloisonnement des acteurs
La volonté de décloisonner le sujet a conduit l’A-MCA à s’entourer d’experts et de partenaires très diversifiés. Plus spécifiquement, l’Agence s’articule autour de 4 antennes impliquant 110 acteurs, dont 80 personnalités qualifiées et 30 partenaires institutionnels :
1. Une antenne administrative impliquant le Conseil d’Administration de l’A-MCA
Le conseil est composé du Président de l’A-MCA et différents administrateurs qui définissent la stratégie et les orientations de l’agence.
2. Une antenne opérationnelle impliquant l’équipe des opérations de l’A-MCA
L’équipe est constituée de la Direction générale ainsi que des différents responsables de l’A-MCA (responsables des différents comités, des relations, des partenariats). L’équipe délimite les axes prioritaires, coordonne la stratégie des pôles (réflexions, actions, information) et assure le suivi général des initiatives de l’Agence.
3. Une antenne de productions impliquant les trois comités de l’A-MCA :
– Un comité d’experts (pôle réflexion) : incluant une variété de personnalités qualifiées dans le domaine : chercheurs, hauts dirigeants, décideurs politiques, élus, juristes, médecins, psychiatres, psychologues, etc. Le comité mène une réflexion multiaxiale, formule des recommandations et élabore des plans d’action.
– Un comité de « conseiller...