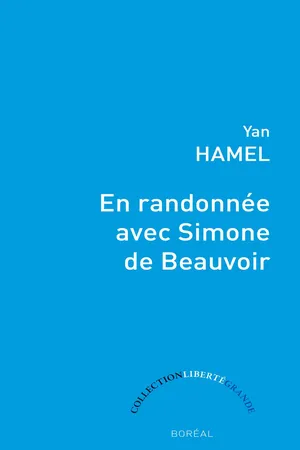![]()
Chacun est libre d’imaginer Simone de Beauvoir comme il la désire. La principale intéressée s’en était d’ailleurs plainte dans l’épilogue de La Force des choses : la rumeur sociale travaillait à l’enfermer dans quelques méchants stéréotypes. L’auteure avait écrit les trois premiers tomes de ses mémoires pour reprendre le contrôle de son image publique, mais rien n’y fit. On voulait qu’elle fût un pot de chambre du sartrisme : Pour une morale de l’ambiguïté et ses autres livres avaient été écrits par Sartre ; en femme docile et passive, Simone de Beauvoir avait reçu ses affligeantes convictions de son gourou existentialiste. Ou alors, l’auteure de L’Invitée était une timbrée, une excentrique ; sa vie était un carnaval de débauche. À moins que celle à qui l’on doit Faut-il brûler Sade ? n’ait plutôt été, avec ses souliers plats et son chignon tiré, un pur cerveau desséchant sa féminité devant sa table de travail. Le magazine Elle n’avait-il pas, dans une liste des divers types de femmes à la mode des Golden Sixties, placé son portrait au-dessus de la mention : Vie exclusivement intellectuelle ? Mais, comme le remarquait un Castor sardonique, rien n’interdit de concilier les deux portraits. On peut être une dévergondée cérébrale, une dame patronnesse vicelarde… L’essentiel était de la présenter comme une anormale.
Bien des années avant la fatale journée du 14 avril 1986 qui allait l’abandonner aux griffes des vivants, elle était loin de pouvoir imaginer tout ce que nous allions faire d’elle. Les morts, enseigne avec raison la psychanalyse existentielle, sont des moulins dans lesquels on entre au gré de sa fantaisie. Depuis que la bière scellée a rejoint celle de Sartre sous la sobre pierre tombale au cimetière du Montparnasse, le souvenir, lui, ne s’arrête plus : il fuit en spirales d’images grumeleuses qui s’entraînent les unes les autres dans le tout-à-l’égout du régurgité assertif.
Simone de Beauvoir écrivait, dit Nathalie Sarraute, comme un fer à repasser. Nous devons – toutes et tous, et en grande partie – notre liberté d’être au génie de Beauvoir, cette femme rebelle. Beauvoir était une intellectuelle bourgeoise de Saint-Germain-des-Prés : elle n’a décrit que son milieu et sa classe. Beauvoir, dit le blogueur phallocrate, est le maillon faible du féminisme. Elle était une femme romantique, enjouée, sensuelle et désirante, qui aimait et qui savait le dire. Beauvoir méprisait la maternité à un point tel qu’elle refusait de rencontrer ses amies pendant leurs grossesses. Lorsqu’elle se laissait emporter par la passion du mâle, Beauvoir devenait une midinette abusant des clichés les plus mièvres. Beauvoir écrivit le plus grand roman intellectuel de l’après-guerre. Tantôt anarchiste, stalinienne, maoïste, castriste… Beauvoir demeurait en toutes circonstances une idéologue intransigeante n’hésitant jamais à châtier quiconque était à ses yeux coupable de tiédeur théorique ou politique. Cette papesse du féminisme s’est en réalité montrée parfaitement indifférente – lorsqu’elle n’était pas sournoisement malveillante – à l’égard des femmes. Beauvoir manifesta toujours une immense compassion à l’endroit des femmes. Tandis qu’elle faisait profession d’athéisme, Beauvoir mettait dans les faits Sartre à la place de Dieu. Beauvoir était une mémorialiste collet monté. Maître à penser cynique et dévoyé, Beauvoir s’est dotée dès 1929 d’un harem d’amours contingentes : elle entretint des relations homosexuelles destructrices avec des élèves triées sur le volet, puis avec toute jeune femme tombant sous sa coupe. Beauvoir se caractérisait par une indéfectible promptitude dans la générosité. Beauvoir était dépassée, masculiniste-hétérogéniste et, de toute façon, sartrienne. Simone de Beauvoir nous a donné, dit Philippe Sollers, l’une des proses les plus intéressantes que l’on ait écrites en français. Beauvoir était une obsédée qui se projetait inlassablement vers l’avant, tout en analysant les jours passés à grands coups de bilans, de programmes qu’elle n’en finissait pas de fixer, de faire et de défaire. Le Castor plaçait les hommes sur un piédestal et incitait ses consœurs à leur ressembler. Beauvoir a proposé une formidable façon de réinventer la liberté des femmes, qui doit toujours provoquer notre enthousiasme intellectuel et moral. Beauvoir refusait avec un superbe dédain les théories littéraires en vogue dans les années 1960 et 1970. Beauvoir s’entêtait dans une opposition stérile aux véritables penseurs de la modernité. Beauvoir a accompli ce qui était en germe chez les épistolières, philosophes et autres femmes des Lumières – de Marie de Sévigné à Émilie du Châtelet, puis chez Germaine de Staël et George Sand, Louise Michel et les suffragettes anglaises. Avec La Cérémonie des adieux où elle montre Sartre se chiant dessus, Simone de Beauvoir fut plus que jamais d’une indécence révoltante. Lorsqu’elle critiquait le capitalisme, Beauvoir dressait en réalité un autoportrait en femme de conviction naïvement rigide. Elle était, dit Alain Badiou, d’une élévation, mélangée à une sorte d’élégance, qui touche infiniment. Beauvoir remit à l’honneur le voyage mystificateur au service des dictatures communistes. Ce qui importe vraiment chez elle se dévoile dans l’extraordinaire force et délicatesse avec laquelle elle parle de la mort des êtres chers. Cette femme, dit Julia Kristeva, a déclenché une révolution anthropologique dont on n’a pas encore mesuré les conséquences : c’est d’une nouvelle façon d’assurer la continuité de l’espèce humaine qu’il s’agit. Beauvoir nous soutient encore aujourd’hui dans la résistance au terrorisme économique, politique et religieux, sous toutes ses formes et dans tous les pays. Beauvoir était une femme bien de son temps qui se disait écrivain plutôt que de se reconnaître auteure. Simone appartient, dit la militante proavortement des années Pompidou, à la catégorie, rare, des héroïnes ; elle est un personnage qui se hisse au-dessus de sa condition, et qui tente le projet de transcender son destin. Beauvoir a puisé la matière principale de son écriture dans le pacte de liberté l’unissant à Sartre. Beauvoir a été la victime de Sartre ; elle aurait été plus heureuse si elle s’était mariée avec lui ou, mieux encore, si elle avait épousé un catholique. L’intérêt majeur de Beauvoir, dit le métaphysicien du VIe arrondissement, tient dans sa capacité à dépasser l’alternative du naturalisme et du constructivisme, du naturalisme et de l’antinaturalisme, et à s’élever à un point de vue proprement ontologique en pensant la différence sexuelle comme différance et différend ontologiques. Cette aventurière, sous sa frêle apparence d’intellectuelle à turban, a ouvert une nouvelle ère par la vivacité de sa plume et la violente solidité de son esprit. Simone de Beauvoir n’a pas eu d’enfant, dit Martine Delvaux, ce qui, en soi, pour l’époque, était une forme d’exception. On doit à Beauvoir, plus plats les uns que les autres, des romans à clé, des romans à thèse, des romans formellement en retard sur leur temps. Elle était, dit Claude Lanzmann, un écrivain, une femme, cette lumière du monde qui s’appelle à jamais Simone de Beauvoir.
Les débris d’opinion les plus précieux comme les plus salissants nous en apprennent surtout sur ceux qui les ont donnés ; comment pourraient-ils saisir celle qui ne s’est jamais arrêtée, à qui l’on doit tant d’écrits philosophiques, politiques, littéraires ; des livres que j’aime entre tous – Lettres à Nelson Algren, Une mort très douce… – et d’autres que, viscéralement, je déteste – Les Mandarins, La Longue Marche… ? À l’orée du livre nouveau, j’ai peine à penser que je m’apprête à enrichir cette décharge. J’aimerais me situer du côté de Nancy Huston, qui eut le courage de mettre en jeu sa propre subjectivité pour dévoiler la complexité en mouvement de l’une des femmes les plus multiplement scindées qu’il soit possible d’imaginer. C’est fascinant, dit Nancy Huston, plus je l’approche, plus elle se fragmente.
Il m’aura néanmoins fallu choisir une perspective. Les pages qui suivent redonneront donc vie à Simone de Beauvoir, une femme qui a beaucoup marché.
![]()
L’idée de ce livre m’est venue en juin 2016, lorsque je traversais Sifnos. Entre Santorini et Le Pirée, j’avais choisi d’y débarquer pour parcourir les sentiers de montagne qui sont, avec les céramiques pittoresques, le principal attrait de cette petite île encore peu touchée par l’industrie touristique.
Je ne suis pas de ces randonneurs suréquipés qui se laissent arrêter par un climat hostile. Il m’est arrivé à l’occasion d’en payer le prix. Quelques années plus tôt, le Valais m’avait montré que les nuages deviennent, dans les hauteurs, des limbes glaciaux vous interdisant de voir vos propres mains. Les calanques de Marseille m’avaient de leur côté inculqué quelques leçons pénibles sur la chaleur et la déshydratation.
De tels précédents, qui en auraient tiédi un moins téméraire, n’ont pas suffi à me faire considérer avec pragmatisme les 29 degrés Celsius qui, le lendemain de mon arrivée, écrasaient le petit port cycladique en début de matinée. J’avais la veille accompli sans peine l’aller-retour Kamares-Apollonia. Il me fallait maintenant selon mes plans marcher de Kamares à Platis Gialos en passant par le sommet culminant de l’île. Je me suis donc engagé sur le relief escarpé où, pour les six heures à venir, je ne devais espérer aucune source. J’ai grimpé dans le concert cuisant des accidents où les maigres parcelles d’ombre, disséminées de loin en loin, me sont vite apparues comme le plus précieux des biens qui se pouvait trouver. Je serais peut-être arrivé à mes fins sans misère excessive si, sur un long plateau balayé par la brise saline, la quiétude et les odeurs citronnées se dégageant d’un bois de pins nains ne m’avaient fait perdre le sentier au balisage incertain que je devais suivre. Il a fallu le miracle d’un Danois barbu, installé dans la dépendance solitaire de l’une de ces minuscules chapelles orthodoxes que l’œil aperçoit là-bas jusque dans les plus inaccessibles nids d’aigles, pour me ramener, après une suite d’égarements, sur la bonne voie. C’est à bout de force, meurtri par le soleil, les pieds enflés et sans rien à boire, que j’ai retrouvé enfin la mer Égée scintillante, depuis les hauteurs du versant sud. Accablé par le panorama grandiose, alors que je devais me résoudre à amorcer la descente en boucles interminables autour des ravins, ponctuée de douloureuses remontées, une phrase de La Force de l’âge s’est rappelée à moi. Ce n’était pas la première fois que me revenaient ces mots. Sans que j’aie jamais cherché à les retenir, ils se sont gravés, indélébiles, et je n’avais jusqu’alors pas manqué de les répéter toutes les fois où l’on m’a demandé pourquoi je m’attache, en vacances, à des conditions que le touriste ordinaire trouverait par trop éprouvantes. Ce sont les mots qui, depuis aussi longtemps qu’est apparue ma passion pour la marche, fondent mo...