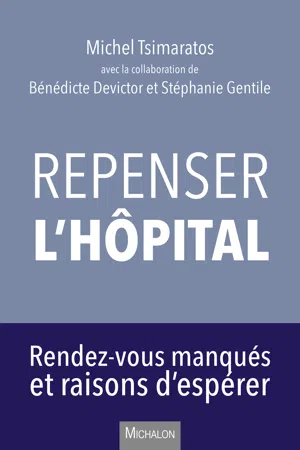![]() DEUXIÈME PARTIE
DEUXIÈME PARTIE
ANALYSE TECHNIQUE
ET RENDEZ-VOUS MANQUÉS![]()
I.
L’HISTOIRE ARBITRAIRE
DU FINANCEMENT DE L’HÔPITAL
La tarification constitue une étape très importante dans le dispositif financier de l’hôpital, car elle est le fondement même de la comptabilité hospitalière. Pour pouvoir tarifier les prestations hospitalières, il est indispensable d’en connaître précisément le prix de revient. Cependant, cette information a toujours été difficile à trouver. Tout au long de l’histoire de l’offre de soins, la définition du coût exact de la santé a fait l’objet de décisions politiques souvent plus arbitraires que rationnelles. Aujourd’hui encore, à l’heure de la tarification à l’activité (T2A), la bonne méthode de définition des tarifs reste encore à trouver. L’histoire du financement de l’hôpital, qu’on a parfois un peu oubliée, permet d’en faire une lecture sinon simple, en tout cas éclairante.
LE PRIX DE JOURNÉE OU LE COÛT D’UNE NUIT À L’HÔPITAL
Avant l’arrivée du PMSI, les hôpitaux n’avaient pas les outils permettant de calculer le prix de revient d’un séjour, aussi le tarif de remboursement appliqué était-il le plus souvent fixé arbitrairement. La forte diversité des prix d’un hôpital à l’autre en témoigne. L’historien Jean Imbert note qu’« au milieu du XIXe siècle, d’ailleurs, la fantaisie la plus arbitraire règne dans le calcul de l’hospitalisation des militaires : la commission des hospices réclame, pour chaque soldat soigné au ministère de la Guerre, 8 francs par jour à Lombez (Gers) et 0,27 francs par jour à Pont-l’Abbé (Finistère) ». Détail plutôt surprenant, les hôpitaux différencient le prix de journée en fonction du grade militaire, l’officier coûtant plus cher que le sous-officier ou le soldat.
La loi du 15 juillet 1893 prévoyait l’Assistance médicale gratuite (AMG) pour les malades hospitalisés aux frais de l’État, du département ou de la commune. Il faut attendre huit ans pour que la loi du 14 juillet 1905 organise l’assistance obligatoire pour les vieillards, infirmes et incurables. Pour ces deux lois, un prix de journée à caractère obligatoire est arrêté par le préfet sur proposition de la commission administrative de l’établissement. Les modes de calcul sont précisés par des textes mais restent plutôt flous. Le décalage entre le prix de journée « réel » ou « prix de revient » et le prix de journée conventionnel, c’est-à-dire celui remboursé par les tutelles, est ainsi très important.
Tout augmente et la loi du 28 juin 1918 rend le prix de journée révisable chaque année et autorise la distinction d’un tarif différent pour les services de médecine et de chirurgie. Il subsiste cependant des lacunes importantes dans les modes de calcul qui pénalisent les hôpitaux. En 1936, peu de temps avant la réforme hospitalière de 1941, la comparaison des prix de journée de médecine ou de chirurgie pratiqués par l’ensemble des hôpitaux français montrait des différences importantes entre les établissements.
La réforme hospitalière de 1941 a systématisé le financement des hôpitaux sur la base du prix de journée. À partir de 1945, et compte tenu de la croissance de la couverture assurantielle, le remboursement des frais d’hospitalisation est devenu, et de loin, la principale ressource des hôpitaux, et le prix de journée la préoccupation majeure des directeurs. « Chaque année, l’établissement déterminait un projet de budget, fondé sur ses prévisions d’activité et de dépenses. Les indicateurs disponibles étaient à cette époque essentiellement centrés sur les aspects d’hôtellerie : nombre d’admissions, de journées, durée de séjour moyenne et coefficient d’occupation des lits. En privilégiant l’indicateur “nombre de journées”, et en lui rapportant les dépenses prévues, on parvenait ainsi à un prix de journée, qui, pour être validé, devait être approuvé par la tutelle. Il existait plusieurs prix de journée par hôpital, en fonction de grandes catégories (médecine, médecine spécialisée, chirurgie, long séjour, etc.). De plus, les calculs étaient menés par chaque hôpital, et les prix de journée pour une même discipline médico-tarifaire n’avaient donc aucune raison d’être semblables dans tous les hôpitaux d’une même région, ni a fortiori du pays. Enfin, dans la phase de calcul préalable, les établissements avaient intérêt à sous-estimer leur activité prévisible et à surestimer l’augmentation des dépenses, de façon à obtenir un prix de journée élevé. Lorsqu’ils facturaient ensuite leurs journées aux caisses de Sécurité sociale, ils pouvaient ainsi majorer leurs recettes, et de toute façon, leurs déficits éventuels étaient incorporés dans les charges des années suivantes, donc couverts. »
Ainsi, pendant 40 ans, les hôpitaux publics ont bénéficié d’un mode de financement sur la base d’un prix de journée ajusté sur les coûts observés de chaque établissement. Un trait important de ce mode de financement était que chaque hôpital public avait son propre prix de journée, fondé sur ses coûts constatés. D’autre part, ce prix de journée était quasi automatiquement réajusté tous les ans pour tenir compte de l’augmentation des coûts. Il en a résulté pendant de nombreuses années une grande hétérogénéité des coûts hospitaliers. Surtout, les gestionnaires d’établissement n’avaient aucune incitation à contrôler les coûts unitaires, puisque leurs dépenses étaient automatiquement couvertes. Enfin, dans ce système, plus un hôpital remplissait ses lits, plus ses recettes augmentaient : ceci peut paraître vertueux, puisqu’un hôpital actif augmentait ses recettes. En revanche, un hôpital peu dynamique en recrutement pouvait couvrir ses coûts en allongeant les durées de séjour, sans justification. Cette procédure était donc jugée inéquitable entre établissements d’une part, et inflationniste d’autre part. Malgré un principe commun de financement reposant sur le prix de journée, l’existence de différences importantes était visible aussi selon le statut de l’établissement.
D’une part, la nature de l’autorité fixant le prix de journée dépendait du statut de l’établissement : les établissements publics et les établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH), ainsi que certains établissements à but non lucratif non PSPH avaient un prix de journée fixé par le préfet. Les établissements privés à but lucratif avaient pour la quasi-totalité d’entre eux un prix de journée dit conventionnel, arrêté par la Caisse régionale d’Assurance Maladie.
D’autre part, les prix de journée du secteur public ne pouvaient pas être comparés au prix de journée du secteur privé, car les éléments que recouvraient ces deux notions n’étaient vraiment pas comparables ; en effet, le prix de journée de l’hôpital public était « tout compris » (seuls les honoraires médicaux étaient facturés à part), celui de la clinique privée ne comprenait, ni les frais de salle d’opération, ni la fourniture des médicaments coûteux, ni les analyses de laboratoire, ni les examens et les actes d’électroradiologie, ni les frais de transfusion sanguine qui étaient décomptés à part.
Dès les années 70, la pertinence du système de tarification au prix de journée qualifié d’inflationniste, est remise en cause. Le prix de journée avait de moins en moins de rapport avec le prix de revient du service auquel il se rapportait sans pour autant renseigner sur le coût réel d’un malade : il n’était qu’une moyenne entre les cas graves et les cas légers. Il était surtout jugé inéquitable entre les établissements. Ces défauts étaient apparus progressivement, avec le temps. Deux poids, deux mesures.
La nécessité absolue de maintenir les dépenses de santé dans des limites acceptables pour l’économie avait fini par gagner. Après 40 ans de bons (et loyaux) services, le législateur a mis un terme au système du prix de journée pour le remplacer par le budget global, mais uniquement pour le s...