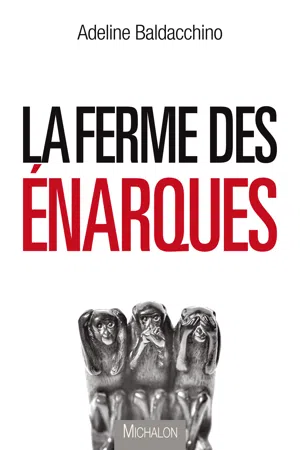![]()
PREMIÈRE PARTIE
Apprendre à dé-penser
« Il vient un temps où l’esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, où il aime mieux les réponses que les questions. Alors l’instinct conservatif domine, la croissance spirituelle s’arrête. »
Gaston Bachelard
La formation de l’esprit scientifique
Partons d’un constat simple. L’énarque est omniprésent dans la vie politique française, dans les cabinets, dans la haute fonction publique, tout simplement parce que c’est sa vocation même. L’École nationale d’administration, projet de Jean Zay, alors ministre de l’Éducation nationale sous le Front populaire, voit le jour au sortir de la Seconde guerre mondiale. Créée en 1945 par ordonnance du Général de Gaulle, elle doit supprimer les mécanismes de cooptation corporatistes d’avant-guerre et inventer un nouveau moyen de recrutement, offrant des chances égales à tous. L’exposé des motifs du texte fondateur était sobre et lumineux : « Une fois le seuil franchi, plus rien ne distinguera les élèves, quelle que soit leur origine. L’école leur enseignera les techniques de la vie administrative et politique ; elle s’efforcera aussi de développer en eux le sentiment des hauts devoirs que la fonction publique entraîne et les moyens de les bien remplir. » Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste et ministre de la Fonction publique, préside aux destinées de l’école en préparant ses décrets, autant que Michel Debré qui en assure la création concrète et la direction provisoire. Projet œcuménique s’il en fut !
Début d’un mythe aussi. Parce que trois présidents de la République (Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, François Hollande), sept premiers ministres, des dizaines de ministres et de députés en seront issus, parce qu’ils monopoliseront très vite tous les postes de direction en administration centrale, les énarques deviendront de belles cibles. Dès 1964, Bourdieu et Passeron s’attaquent, dans Les héritiers, aux inégalités de fait créées par les épreuves dites de « culture générale », qui assurent la reproduction sociale des élites, à l’entrée de l’ENA comme dans les autres écoles de la République. Le fait est qu’au concours d’entrée de 2009, le magazine Alternatives Économiques avait calculé, à partir de données fournies par l’ENA, que les enfants d’ouvriers étaient environ huit fois moins représentés, et les enfants de cadres quatre fois mieux représentés que leur proportion statistique dans la société n’aurait suffi à l’expliquer.
En 1967, un curieux trio masqué sous le nom de Jacques Mandrin (en fait Jean-Pierre Chevènement, Alain Gomez, Didier Motchane) dénonçait pour la première fois « l’énarchie » comme oligarchie, la formation des nouveaux « mandarins de la société bourgeoise » et la logique du classement. Le constat pouvait sembler sans appel : l’école y apparaissait comme « une institution dévoyée, où le conformisme et les appétits de carrière apprennent à rimer, qui prépare d’excellents fonctionnaires, c’est-à-dire de fidèles intendants du néo-capitalisme, ayant un sens élevé du service public, c’est-à-dire ne se mêlant en aucun cas de juger ce qu’ils font ». Le petit ouvrage, qu’il reste jubilatoire de relire, finissait sur un appel à la réforme : « Ni le juridisme, prétexte de l’inertie, ni la régularité comptable, excuse de l’aveuglement, ne suffiront à faire un bon fonctionnaire », qui devrait être jugé sur « la mesure des conséquences sociales de son action » – Chevènement les rêvait alors en hussards du socialisme…
Depuis, s’égrènent régulièrement les livres sur l’ENA comme si vous y étiez, le grand oral de l’ENA, jusqu’aux petits Meurtres à l’ENA – polar introuvable –, et au film grand public (L’École du pouvoir, racontant l’épopée de la promotion Voltaire 1980 – Hollande, Royal, de Villepin et bien d’autres). Bref, on n’en finit pas de fantasmer l’énarque, vaguement envié, souvent conspué, rarement admiré. Tout cela pour environ 4 500 anciens élèves en activité, moins de 10 % d’entre eux ayant fait carrière en politique, 80 nouveaux admis chaque année, qui ressortent deux ans plus tard conseillers d’État ou de tribunaux administratifs, magistrats financiers à la Cour des comptes ou en chambre régionale, inspecteurs des finances, des affaires sociales ou de l’administration, diplomates, directeurs de cabinet de préfet, adjoints ou chefs de bureau en ministère etc. Il faut ajouter qu’à toute époque, en proportion variable selon les gouvernements, 50 à 70 % des cabinets ministériels sont composés d’énarques.
Pourtant, Jean-François Kesler, un ancien directeur adjoint de l’ENA, l’affirme dans un article de 1997 : « L’énarchie n’existe pas en tant que catégorie sociale ; elle n’existe pas en tant que catégorie dirigeante. Elle ne forme ni une couche homogène ni un pouvoir autonome. Les anciens élèves de l’ENA n’ont ni origines communes ni destin commun. Ils ont seulement une formation commune. » Justement. Prenons très au sérieux cette dernière phrase. Car en effet, le vrai point commun des énarques, mais plus largement des hauts fonctionnaires en France, c’est bien la formation, du moins une partie de la formation : celle qui passe par Sciences Po et les divers instituts politiques, par l’ENA, par Polytechnique, par l’École nationale de la magistrature, par les grandes écoles de commerce, d’ingénieurs, de militaires et de policiers… L’étrange système français, tout à fait opaque vu de l’extérieur, organise la survie de toute une gamme de « grandes écoles » généralistes, échappant au système international des licences-masters-doctorats, tout en offrant à leurs anciens élèves les plus belles perspectives de carrière possibles, dans la fonction publique ou tout à côté d’elle, où la connivence est encore nécessaire.
Carrière… le mot est prononcé. Celui qui fâche, puisque l’énarque n’est pas censé y penser, mais ne peut s’en empêcher. Comme tous les diplômes en France, celui-ci (qui n’en est pas un, d’ailleurs : on ne vous remet aucun bout de papier encadrable) constitue d’abord une carte de visite. Une courte échelle, une rampe de lancement. L’ENA n’est pas vraiment l’école du désir… d’apprendre et de servir. « Servir et non se servir » ai-je un jour entrevu sur la porte d’un immeuble des douanes gabonaises. Le lieu et la situation prêtaient à sourire, mais l’idée n’était pas mauvaise. Or, où apprend-on vraiment à servir, à quelque chose et non à quelqu’un ?
Imaginons un instant que l’État soit utile. Tentons de trouver un terrain neutre pour accueillir à la fois les libéraux les plus ardents et les plus fieffés interventionnistes, comme les postanarchistes dont il faudra reparler. Postulons la possibilité d’un État qui protège, qui gère et organise. D’un État qui sert à ne pas s’entretuer, à relever les plus faibles, à calmer les plus forts pour qu’ils n’empiètent pas sur les précédents. D’un État qui garantit la liberté individuelle, qui ne régente rien, qui assure seulement, mais vraiment, des « capabilités » de base selon le langage d’Amartya Sen, l’économiste indien : c’est-à-dire des libertés réelles, positives, fondamentales, permettant à chacun d’orienter sa vie propre et intellectuelle, dès lors qu’il peut manger, avoir accès à un système de santé efficace et disposer des mêmes opportunités, en principe, que son voisin. Mettons donc, pour simplifier outrageusement, que l’État peut être cette institution visant à garantir une égalité de capabilités.
L’énarque serait alors l’ouvrier responsable de la maintenance des possibles organisés. Celui qui tente de savoir où le bât blesse, où l’on a mal, où l’on peut faire mieux, où il faut changer une pièce. Un artisan du dispositive social, un pompier du vivre-ensemble. Cette vocation, plutôt noble, reste bien l’idéal de nombre de candidats parmi le millier qui passe chaque année des heures dans un vaste hangar parisien à plancher sur d’obscures dissertations et autres dossiers de culture générale, de droit, d’économie, de questions internationales, européennes, sociales, de finances publiques etc.
Cette image, pourtant, est absolument occultée par l’école même, qui a renoncé à toute ambition de formation intellectuelle digne de ce nom. C’est avant l’ENA que l’on doit avoir appris à penser. L’école, qui se veut « d’application », ne considère pas qu’elle ait un rôle à jouer dans la formation philosophique de ses élèves. Le mot ferait presque rire. Ainsi faut-il l’avouer une fois pour toutes : on n’apprend presque rien à l’ENA que l’on n’ait déjà appris à Sciences Po, hormis, pendant les stages, bien des aspects de la soi-disant « vraie vie administrative ». Aucun corps enseignant (à l’exception des excellents linguistes) n’y est d’ailleurs attaché : les intervenants viennent de Paris pour deux heures et s’éclipsent pour deux ans. Le faux Mandrin et vrai Chevènement de L’énarchie le disait déjà en 1967 : « L’enseignement est inexistant. Quelques maîtres de conférences, anciens de la maison pour la plupart, viennent y rafraîchir leurs connaissances auprès des élèves, dont les exposés rivalisent de technicité sinon de clarté. » Près de cinquante ans plus tard, on ne saurait mieux dire. En revanche, on y apprend à désapprendre.
![]()
UNE ÉCOLE SUR UNE PRISON
SUR UN CIMETIÈRE
Un beau jour de décembre, la mécanique s’accélère. Vous avez été admissible (aux écrits, cinq épreuves de 5 h en culture générale, économie, droit administratif, questions sociales, science politique et administrative), puis admis (aux oraux de questions européennes, finances publiques et langues, en sus du légendaire « grand oral »). À l’hiver 2006-2007, nous étions 91 élèves au total… dont 27 femmes seulement. La moitié des élèves n’avait pas 30 ans. J’en avais 24 et n’étais pas la plus jeune. Le taux d’admission varie selon les années et les concours, externe, interne ou troisième voie, entre 3 et 10 %. Vous ne croyez pas encore au miracle qui vient de transformer l’étudiant inquiet ou le jeune professeur de lettres (car la moitié d’une promotion a passé le concours interne, ouvert après quatre ans de service public), en haut fonctionnaire polyvalent.
D’abord, c’est la grande curiosité, le cœur qui s’emballe un peu en entrant dans les locaux – ceux qui restent à Paris sont avenue de l’Observatoire, dans les bâtiments de l’ancienne école de formation des administrateurs des Colonies… un symbole plus ou moins inconscient qui en dit long, tout de même, de la vision du pouvoir qui s’y invente. Un patio mauresque, quelques chaises au soleil, les photos des anciennes promotions accrochées au mur immaculé, une armada de fonctionnaires aux petits soins pour les nouveaux enfants prodigues de la République.
À peine admis, ils viennent faire leur choix pour les futurs stages : en ambassade ou en administration étrangère ? Très loin ou tout près ? Plutôt exotique ou plutôt chic ? Les caractères se révèlent, les langues se délient. L’un avoue qu’il n’ira jamais « dans un pays où il n’y a pas de trottoir » – il est devenu diplomate, on lui souhaite bien du plaisir. L’autre ne veut rien dire, de peur qu’on ne lui donne pas ce qu’il demandera, et s’acharne à mentir à l’avance pour être compris à demi-mot. L’outre-mer est dédaigné, ce qui m’arrange bien – je finirai avec joie en Martinique. Bruxelles est prise d’assaut par tous les jeunes mariés qui veulent revenir passer le week-end à Paris. Certains calculent dans leur coin les primes liées aux différentes affectations et font déjà la grimace.
Les premières hiérarchies de l’absurde se reconstituent. Les élèves « externes » (rentrés directement sur concours, le plus souvent après un passage par la case Sciences Po) se reniflent entre eux : qui vient de Sciences Po Paris ? Qui de province ? Qui d’une « écurie » prestigieuse – l’un de ces mythiques groupes de préparation au concours pour jeunes pousses prometteuses ?
Les élèves « internes », ayant déjà travaillé des années dans l’administration, se retrouvent dans une situation analogue à tous les autres, ont parfois l’étrange sensation de régresser dans le temps, cèdent éventuellement à la théorie du complot (ces petits jeunes aux dents qui rayent le parquet voudraient leur peau), attendent surtout que ce soit fini, à peine commencé. Les 35 élèves étrangers, un petit tiers de la promotion, voient débarquer tous ces Français avec gourmandise et goguenardise. Eux n’ont pas de classement en vue, sont heureux d’être là, se figurent simplement qu’on est des camarades. Je les aime déjà, ce seront mes meilleurs amis.
Très vite, il faut déménager à Strasbourg. On s’arrange toujours, on repère les râleurs de service, les jamais contents, les très malheureux qui ont tout à fait oublié leur bonheur d’avoir soudain gagné là un job à vie. Les petits et les mesquins, les idiots et les lunaires, les féroces et les faux gentils, les vrais doux et les poètes, les paumés et les salauds, toute la gamme de l’humanité y est. Aucune homogénéité en effet. Rien qui nous rapproche naturellement. Un énarque ne ressemble littéralement à rien. Il passe le grand portail de fer forgé de l’école à Strasbourg. Une plaque avec la citation de Victor Hugo : « Construire une école, c’est fermer une prison. »
La chose est appropriée : l’actuel bâtiment de la Commanderie Saint-Jean fut d’abord, au Moyen Âge, un couvent, racheté par un banquier qui le mit à disposition des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puis abandonné pendant la guerre de Trente ans. En 1740, il devient une prison, Sainte-Marguerite… jusqu’en 1989, quand on se dit que l’ENA devrait être un peu moins parisienne, un peu plus européenne. Complètement rénovée – c’est d’ailleurs une réussite architecturale –, elle abrite aujourd’hui quelques milliers de mètres carrés de salles de cours, bibliothèques, bureaux etc. Sous la Cour d’honneur où sont prises les photos de promotion, se trouvent les restes du cimetière du couvent des Hospitaliers…
Alors, cette école construite sur des morts, est-elle prête à former de grands vivants ? Elle devrait. Ils y entrent le cœur sur la main, ne pensant pas qu’à l’argent – car on ne fait plus l’ENA pour l’argent, on va plutôt pour ça dans les grandes écoles de commerce ; rêvant un peu du pouvoir, mais pourquoi pas, si c’est pour en faire de belles choses ? Ils y entrent fatigués souvent, après des années de bachotage, de concours ratés, recommencés, au fil d’illusions largement perdues, mais pleins de force encore et de l’énergie de la vie qui s’élance enfin vers un but concret. Peut-être ont-ils déjà, pour certains d’entre eux, des agendas cachés, des idées machiavéliques, des ambitions mortifères. Peut-être, mais il en restera toujours assez pour croire au service commun, à ce rêve un peu niais qu’on nomme « l’intérêt général », par opposition aux intérêts particuliers, cette notion très abstraite que l’on a tenté vingt fois de définir pour préparer le grand oral.
Au mien, j’ai parlé d’Éluard et du poème « Liberté » parachuté sur la France. Je venais de rencontrer un grand bonhomme de la chanson française, aujourd’hui presque oublié, Claude Vinci, qui était tombé amoureux d’un de mes textes et voulait le mettre en musique. Son père, un instituteur communiste de l’Indre, avait caché le poème d’Éluard dans une caisse au fond de son jardin, où il était resté après l’arrivée des Allemands et le départ au maquis. J’avais eu entre les mains la version manuscrite du poème envoyé à Max-Pol Fouchet pour sa revue Fontaine. Je crois bien que je le racontai, oubliant un instant où j’étais. On me demanda quel était le pays qui s’était choisi pour devise celle d’un philosophe français. Je faillis bien rester coite, puis la vision d’un large drapeau vert au losange jaune et à la sphère étoilée m’envahit subitement l’esprit : c’était Auguste Comte, le grand tenant du positivisme, et le Brésil qu’il fallait trouver, pour Ordem et progresso.
Grand écart de l’Histoire, j’écoutais la veille Léo Ferré et des chansons communardes, mais c’est Éric Zemmour que j’avais en face de moi dans le jury. Il venait d’écrire un drôle de livre absurde sur les femmes et je tremblais. Mais il a souri gentiment, m’a demandé pourquoi tous les jeunes Français rêvaient de partir en Angleterre. Je ne me souviens pas bien de ma réponse un peu poussive. J’avais envie de lui dire qu’on rêvait mieux ailleurs, qu’on revenait mieux d’être parti, qu’il y avait de l’autre côté des postes de douanes un immense appel d’air. J’ai bafouillé quelques banalités, « l’ouverture, monsieur, le sentiment qu’on comprend mieux le monde quand on va voir ailleurs comment il marche, et puis l’anglais c’est important, mais la Francophonie j’aime, beaucoup plus, oui, bien sûr, d’ailleurs je vais vous dire, Senghor et Césaire, j’adore ».
Après trois quarts d’heure de conversation sous les yeux d’une pendule amorphe et d’un public clairsemé, j’étais sortie de la salle, ni sonnée ni soulagée, n’ayant rien compris à ce qui venait de se passer. En réalité, ces gens rassemblés autour d’une table s’étaient dit qu’ils arriveraient sans doute à travailler avec moi et m’avaient délivré un ticket d’entrée au paradis des fonctionnaires. Plus tard, quand j’ai commencé à aider des élèves qui voulaient passer le concours, je leur disais de penser à cela : qu’ils parlaient à des humains normalement constitués, se demandant s’ils étaient sympathiques, compétents, fiables. La principale fonction des examinateurs est probablement, à ce stade de compétence technique validée par les autres épreuves, de repérer les imposteurs ou les psychopathes. Las, le jury, quelquefois composé lui-même sans aucune logique apparente, n’y parvient pas toujours.
![]()
CARNAVAL ET DÉSOCCULTATION
Nous y sommes. Week-end d’intégration, dans une petite station des Vosges. On est en janvier. Il s’agit de faire connaissance et de passer jours et nuits ensemble. Le voyage en bus révèle les premiers fous, zélés qui se croient obligés de lire ostensiblement un mémento de droit européen dès sept heures du matin. Sur place, en l’absence de neige, on tue le temps entre karting et ping-pong, quad compétitif et randonnées panurgiques. On s’es...