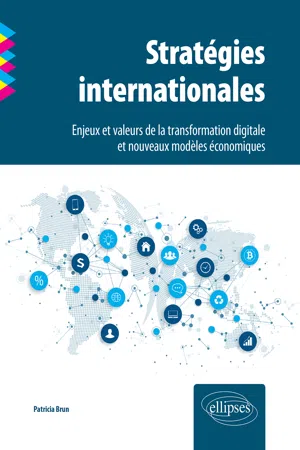![]()
CHAPITRE 1
Les raisons à l’internationalisation. Quels sont les enjeux actuels ?
« Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu’elles ne surviennent. »
Sun Tzu, L’Art de la guerre
1.1. Les raisons à l’internationalisation
1.1.1. Les différentes phases et aspects du développement international classique
Les échanges existent depuis la nuit des temps, car le développement international a permis de compenser au départ les imperfections du marché comme le manque de matières premières au niveau des pays par exemple. C’est l’approche macroéconomique classique.
Depuis le début du XXe siècle, il y a eu d’autres approches qui privilégient une analyse microéconomique car l’internationalisation est un axe stratégique majeur pour l’entreprise parce que l’enjeu principal est de trouver de nouveaux leviers de croissance à savoir acquérir de nouveaux clients afin d’augmenter ses ventes, développer d’autres activités, ou encore accroître ses ressources et optimiser ses coûts. Ainsi vendre son nouveau produit sur des marchés étrangers permet en outre de conserver une avance sur ses concurrents tout en réalisant des économies d’échelle au niveau de sa production.
En délocalisant tout ou partie de sa production dans des pays où le coût de la main-d’œuvre est faible et la fiscalité attractive permet de réduire ses coûts ce qui est un axe fort du développement international par les entreprises. De même, les marques étant concurrencées sur leur marché national cela les incite à trouver de nouveaux débouchés et ainsi attaquer ses concurrents sur leurs propres marchés.
Mais si on veut réussir à vendre sur un marché étranger, il est essentiel d’appréhender ce que veut le consommateur local, quelles sont ses valeurs et ses habitudes de consommation entre autres. Vers les années 1960, les entreprises ont réalisé que la prise en compte des différences socioculturelles était indispensable à la réussite de l’implantation à l’international car être ouvert aux autres cultures est un préalable essentiel quand on veut vendre à l’étranger (voir chapitre 6).
Le développement international est un axe stratégique majeur pour la plupart des entreprises car, outre l’augmentation des ventes et l’optimisation des coûts, il permet aussi l’accroissement des ressources : en matières premières (acheter moins cher dans un pays étranger) mais aussi en ressources humaines (main d’œuvre étrangère moins chère ou acquisition de cadres au profil international apportant un savoir-faire) ou encore en matière de financement de la part des Bourses, des fonds souverains ou des grandes structures de financement internationales comme la Banque mondiale, BPI France, USAID, EuropAid, l’Agence française du développement, etc.
Exemple Ces dernières années le prix de nombreux produits alimentaires bio a baissé car ils sont importés en grande majorité.
Si, pour une PME très souvent le déclenchement de son développement international va être la demande de son produit par un distributeur étranger qui l’aura vu lors d’un salon ou sur son site internet, notamment grâce à l’essor du e-commerce et du m-commerce, pour les grands groupes il s’agit de véritables stratégies qui s’inscrivent dans les doctrines d’investissement de groupes dû à :
– Soit à des changements conjoncturels comme l’opportunité de rachat d’une entreprise directement concurrente, ou qui peut apporter une activité complémentaire, ou encore en réponse à un appel d’offres, mais aussi la possibilité d’achat de licences de production ou de commercialisation…
Exemple L’entreprise NATUREX leader mondial spécialisée dans la production et la commercialisation d’arômes naturels réalise 94,7 % de son chiffre d’affaires à l’international car l’export est au cœur de sa stratégie. Elle réalise un tiers de ses ventes aux États-Unis où la société s’est implantée en multipliant les acquisitions ce qui facilite le sourcing et permet de réduire les coûts de logistique et de taux de change en étant au plus près de ses clients.
– Soit à des changements structurels comme des privatisations : une entreprise de télécommunications ou de transport va pouvoir se développer grâce à la privatisation du réseau d’un pays par exemple. De même, des évolutions réglementaires favorables comme la baisse des droits de douane ou l’ouverture d’un marché comme la fin de l’embargo en Iran ou à Cuba récemment.
Le choix du pays d’implantation à l’étranger dépendra d’une sélection de critères dont la taille du marché, le taux de croissance, le pouvoir d’achat, sa proximité ou encore la présence de la concurrence locale et internationale et bien sûr la demande potentielle par rapport à son produit. Mais il est impératif de tenir compte du contexte géopolitique car l’évaluation des risques est un critère majeur au niveau de la prise de décision : l’évolution de la politique internationale avec les conflits au Moyen-Orient, la conjoncture économique qui peut évoluer favorablement ou défavorablement comme en Chine à l’heure actuelle, tout comme les réglementations ou encore la protection juridique liée aux problèmes de contrefaçon.
Exemple La Chine a durci en 2014 la réglementation en vigueur sur le lait pour nourrissons dans le but de favoriser les producteurs locaux et d’apaiser ainsi les craintes liées à ce produit qui représente un marché estimé à 14 milliards de dollars, Danone, Nestlé, Mead Johnson Nutrition et Abbott Laboratories représentant près de 80 % de ce marché.
Depuis 2018, les États-Unis ont décidé d’engager une guerre commerciale avec la Chine en augmentant les droits de douane sur l’acier et la Chine a décidé de répliquer en les augmentant à son tour mais cela a eu de nombreuses répercussions sur les marchés internationaux mais aussi sur des entreprises américaines dont le coût d’approvisionnement risque d’augmenter et qui souhaitent délocaliser leur fabrication.
D’ailleurs si la Chine a pu se développer aussi fortement et concurrencer tous les pays développés sur tous les secteurs d’activité que ce soit les téléphones portables, l’automobile ou encore l’aéronautique et d’autres industries de pointe, c’est qu’elle a su profiter des délocalisations et, en encourageant la création de filiales communes, a pu ainsi s’approprier le savoir-faire des entreprises étrangères.
1.1.2. Les nouveaux enjeux depuis la révolution numérique
Avec la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et la Chine qui est devenue une économie socialiste de marché, l’agrandissement de l’Union européenne à 28 pays, nous sommes entrés dans l’ère de la mondialisation, les échanges de flux se sont accélérés, les capitaux sont devenus volatils et la communication instantanée grâce à la révolution internet. Le consommateur local d’un monde global a profité de produits moins chers.
Avoir un téléphone portable est devenu la normalité et il s’en est vendu près de 3 milliards en 2017 dont près de 800 millions sur le continent africain. À l’heure actuelle tous les africains ont un, voire plusieurs téléphones mobiles, près de 330 millions avaient un smartphone en 2016 et d’après le Cabinet Deloitte, ils seront près de 660 millions d’Africains à posséder un smartphone en 2020. Car outre l’accès à Internet, aux sites de e-commerce mais aussi aux « tutos », c’est également un moyen de paiement mais aussi de développement, un des enjeux actuels étant d’avoir ou pas une borne wifi.
Cependant, la révolution numérique implique que les industries vont connaître de nouveaux paradigmes en même temps que des transformations sociales et sociologiques. Car Internet permet d’avoir des accès gratuits à toutes sortes d’informations, l’information étant devenue ainsi une « commodité », tout comme l’éducation avec par exemple les cours en ligne des MOOC (Massive Open Online Courses) ou Coursera. De même, le capital est devenu aussi une « commodité » grâce aux plateformes de crowdfunding ou financement participatif qui permettent de mettre directement en contact des particuliers ou jeunes entreprises avec des financements privés concurrençant de ce fait les banques.
La réaction de ces dernières ne s’est pas fait attendre avec l’Open Banking et la création de banques en ligne comme Hello Bank ou Boursorama. Ainsi BNP Paribas a mis au point une stratégie « d’open innovation » qui implique collaborateurs, clients et l’ensemble des acteurs de l’écosystème : start-ups, grands groupes, acteurs du digital. Cette stratégie vise à enrichir leur proposition de valeurs avec de nouveaux services et Business Models et à diminuer leur time-to-market.
De son côté, la Société Générale peinerait à se transformer et pense que la majorité des clients ne seront pas 100 % digitaux et mise sur la relation client. Ils comptent ouvrir 150 à 200 agences car le client peut être beaucoup plus accompagné grâce aux automates qui libèrent du temps commercial et qu’il y aurait un bel avenir pour la banque de détail avec des réseaux d’experts.
Cependant avec les banques 100 % mobiles, les crypto-monnaies et Facebook lancerait la sienne dès 2019, on peut se demander quel sera l’avenir des...