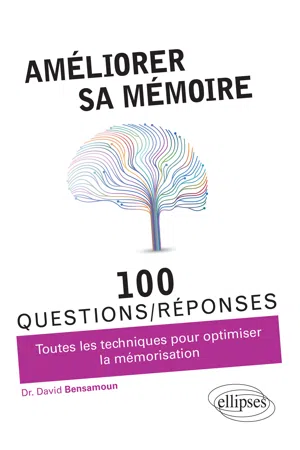![]()
![]()
11 L’alimentation influence-t-elle le fonctionnement cérébral ?
Notre état nutritionnel peut influencer notre efficacité cérébrale comme le démontrent les états de dénutrition. La dénutrition peut s’exprimer par de simples difficultés attentionnelles s’exprimant par des erreurs d’inattention ou des difficultés de concentration. Si elle est sévère elle peut entraîner une confusion totale qui elle s’exprime entre autres symptômes par une désorientation dans le temps et l’espace ainsi que des troubles de la vigilance pouvant mener au coma. En dehors de la correction des états de dénutrition avérés, on ne retrouve pas de gain spectaculaire à l’amélioration des fonctions cérébrales lors d’une modification alimentaire concernant un seul nutriment isolément chez le sujet sain non dénutri. Cependant les études scientifiques qui évaluent les fonctions cérébrales selon l’apport en une substance précise retrouvent des différences significativement bénéfiques concernant de nombreux nutriments. En modifiant quelques habitudes alimentaires par la réduction et l’augmentation de certains apports il serait ainsi possible d’optimiser les gains en matière de performances intellectuelles. De plus, le caractère préventif d’une bonne hygiène alimentaire est démontré dans le cas du vieillissement cérébral. Il reste la question des quantités minimales nécessaires, des effets cumulés de la combinaison d’aliments qu’il est difficile de déterminer précisément dans les conditions expérimentales.
![]()
12 Quel est le principal mécanisme qui lie alimentation et cerveau ?
Plusieurs hormones intervenant dans le cycle de la faim et de la satiété présentent un effet sur les fonctions cérébrales. La leptine (hormone qui diminue la faim) et la ghréline (qui augmente la faim) favorisent développement des connexions neuronales, favorisant la mémoire à long terme. L’insuline, qui permet de faire entrer le sucre dans les cellules, est secrétée depuis l’anticipation du repas jusqu’à la digestion. L’insuline serait délétère aux processus intellectuels comme le démontrent les études en laboratoires sur l’insulinorésistance et certains diabètes. L’insulinorésistance apparaît plus facilement chez la personne en excès de poids. La stimulation hormonale déclenche en cascade des réactions chimiques aboutissant au final à l’activation ou la répression de la synthèse de BDNF. Le BDNF est un promoteur du développement des neurones permettant d’activer la naissance de nouveaux neurones et de stimuler les neurones déjà existants à former de nouvelles connexions. Pour cela il provoque une stimulation au niveau de la lecture des gènes qui aboutira à la production de protéines nécessaires à la prolifération des neurones. Le métabolisme du BDNF est influencé par celui de l’insuline expliquant son lien avec l’alimentation. Ceci est un exemple général parmi les nombreux mécanismes associant nutrition et performances cérébrales.
![]()
13 Pourquoi éviter la malnutrition est important pour son cerveau ?
Notre cerveau est un organe qui se nourrit essentiellement de sucre et les éléments nécessaires à son bon fonctionnement ne sont pas toujours synthétisables par le corps. Au niveau des lipides, c’est le cas par exemple de la docosahaexaenoique (DHA). La DHA est un lipide qui compose la membrane cellulaire des cellules du cerveau et malgré son abondance nécessaire, sa synthèse par l’organisme est faible et sa provenance est donc principalement due à l’alimentation. Il existe aussi des acides aminés (briques élémentaires permettant de construire des protéines) dit essentiels, dont l’apport doit s’effectuer exclusivement par l’alimentation car ils ne sont pas synthétisables par l’organisme. L’exemple le plus simple est celui du tryptophane, c’est un acide aminé, qui permet la synthèse de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui intervient dans le système d’éveil et des émotions du cerveau. Une carence en tryptophane entraînera rapidement l’apparition de symptômes s’apparentant à une maladie dépressive. L’apport de ces acides aminés doit être assuré par la consommation de protéines dont les sources principales sont les œufs, les viandes, poissons et laitages.
![]()
14 Quel effet des sucres sur le fonctionnement cérébral ?
Bien que le cerveau se nourrisse de sucres, un excès chronique peut entraîner l’insulinorésistance ou certains diabètes. L’excès chronique engendre des difficultés cognitives s’exprimant par un déficit d’apprentissage chez l’homme et l’animal. L’impact des sucres raffinés a d’abord été identifié comme altérant le système cardiovasculaire par athérosclérose, c’est-à-dire en favorisant la détérioration progressive des artères par dépôt de cholestérol dans leur paroi. Les artères cérébrales peuvent être fines, comme pour l’hippocampe. L’hippocampe, structure importante pour la mise en mémoire à long terme, est vascularisé par des artères dites « terminales ». Fines et fragiles, elles sont les « dernières pousses » de l’arborescence du réseau vasculaire d’un point de vue de l’évolution. Ces artères terminales arrivent tout au bout de la chaîne du transport d’oxygène. L’hippocampe est donc facilement atteint par défaut d’irrigation vasculaire en cas d’athérosclérose provoquant alors sont atrophie et en conséquence des troubles de la mémoire à long terme. Le cortex frontal participe aussi aux processus d’utilisation de la mémoire et est aussi sensible à l’altération artérielle générale provoquée par un diabète ancien. L’ajout de sucre en trop grandes quantités sur les protéines peut aussi stresser l’organisme en changeant la fonction de ces protéines et provoquer la création de perturbations du métabolisme induction d’un stress oxydatif (voir Question 23). D’autres études sur les sucres raffinés montrent qu’il existe un impact sur la plasticité cérébrale par une diminution du BDNF (voir Question 12) provoquée par ces sucres. L’apport excessif de sucres particulièrement à absorption rapide est à surveiller.
![]()
15 Quelles recommandations pratiques concernant les sucres pour mon cerveau ?
L’hypoglycémie est bien sûr nuisible pour l’organisme et particulièrement pour le cerveau qui utilise le sucre pour fonctionner. Elle doit donc être évitée car même s’il est aisé de la corriger sans séquelle évidente, ce phénomène peut entraîner une mort neuronale à hauteur de sa gravité. Dans l’alimentation, on retrouve deux types de sucres, les sucres raffinés d’absorption rapide et les sucres non raffinés d’absorption plus lente car ils doivent être dégradés afin d’être absorbés. Les sucres rapides doivent constituer moins de 5 % des apports énergétiques totaux (soit l’équivalent de 6 cuillères à soupe maximum). Les sucres raffinés se retrouvent dans les plats industriels (voir Tableau 2). Il faut éviter les sucres rapides des sodas et jus de fruits, même de fruits frais afin de ne pas subir une abs...