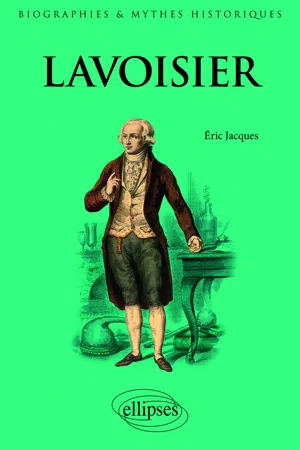![]()
I
PLUS QU’UN CHIMISTE
![]()
CHAPITRE 1
UN CHOIX INATTENDU
Rien ne semblait prédisposer Antoine-Laurent Lavoisier à devenir un chimiste remarquable. Né à Paris le 25 août 1743 dans une famille bourgeoise comptant des avocats, des notaires, des huissiers, des procureurs et quelques marchands, Lavoisier s’oriente vers des études littéraires sans ambitionner à faire carrière dans les sciences, que ce soit les mathématiques ou la physique.
Lavoisier est d’ailleurs très indécis et va à plusieurs reprises interrompre ses études (deux fois) avant de choisir une carrière professionnelle sans aucun rapport avec sa formation. Mais Lavoisier a la chance de pouvoir faire ces choix car sa famille, dès son enfance, est assez riche.
Son père Jean-Antoine est originaire de Villers-Cotterêts. Il avait fait ses études de droit à Paris et en 1741, était devenu procureur. Il avait hérité cette charge de son oncle maternel, Jacques Waroquier qui, resté sans descendance, lui avait cédé non seulement sa fortune, sa maison mais également son étude située dans une impasse. Jean-Antoine avait alors épousé Émilie Punctis en 1742 et ils avaient tous les deux emménagé dans cette maison.
Située impasse Pecquet, c’est la maison natale de Lavoisier et de sa sœur, Marie-Marguerite, née deux ans plus tard en 1745. Les Lavoisier ne restent pas longtemps dans cette maison. En 1748, Émilie, de santé fragile, finit par succomber d’une maladie due à sa faible constitution. Jean-Antoine qui ne se voit pas élever seul ses deux enfants, part s’installer chez sa belle-mère, Marie-Thérèse Frère, à quelques rues de là, rue du Four Saint-Honoré, près de l’église Saint-Eustache.
La grand-mère de Lavoisier ne sera pas la seule à s’occuper des enfants de sa défunte fille. Après la mort de son mari, Clément Punctis, en 1747, elle vivait ici avec son autre fille, Constance, qui n’avait pas trouvé d’époux. C’est elle qui allait devenir la mère d’adoption des enfants de sa sœur.
La petite famille « recomposée » se serre les coudes. Les parents souhaitent le meilleur pour les enfants. Tandis que l’on ne sait quasiment rien sur l’éducation de Marie-Marguerite, Antoine-Laurent quant à lui, entre au Collège Mazarin en 1754 pour y faire ses études de la sixième à la classe de rhétorique et de philosophie. Son père a les moyens de lui prodiguer une éducation remarquable. Le collège est un établissement d’élite qui accepte les pensionnaires extérieurs et où les cours ne sont pas donnés. Mais Jean-Antoine a les moyens. Au fil des générations, les Lavoisier étaient à présent devenus une famille aisée et bourgeoise.
Dans les quatre familles, Waroquier, Frère, Punctis et Lavoisier, on trouvait à présent des notaires, des avocats et des procureurs. Et depuis les débuts du XVIIe siècle, de toutes les branches des Lavoisier originaires de Villers-Cotterêts, de Vivières, de Pierrefonds ou de Taillefontaine, au moins un descendant masculin de la famille portait le prénom d’Antoine. Depuis le chevaucheur pour les écuries du roi né en 1600 en passant par son fils maître des postes ou son petit-fils huissier à Villers-Cotterêts, que ce soit le laboureur de Taillefontaine ou son frère, le procureur puis garde-marteau des eaux et forêts, on trouve dans toutes ces branches, au moins, un Antoine Lavoisier. Il ne pouvait en être autrement du premier prénom de notre héros. Quant au prénom Laurent, il venait de l’oncle de Jean-Antoine, Laurent Waroquier, prêtre et proviseur à Beauvais. Il sera donné à Lavoisier à son baptême.
Quant au prénom de sa sœur, il venait de la famille de sa mère. La tante Constance le portait elle aussi. Et sa tante à elle, Marie-Marguerite Frère, honorait cette affection particulière dans la famille. Il semble malheureusement que la sœur de Lavoisier ait hérité de sa mère une santé tout aussi fragile. Marie-Marguerite décède à l’âge de quinze ans en 1760. Dans la maison Punctis « rue du Four près Saint-Eustache », il ne reste plus à Lavoisier que sa grand-mère Marie-Thérèse, son père Jean-Antoine et sa tante Constance. Celle-ci sera encore plus proche de son neveu et passera le reste de sa vie à le supporter dans ses divers projets. Son père ne sera pas en reste, lui non plus, suivant ses efforts avec intérêt et fierté. Lui, s’est lancé à corps perdu dans ses études, un bon moyen d’oublier la souffrance et la tristesse de perdre l’un après l’autre les membres aimés de sa famille. Que va-t-il faire dans la vie ?
Sa voie semble toute tracée…
ÉTUDES LITTÉRAIRES ET DIPLÔMES EN DROIT
La formation littéraire de Lavoisier est des plus rigoureuses. Le Collège des Quatre Nations où il fait ses classes fut financé par le cardinal Mazarin. Cet établissement destiné à prodiguer des enseignements aux fils de la noblesse des nations alliées de la France, dont les professeurs étaient triés sur le volet et sur concours, accueillait également des élèves externes, comme Lavoisier. Celui-ci se verrait bien auteur de pièces de théâtre et griffonne les débuts d’un drame, La Nouvelle Héloïse, dont il n’écrira qu’une dizaine de pages. Lavoisier se verrait bien poète, dramaturge ou littérateur, la carrière des lettres étant une attraction à la mode au pays d’auteurs aussi prestigieux que La Fontaine, Racine ou Corneille. Si ceux-ci sont des légendes du XVIIe siècle, il en existe d’autres qui vivent encore en chair et en os et qui sont en mesure d’inspirer la jeunesse comme le très célèbre François-Marie Arouet qui est à Paris en ces années 1760 et que l’on connaît mieux sous le nom de Voltaire. Mais Lavoisier hésite. Les lettres ne sont peut-être pas pour lui.
Conseillé par son père à poursuivre dans une voie que lui connaît bien, le droit, Lavoisier arrête ainsi son cursus en philosophie (en 1761) pour s’orienter vers le droit et obtenir son baccalauréat. Bachelier le 6 septembre 1763 et licencié en droit le 26 juillet 1764, le voici prêt à perpétuer la tradition familiale.
Reçu au barreau de Paris, Lavoisier peut maintenant plaider ou s’associer aux tâches relevant du Parlement qui était sous l’Ancien Régime, une Cour de Justice « indépendante » jugeant les affaires de sa compétence et s’acquittant également de tâches d’enregistrements au greffe. Le choix n’était pas mauvais. C’est au Parlement que se jugeaient les affaires criminelles. C’est par le Parlement que tout document officiel se devait d’être enregistré, un enregistrement rémunéré à la fois pour le greffe et pour le roi par l’intermédiaire d’un timbre dont la somme était recouverte par la Ferme générale. Les procureurs du Parlement possédaient un pouvoir non négligeable et une charge capable de contribuer à leur richesse. C’était d’ailleurs ce que l’on faisait dans sa famille depuis au moins deux si ce n’est trois générations. Lavoisier n’avait qu’à suivre la tradition. D’ici peu, son père partirait à la retraite (il a cinquante-et-un ans en 1766), lui léguerait sa charge et il deviendrait à son tour procureur au Parlement. Le travail d’avocat serait ainsi un bon début et poursuivre par une charge de procureur promettait une carrière intéressante avec pourquoi pas l’idée de devenir un jour président de tribunal ou avocat général.
Mais en fait, il y a des domaines bien plus attractifs que le droit que l’on trouve à Paris. Une nouvelle fois dans son cursus Lavoisier s’interrompt, s’arrête, cherche autre chose. Il se laisse, et il en a les moyens, le temps de la réflexion. Car ce n’est qu’en 1768, quatre ans après la fin de ses études qu’il va embrasser une carrière et avoir une profession.
Mais alors entre 1764 et 1768 que fait-il donc ?
RENCONTRE AVEC LES SCIENCES
Le père de Lavoisier a des relations et des fréquentations importantes. Dans cet entourage ne gravitent pas uniquement des avocats ou des personnalités d’une certaine noblesse. Il y a également des savants appartenant à une compagnie réputée qui forme l’Académie Royale des Sciences, un groupe d’experts scientifiques au service du roi. On y trouve des astronomes, des médecins, des mathématiciens, mais aussi des aventuriers partis mesurer le méridien terrestre ou établir les cartes minéralogiques du Puy-de-Dôme pour en déduire la nature de ses volcans par exemple. Certains d’entre eux sont réputés. Il y a ainsi parmi les relations de Lavoisier père l’astronome Maraldi, le botaniste Duhamel du Monceau ou encore le géologue et minéralogiste Guettard. D’autres membres de l’Académie sont encore plus célèbres : La Condamine, parti mesurer le méridien terrestre au Pérou, d’Alembert, mathématicien et philosophe ou encore George-Louis Leclerc, comte de Buffon, Intendant des Jardins du Roi.
Ces savants donnent le goût des sciences à Lavoisier et chose remarquable, il est possible de suivre les cours de certains d’entre eux car ces académiciens sont aussi des professeurs enseignant dans des cours publics ou privés dans Paris. Ainsi, tandis que Lavoisier poursuit ses études de droit à la Sorbonne, il va également s’intéresser à l’astronomie, la botanique, l’anatomie, la minéralogie, la chimie et l’électricité. Cet appétit pour les sciences avait déjà été développé durant la dernière année d’étude que fit Lavoisier au Collège Mazarin où il rencontra un professeur d’exception, un savant aventurier du nom de Nicolas-Louis La Caille.
En 1754, l’abbé La Caille était revenu d’un voyage d’exploration pour la mesure du méridien terrestre. S’il enseignait les mathématiques, La Caille était également professeur d’ast...