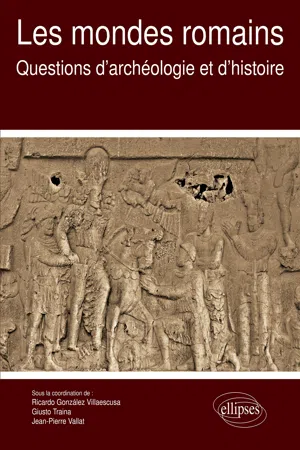![]()
Quatrième partie
LES CAS D’ÉTUDES
![]()
Chapitre 23
LE LATIUM ET ROME, DE L’ÂGE DU BRONZE À L’ORIENTALISANT RÉCENT
A. GRANDAZZI
« La méthode qui peut nous conduire au vrai dans quelque étude que ce soit, c’est celle qui sait encore faire la différence des diverses espèces de certitude propres à chaque science et à chaque matière. ». Nicolas Fréret, 1724.
L’archéologie a, depuis une quarantaine d’années, rénové en profondeur la question dite des origines de Rome : elle en a élargi l’horizon spatial aux dimensions de l’ensemble de l’Italie centrale, tout en l’inscrivant dans une très longue durée qui va de l’âge du bronze à la fin de l’orientalisant. Ce ne sont pas seulement les données surgies du sol qui ont augmenté en quantité et en qualité ; les questionnements élaborés pour en comprendre la portée se sont enrichis également de l’apport d’autres disciplines, qu’il s’agisse d’anthropologie et d’histoire des religions, de linguistique et de mythologie comparées, de toponymie et de topographie, sans parler de la céramologie et de la restitution des paléo-environnements permise par les modernes techniques de fouille et le recours aux sciences de la terre. Les données apportées tant par de nombreuses nouvelles fouilles que par l’exploitation de campagnes de prospection de surface sont maintenant traitées par le biais de modélisations informatiques qui éclairent l’évolution des territoires et les transformations qu’y provoque l’occupation humaine. Des interrogations, hier insolubles, trouvent une réponse, tandis que de nouvelles questions, insoupçonnées jusqu’ici, viennent au premier plan de la recherche.
Le cadre géographique à considérer est celui du Latium ancien, Latium vetus, dont les limites sont, au nord-ouest et à l’ouest, nettement marquées par le Tibre et par la mer Méditerranée (ou Tyrrhénienne), au nord-est et à l’est par des avant-postes de la chaîne Apennine que prolongent, sur le côté occidental du couloir formé par les vallées du Sacco et du Liri, les monts Lepini et Ausoni, rejoignant, au sud, le promontoire maritime du mont Circé : à l’intérieur de ces limites s’étend, continuée au nord par l’échancrure de la haute vallée du Tibre, une grande plaine côtière, surélevée en son centre par le massif Albain, d’origine volcanique. Situé sur le versant occidental de la péninsule italienne, le Latium dispose ainsi d’une importante façade maritime, et se trouve bordé par le fleuve qui est le second en importance dans la péninsule. Région-carrefour peu étendue (4/5 000 km²) et dépourvue de ressources minières, mais où se croisent les itinéraires reliant, d’une part, l’Etrurie du nord-ouest, à la Campanie du sud-est, et, d’autre part, l’intérieur montagneux aux étendues littorales.
La chronologie concernée va de l’âge du bronze jusqu’à la fin de l’orientalisant, soit du XXIIIe au VIe siècle avant notre ère (comme toutes les dates indiquées ci-après). Les découvertes récentes ont entraîné un rehaussement des datations élaborées dans les années 1960 et provoqué des ajustements encore en cours.
Au Bronze ancien (env. 2300-1700 av. J.-C.), l’habitat est rare, dispersé, réduit (maximum d’une centaine de personnes par unité) et relativement mobile en fonction d’une exploitation des ressources naturelles encore itinérante. Lorsque la population d’un village se met à dépasser les ressources disponibles, un autre village est créé aux alentours. Le massif Albain, avec le village lacustre dit « delle Macine » et la plaine très fertile de Ciampino, au sud-est de la future Rome, sont les aires les plus peuplées. Sur le site romain, des traces apparaissent dans l’aire de Sant’Omobono, signe probable de l’implantation d’un hameau sur la colline du Capitole.
Au Bronze moyen (env. 1700-1400 av. J.-C), il y a une première densification des habitats, non seulement dans le massif Albain, mais aussi sur les contreforts des monts Lepini, ainsi que sur la côte maritime. Les villages, dont plus du tiers sont de type lacustre, sont, à une petite heure de marche les uns des autres, chacun au centre d’un territoire d’un rayon d’environ 2,5 km, et leurs populations pratiquent une horticulture de subsistance plus qu’une vraie agriculture.
De 1400 à 1300, d’importants changements surviennent : la côte se dépeuple, ainsi que la plaine de Ciampino ; ailleurs, se produisent des processus de déplacement, voire de dédoublement des villages précédents, comme sur les sites de Lavinium et de Rome, avec le Capitole et le Palatin, les préoccupations défensives commençant à influer sur le choix des habitats.
Au Bronze récent (env. 1300-1150), ces évolutions s’accentuent. Le massif Albain se densifie encore et au bord du lac de Nemi, un sanctuaire, correspondant au futur temple de Diane, se révèle par le biais d’un grand dépôt votif, dont les céramiques comportent déjà certaines spécificités régionales : signe probable de la formation d’une identité fédérative, ici et sans doute aussi sur le tout proche monte Cavo, mons Albanus, lieu du (futur ?) culte de Jupiter Latiaris. C’est à partir de cette époque qu’il faut supposer que les Latins exportent chez les Proto-Villanoviens, au-delà du Tibre, plusieurs de leurs divinités, dont Mars, Minerve, Junon, Neptune et Saturne. L’ethnogenèse latine apparaît en effet beaucoup plus précoce qu’on ne l’a longtemps pensé quand, dans les années 1970, on la fixait, au plus tôt, au VIIe siècle. Sur la côte, au sud, et peut-être aussi vers Ostie, commence une exploitation (impliquant l’usage de grands récipients dont les tessons sont bien repérables), ample et systématique, de marais salants : cause d’une progressive différenciation sociale qui se manifestera par l’apparition des premières urnes-cabanes (site de Cavallo Morto, près de Nettuno), rite funéraire réservé à une élite qui commerce avec le monde égéen, sans doute par l’intermédiaire de trafiquants basés en Sicile. Parallèlement, la culture des céréales et des légumineuses se développe, tandis que les habitats se regroupent, pour près du tiers d’entre eux, sur des hauteurs facilement défendables : ainsi dans le site de Rome, mais aussi dans ceux de Ficana, d’Ardée et de Lavinium.
Durant le siècle suivant, qui marque le début du Bronze final (env. 1150-1050), la plupart (74 %) des habitats précédents continuent à exister, preuve que les populations y ont atteint une certaine stabilité, tout en connaissant une nette croissance. En effet, les bourgs les plus importants essaiment à leur périphérie, comme c’est le cas sur la côte maritime, où trois centres, correspondant aux futures cités de Ficana, de Lavinium et d’Ardée se partagent la totalité du littoral. On ne peut pas ne pas penser au ver sacrum, cette tradition rituelle de « printemps sacré » selon laquelle la jeunesse d’une communauté pouvait être amenée à migrer vers de nouvelles terres. Phénomène très récemment identifié : les premières fortifications, faites seulement de bois et de terre, apparaissent. À Laurentina Acqua Acetosa, dès le XIIe siècle, et aussi au Monte Cimino, près d’Antium, ainsi que sur l’acropole de Lavinium et sur le Capitole. Le territoire dépendant du site romain, où le Palatin est occupé lui aussi, au moins en partie, semble d’ailleurs avoir doublé de superficie, les autres habitats les plus proches étant maintenant à deux bonnes heures de marche, vers le sud-est, du côté de la plaine de Ciampino.
Le siècle (env.1050-950) qui marque la dernière période du Bronze...