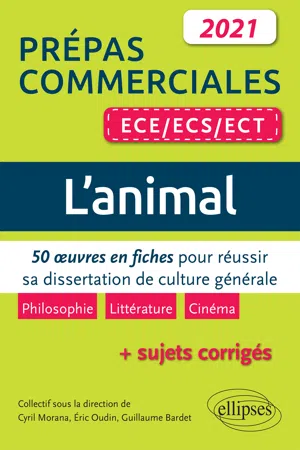![]()
Philosophie
![]()
Aristote, Corpus biologique et politique,
Parties des animaux, Histoire des animaux, Les Politiques, etc.
Ou l’animal inférieur à l’homme
Aristote naît en 384 avant J.-C. à Stagire dans une famille de médecins qui prétend tenir son art d’Esculape lui-même. À la mort de son père, en 367, Aristote se rend à Athènes et est admis dans l’Académie fondée par Platon. Platon ne tarde pas à remarquer les qualités intellectuelles du jeune homme et lui confie rapidement des tâches d’enseignement. Il y demeurera vingt ans, jusqu’à la mort de Platon. Aristote prend alors quelques distances avec l’Académie. En 342, Aristote est appelé par Philippe de Macédoine afin qu’il devienne le précepteur de son fils, Alexandre. L’instruction du jeune prince durera sept ans jusqu’à la mort de Philippe et la montée d’Alexandre, devenu « le Grand », sur le trône. Alexandre restera toute sa vie fidèle à son maître et à son enseignement. Des pays conquis (qui vont jusqu’aux rives de l’Indus), il lui fera parvenir des spécimens d’espèces inconnues, végétales, animales ou fossiles et des ouvrages de toute nature, qui passionnent le philosophe. Aristote sera ainsi en possession d’une bibliothèque et de collections, notamment zoologique, sans exemple dans le monde antique. Aristote fonde ensuite le Lycée à Athènes, école rivale de l’académie platonicienne. Les œuvres d’Aristote, que nous avons conservées et qui n’ont jamais été publiées par lui, sont en fait composées des notes dont il se servait pour faire ses cours. Ce génie universel a non seulement laissé une œuvre philosophique à nulle autre pareille, mais également scientifique. Ses recherches en biologie et en zoologie resteront un modèle des sciences de la vie pendant plus de 2000 ans !
I. Zoologie philosophique
Ce n’est pas parce qu’Aristote est un véritable « touche à tout » qu’il ne poursuit pas un objectif unificateur de ses recherches. Aussi, lorsqu’il s’intéresse notamment aux animaux, c’est pour mieux s’efforcer de cerner et de saisir, à travers l’incroyable diversité du vivant, l’Être, autrement dit la réalité fondamentale, la substance, ce qui subsiste derrière toute la multiplicité qui ne cesse de se transformer et de se modifier ici-bas.
Dans la nature, on trouve une quantité très variée d’êtres vivants (les zôia). Dans son Histoire des animaux (notamment en I, 16 et V, 1), Aristote précise que la forme de vie qui nous est la plus familière est bien évidemment celle de l’homme, un être « animé » au milieu d’autres « êtres animés ». Aussi, peut-on dire que l’homme est un animal parmi les autres, en ce sens qu’il est un «?vivant » (du latin animalis « animé, vivant, animal »). À cet égard, l’animal-homme se trouve sur la même échelle que les minéraux, les plantes, les autres animaux mais aussi les dieux. Certes, cette échelle des vivants connaît des niveaux de hiérarchie : des minéraux, passifs et immobiles, jusqu’aux dieux, vivants suprêmes, on est plus ou moins « achevé », toutefois, le point commun de ces êtres est que, tous, ils vivent. Cela signifie qu’ils sont tous doués d’une âme plus ou moins évoluée.
L’homme est le genre d’animal le plus remarquable du monde sublunaire. En effet, l’homme n’a pas seulement une âme «?végétative » (nutritive) comme les plantes, qui permet la survie, une âme « sensitive » (faculté de sentir), qu’il a en commun avec d’autres animaux, il est également doué d’une âme « intellective » (la faculté de connaître), dimension supérieure de l’âme qu’il est le seul à posséder (Parties des animaux, II, 10, 656a).
C’est au fond la seule ligne de démarcation véritable qu’aperçoit Aristote entre l’homme et le reste des animaux. La supériorité de l’homme sur l’animal se joue ainsi sur la possession d’un logos (la raison, « la part divine » de l’homme). De plus, les animaux étant moins complexes que l’homme, il est souvent plus commode de commencer par eux, par exemple pour comprendre les processus de la génération, qui intéressent beaucoup Aristote, mais plus largement, tous ceux de la vie en général. Il faut ici relever un paradoxe : certes, la biologie humaine constitue le modèle principal et supérieur de la biologie animale, mais la procédure suivie pour connaître ce vivant qu’est l’homme passe souvent d’abord par l’étude des formes qui lui sont inférieures (les autres animaux). Ainsi la constitution anatomique et le comportement d’un grand nombre d’animaux deviennent-ils les objets d’une véritable science zoologique, fondée, à partir de la dissection, sur l’observation des organes, de la physiologie. Aristote va même jusqu’à décrire des caractères et des genres de vie animaux (il sème ainsi les germes de la future éthologie). Du reste, d’après l’hylémorphisme aristotélicien (définition des êtres vivants comme des composés de matière [hylè] et de forme [morphè]), le corps et l’âme subissent corrélativement des affections naturelles, de sorte qu’il y a des signes extérieurs des affections – comme ceux du courage chez les lions : ainsi peut-on « juger » des phénomènes biologiques « d’après les apparences » (Premiers analytiques, II, 27).
Parfois, lorsqu’il s’agit de caractériser le comportement (par exemple, la stupidité du sanglier, l’orgueil du paon, etc.), Aristote n’hésite pas à remettre en question la séparation de principe entre humanité et animalité. Il n’y aurait alors que des différences de degré entre l’homme et les animaux, ce qui justifie qu’on établisse entre eux des rapports d’analogie : « ainsi, ce qui chez l’homme est art, sagesse, intelligence, peut trouver son correspondant, chez tel ou tel animal, en quelque faculté naturelle du même genre » (Histoire des animaux, VIII, 1).
II. L’animal politique
On peut aisément constater que les animaux communiquent entre eux. Cependant, Aristote reste fondamentalement anthropocentriste. Ainsi, dans un texte célèbre, il rétablit clairement la différence homme-animal : tandis que la voix [phônè] animale exprime le plaisir et la douleur, la parole (autre sens complémentaire de logos), proprement humaine, traite d’une manière réfléchie de l’utile et de l’inutile, et du juste et de l’injuste (Les politiques, I, 2), ce qui rend possible une vie en Cité. Intéressons-nous de plus près à ce texte particulièrement célèbre et important.
Chez Aristote, la notion de nature a une acception plus large que la nôtre : il ne s’agit pas simplement de la faune et de la flore, mais également d’un tout harmonieux et ordonné sur un mode « téléologique », autrement dit, la nature vise un télos, un but, elle ne fait jamais rien par hasard ni en vain. Aussi, quand Aristote affirme, dans Les politiques, que « l’homme est un animal politique » (politikon zôon), il veut dire que de par sa nature (donc selon le but visé par la nature), l’homme est voué à la Cité (polis en grec) et celui qui aurait la prétention de s’en abstraire – inhumain ou surhumain, « bête ou dieu » comme il le dit –, perdrait du même coup son humanité. Que faut-il comprendre ? Que le social d’une part constitue en lui-même le milieu dans lequel se réalise l’humanité de l’homme, c’est-à-dire sa spécificité par rapport aux autres animaux. En effet, à la différence des autres animaux sociaux, qui, certes semblent bel et bien vivre à plusieurs en société, les hommes sont doués d’un langage qui leur permet, par la délibération, de s’entendre sur le monde social auquel ils appartiennent. En somme, si l’animal vit en société, il ne vit pas pour autant en société « politique » (en Cité), régie par des lois auxquelles on parvient par délibération et dialogue, comme l’homme le fait. Dans l’ordre logique, et non plus simplement chronologique ou historique, les cités sont premières et les structures présociales, comme la famille ou les villages, obéissent à un finalisme : la finalité des familles est de donner naissance aux Cités.
Toutefois, ce texte d’Aristote ne laisse pas d’être ambigu. En effet, tout d’abord, si l’homme, plus que tout autre animal, est voué par nature à la vie en Cité, et si la nature fait bien les choses, comment expliquer que les sociétés politiques soient constamment troublées et menacées de l’intérieur à la différence des sociétés animales, où les individus sont comme des poissons dans l’eau ? D’autre part, Aristote souligne dans son texte que l’homme est un animal politique à un plus haut degré que les abeilles et les autres animaux dits « sociaux », de sorte qu’il convient de reposer la question de la différence véritable entre l’homme et l’animal, différence qui semble définitivement se poser en termes de degré bien davantage que de nature…
Pour aller plus loin
– Il convient de lire Aristote avant tout. Les parties des animaux, Livre I, par exemple, dans la belle édition de Le Blond, chez Aubier, 1945. Pierre Pellegrin a écrit La classification des animaux chez Aristote, aux Belles Lettres, en 1982, qu’on pourra consulter avec profit….
![]()
Lucrèce, De la nature des choses
Ou l’indiscernable différence entre homme et bête
Les connaissances que nous avons de la vie de Lucrèce se réduisent à peu de choses. On suppose qu’il serait né en 95 avant J.-C et qu’il se serait donné la mort en 51. Son œuvre, De la nature des choses, un long poème versifié, est un exposé de la doctrine d’Épicure (342-270 av. J.-C.). Dédicacé à Memmius, l’ouvrage témoigne du lien probable de son auteur avec cet homme politique influent. Comme son maître Épicure, Lucrèce appartient au courant des penseurs matérialis...