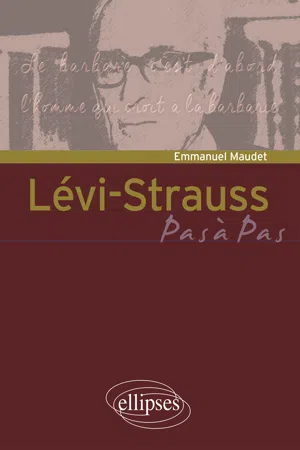Chapitre 1
Son émergence
Introduction
La notoriété du structuralisme lévi-straussien peut faire obstacle à son introduction ; il est en effet aujourd’hui si célèbre que l’on encourt le risque de perdre de vue ce qu’il fut d’abord, à savoir une manière radicalement différente de faire de l’ethnologie. Lévi-Strauss est en effet un anthropologue tout à fait singulier qui, le plus souvent, rompt sans ménagement avec le passé et la tradition de sa discipline. Son structuralisme a constitué une véritable révolution, qui a surpris, choqué, scandalisé. Certains y ont vu l’œuvre d’un génie inimitable, d’autres une colossale perte de temps, tous s’accordant à reconnaître l’extrême originalité d’une démarche à nulle autre pareille. Avant de devenir fameux, Lévi-Strauss fut, et reste, un ethnologue unique en son genre et c’est sa si spéciale singularité que nous allons essayer, dans cette première partie, de mettre en avant.
Pour saisir la grande originalité du structuralisme lévi-straussien, nous procédons en trois temps. D’abord, dans un premier chapitre, nous rappelons rapidement ce qu’est, de manière générale, l’ethnologie. Ne faut-il pas en effet en connaître un minimum l’histoire afin d’apprécier à juste mesure l’impact du geste lévi-straussien ? Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous voyons en quoi Lévi-Strauss étonne ses contemporains par son ambition, inattendue dans le champ des sciences humaines. Enfin, dans un dernier chapitre, nous relevons, non comme une évidence trop souvent véhiculée, mais comme l’énigme qu’elle est, la connexion stupéfiante que Lévi-Strauss établit entre le structuralisme linguistique et sa propre approche anthropologique.
Car ce n’est pas parce que tout le monde sait aujourd’hui que sa pensée innove d’injecter dans le champ ethnologique les découvertes linguistiques du début du XXe siècle que cette dette s’éclaire pour autant. Il ne suffit pas de dire que Lévi-Strauss emprunte à la linguistique, il faut encore, pour quiconque veut saisir l’émergence du structuralisme anthropologique, être à même de l’expliquer. C’est là du moins ce que nous tenterons.
I. La naissance de l’anthropologie
Afin d’introduire efficacement à la pensée de Lévi-Strauss, il convient d’abord de prendre un peu de recul, de retarder l’examen de son structuralisme dans le but de s’informer sur ce qu’était l’ethnologie avant qu’il n’entreprenne de la bousculer. Comment saisir autrement l’ampleur de son entreprise clairement révolutionnaire ? Prenons donc le temps de parler de l’ethnologie d’avant Lévi-Strauss. À quel moment apparaît-elle exactement ? Après tout, les Grecs déjà manifestaient une grande curiosité à l’égard des autres peuples. Ont-ils pour autant inventé cette discipline particulière ? Si ce n’est pas le cas, que leur manquait-il donc ? Nous essaierons de le voir. Sa date de naissance précisée, nous verrons ensuite, par l’exemple, que, comme toute branche du savoir, son histoire fut l’objet de révolutions épistémologiques variées. L’ethnologie n’a bien sûr pas attendu Lévi-Strauss pour se changer et s’améliorer. Cette histoire en raccourci s’achèvera avec la nette rupture opérée par Malinowski, rupture dont on peut penser qu’elle jette les bases de l’ethnologie moderne… et dont on ne voit pas, directement, la criante insuffisance qui nécessiterait une quelconque refondation.
1. Les récits de voyage
Un genre à part entière
Si l’on cherche à savoir quand commence l’ethnologie, le plus simple consiste, bien évidemment, à repérer quand, exactement, apparaît le mot. L’on sait ainsi précisément dater l’acte de naissance de mots comme « transhumanisme » ou « biologie ». Il doit pouvoir en être de même pour « ethnologie ». Toutefois, le transhumanisme apparaît-il bien en 1957, si par ce terme on l’entend l’idée qu’un jour il sera possible d’améliorer l’humain en modifiant son corps ? De même, faut-il attendre 1802 pour que l’on questionne la vie ? On pourrait ainsi multiplier les exemples : la date de naissance d’une discipline n’est pas équivalente à celle du mot qu’elle désigne. Les deux sont liés, mais chercher à cerner l’émergence d’une nouvelle branche du savoir impose certaines questions qu’une recherche étymologique fourvoie d’étouffer.
Laissons donc, ne serait-ce que temporairement, de côté la question de savoir quand apparaît le mot d’ethnologie pour nous intéresser à la curiosité que les hommes eurent envers d’autres cultures. À se demander quand apparaît cette dernière, les récits de voyage fournissent une première réponse. Aussi loin que l’on puisse remonter, l’homme semble s’être enquis des cultures autres. L’ethnologie, en ce sens, en cette forme somme toute préhistorique, n’est-elle pas aussi vieille que l’homme ? Prenons le temps, pour le montrer, de déplier ce que nous entendons par « récit de voyage ». Il s’agit de textes littéraires qui se distinguent par au moins trois traits saillants.
Le premier renvoie à la contingence du voyage : notre aisance technique contemporaine ne doit pas nous faire oublier que pendant très longtemps, le voyageur prenait un risque, le voyage en lui-même était une expérience éprouvante. Il y a quelque chose d’héroïque dans l’acte de quitter son territoire et le confort douillet de son chez soi afin de partir à l’aventure. Hérodote, en bon explorateur, l’indique le premier. Si les sources du Nil restent longtemps inconnues, c’est parce que traverser un désert n’est pas simple. On trouve dans tous les récits de voyage ce même lieu commun : le voyageur est d’abord un homme qui accepte de prendre des risques, mettant souvent en jeu sa vie même, comme l’indique Joinville, rappelant en ces termes l’extrême dangerosité du voyage maritime : « on s’endort le soir sans savoir si on se retrouvera le matin au fond de la mer ». Comment ne pas penser aussi à Colomb, qui non seulement prend la mer mais s’engage qui plus est dans une direction jamais empruntée ? Un récit de voyage, c’est d’abord cela : un narrateur qui force l’admiration.
Parallèlement à cela, intrinsèquement lié au premier, le récit de voyage se caractérise aussi par la sincérité du voyageur ; il s’agit là de son deuxième trait caractéristique. Celui qui narre ses aventures se doit d’inspirer confiance : sans gage donné de son honnêteté, son récit perdrait tout intérêt. Genre narratif et descriptif d’un monde encore inconnu, le récit de voyage se doit d’être cru, lui qui se veut vrai. Ainsi, tout récit de voyage dessine le portrait, avantageux, du narrateur et expose les raisons singulières qui méritent qu’on lui accorde toute confiance. Ce deuxième trait découle lui aussi de la contingence même du voyage : quand le monde décrit est difficilement accessible, quand l’expérience vécue est exceptionnelle d’être difficilement reproductible, la crédibilité du narrateur est vitale.
À ces deux caractéristiques s’ajoute cette troisième : le récit de voyage n’est jamais simple description d’un déplacement géographique : il est toujours aussi découverte d’un ailleurs hors du commun. Il n’y a pas d’authentique récit de voyage sans sidération devant un merveilleux ou bien un horrible difficilement dicible. L’extraordinaire est tellement au cœur du récit du voyage que la description du jamais-vu, faisant perdre à ce dernier son statut à part, entraîne l’émergence d’un nouvel ailleurs. L’inconnu exploré s’avère ainsi être l’occasion d’entrapercevoir de nouvelles frontières : au-delà de ce qui commence d’être connu un nouvel horizon énigmatique se dessine déjà. Un bon récit de voyage réalise donc l’exploit de nous enchanter tout en nous invitant à rêver aux aventures qui restent à accomplir.
Des descriptions variées
Poursuivons l’examen de ce qui, pendant longtemps, va précéder l’ethnologie proprement dite. Ce serait faire une erreur que de croire que si les récits de voyage constituent un genre littéraire bien défini, les descriptions par le voyageur des hommes qu’il rencontre au long de son périple se ressemblent. Rien n’est plus faux. Les portraits des non Européens varient fortement en fonction des récits de voyage. L’ère médiévale, à titre d’exemple, abomine, dans le récit de Joinville, le perfide Sarrasin qui ne respecte pas ses propres engagements et enfreint toutes les lois, et admire, avec Marco Polo, le faste du grand Khan qui est dit régner avec justice sur un peuple farouche. Il est vrai que conquérant ou marchand, le point de vue sur l’autre diffère. Il change même parfois en fonction des rencontres. Le même auteur peut ainsi discriminer les peuples qu’il visite en leur attribuant en quelque sorte un coefficient différentiel de culture, comme c’est le cas avec Hérodote, qui ne classe pas comme équivalents les Égyptiens et les Scythes.
Pour le Grec, la différence entre ces deux peuples est immense… mais d’ailleurs, compte tenu de l’écart gigantesque qui peut parfois séparer deux cultures distinctes, peut-on tracer avec précision la frontière qui marque où s’arrête le même et où commence l’autre ? Oui, mais elle a varié. Avec l’avènement du christianisme, la question de la religion devient un critère fondamental pour évaluer les cultures. Il était toujours possible, dans le cadre du polythéisme de retrouver ailleurs ses propres croyances. À l’ère médiévale, cette entreprise ne fait plus sens : l’antique distinction entre Grecs et Barbares, que les latins avaient repris en parlant pour leur part du « sauvage », change donc ; la grande démarcation se fait désormais entre chrétiens et gentils. Il y avait ceux qui parlaient grec et les autres ; la question devient de savoir qui croit en Dieu et qui n’y croit pas.
Néanmoins, au-delà de cette forte et immédiate distinction les récits de voyage en dessinent une autre, quelque peu plus souterraine. Elle est moins explicite, parce que jugée plus évidente sans doute. Les Européens, au gré de leurs voyages, observent et jugent différentes cultures selon différents critères… mais un semble être invariant, à savoir la frontière immense qui sépare les nomades des sédentaires. Pour un Européen, c’est une énigme qu’un peuple qui n’arrête pas sa course en un territoire précis qu’il fait sien en y fondant ses villes. Les nomades peuvent être de redoutables guerriers, ils resteront toujours culturellement inférieurs. Car le nomadisme toujours est affilié à la barbarie et l’institution des villes à la civilisation.
Cette ligne de démarcation majeure en tête, que les sacrifices sanglants de la civilisation aztèque aient à ce point frappé l’imaginaire européen acquiert peut-être une plus haute signification. Après tout Cortès qui s’en émeut, y voyant un spectacle dépassant toute borne, reste aveugle et aux massacres qu’il ordonne et aux horreurs que son continent fait subir à une partie de sa population. L’Europe n’est pas si pure qu’elle puisse sérieusement être effarée de tels actes. Certes, mais la civilisation aztèque a bâti des temples immenses et majestueux, elle est hiérarchisée et s’étend sur de vastes domaines. Qui aurait pu s’attendre à ce qu’elle accueille en son sein, elle qui se montre si raffinée, d’aussi noires pratiques ? On peut penser que les sacrifices sanglants ont frappé les esprits de relier sauvagerie barbare et haute civilisation architecturale et politique, on pourrait aussi dire que s’ils scandalisent l’Europe, c’est parce qu’ils lui offrent, à elle qui se flatte d’être civilisée et qui n’hésite pas pourtant à être inhumaine parfois, un aussi inattendu que désagréable miroir ?
Le mythe du bon sauvage
Quoi qu’il en soit, les récits de voyage se prolongent et traversent les siècles. Cependant, si leur forme persiste de manière remarquable, un nouveau personnage apparaît au XVIIe siècle : y a eu le fruste barbare, puis le perfide gentil, voici venu le temps du bon sauvage. Cette nouvelle manière d’appréhender ceux qui vivent hors du Vieux Monde est si forte qu’elle entraîna une relecture de ce classique de la littérature européenne qu’est Robinson Crusoé. Pour Defoe, qui l’écrit en 1719, s’échouer sur une île déserte n’a rien d’une chance : il s’agit au contraire d’un châtiment – et celui qui sera nommé « Vendredi » a bien failli être dévoré par des cannibales. Mais, manifestement, l’idée d’anthropophages vivant sur des îles isolées et inhospitalières s’est estompée au profit de l’image de bons sauvages habitant des paradis terrestres. Que s’est-il passé ?
Il semble que la différence se nomme Océanie. Les Européens la sillonnant y rencontrent des peuples qui les charment. Léry, au XVIe siècle, dépeint les indiens d’Amérique avec une grande sagacité doublée d’une authentique affection, il explique ainsi que rien n’est plus faux que de croire que parce qu’ils se promènent dévêtus, ils seraient en proie à la luxure : les indiennes dépeintes par Léry sont belles… et pudiques. Ses descriptions ont d’ailleurs séduit Lévi-St...