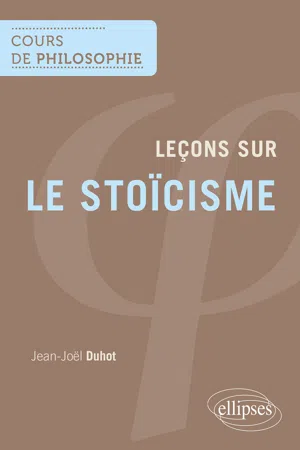![]()
Leçon 1
Le problème
Tout le monde a une petite idée du stoïcisme : une philosophie qui enseigne le mépris des plaisirs, le rejet des émotions, l’indifférence aux sensations et même à la vie, puisqu’on lui attribue une apologie du suicide. Rien de très réjouissant, donc, aux antipodes de la philosophie du plaisir qu’est l’épicurisme, son contemporain. Certes, la grandeur stoïcienne, qui nous a légué l’adjectif stoïque, a de l’allure, avec sa force d’âme et son courage implacable, mais elle semble appartenir à un autre monde.
Nous allons justement découvrir qu’elle appartient bien à un autre monde, mais un monde qui n’est pas du tout celui qu’on croit, et dans lequel cette première impression va totalement disparaître.
L’étude du stoïcisme pose un problème spécifique : il s’agit d’une philosophie, et non d’un auteur. On étudie Platon, Aristote ou Épicure, à partir des textes qu’ils nous ont laissés, tandis que le fondateur du stoïcisme n’a rien laissé, à part quelques traces indirectes. Il y a bien un corpus stoïcien, mais il est beaucoup plus tardif, et son principal auteur, Sénèque, écrit plus de trois siècles et demi après les débuts de l’école, et dans une langue, le latin, qui n’est pas celle de sa philosophie. À quoi il faut quand même ajouter que c’est un homme de cour et d’affaires, et non un philosophe professionnel, si ce n’est comme précepteur de Néron, référence douteuse. Peut-on combler ce vide, qu’il faudra aussi expliquer, qui nous prive du socle même de cette philosophie ?
D’abord, on doit constater que, contrairement au platonisme ou à l’aristotélisme, le stoïcisme se présente comme une doctrine globale, et non comme le commentaire de l’œuvre d’un maître génial. C’est une philosophie qui vaut pour elle-même, par sa rigueur et la vérité de ses principes, du moins dans l’esprit de ceux qui s’en réclament, et non par référence aux écrits du fondateur. Autrement dit, le, ou plutôt les fondateurs, disparaissent derrière ce qu’ils ont fondé. On peut évidemment se demander s’ils n’ont pas été trahis par l’édifice qu’ils ont élaboré, avec l’inévitable dérive du temps et des écoles. Que saurait-on de Platon si tous les dialogues avaient disparu, et si nous n’avions plus que les témoignages et commentaires des siècles postérieurs, et le corpus de ceux que nous appelons Néoplatoniciens, mais qui se désignaient eux-mêmes comme Platoniciens ? On voit immédiatement la différence : dans le cas de Platon, il y a l’œuvre d’un génie, qui a subsisté par elle-même, et suscité des commentaires et des explications, qui n’atteignent jamais la hauteur de leur référence, tandis que la philosophie que le stoïcisme développe vaut pour elle-même, se référant certes aux fondateurs, mais sans se réfugier derrière leur autorité. Le caractère énigmatique de l’œuvre de Platon lui fait transcender tous les commentaires et toutes les interprétations. Le stoïcisme, lui, n’est pas du tout énigmatique, il se veut parfaitement clair et rationnel, entièrement présent dans sa formulation, de sorte qu’il ne saurait rien y avoir de plus dans l’œuvre d’un maître, que l’expression rationnelle de ses positions philosophiques, tout entières contenues dans les démonstrations de la doctrine. Les œuvres disparaissent derrière la pensée, ce qui signifie aussi que rien, en elles, ne paraissait mériter de subsister au-delà de leur contenu, auquel cas les héritiers se seraient souciés de les conserver. Un chef-d’œuvre déborde toujours les résumés et les commentaires ; les Stoïciens n’écrivaient pas de chefs-d’œuvre, ils prétendaient faire de la science, et une science est tout entière dans ses théorèmes, ses principes et ses démonstrations, quels qu’aient pu être les contextes de leur découverte. Qu’ils aient réellement fait de la science est une autre question, mais ils ont considéré qu’ils en faisaient. Nul ne sait comment Pythagore a découvert son théorème ; le mathématicien s’en soucie peu, du moment qu’il a le théorème et la démonstration. C’est sur ce mode que se pensait le stoïcisme : seuls comptent les principes et les démonstrations, et le texte des maîtres ne vaut que par la rigueur de sa rationalité, ce qui nous en rend accessible l’essentiel.
Reconstituer un système rationnel ne devrait pas présenter de difficulté majeure, ce qui justifie notre entreprise, et l’idée communément admise que nous connaissons effectivement le stoïcisme, même si c’est au prix de méprises plus ou moins lourdes. Encore faut-il savoir retrouver les modalités spécifiques de la rationalité grecque en général, et stoïcienne en particulier. Un tel paradoxe apparaît pourtant inacceptable : qu’il puisse y avoir des modes différents de rationalité est de prime abord inacceptable du fait que la rigueur de la rationalité semble impliquer une exactitude absolue, comme la démonstration d’un théorème, ce qui ne laisse guère de place à des questions de point de vue. Un rapide survol de l’histoire des sciences montre qu’il n’en va pas ainsi. Depuis la découverte des irrationnelles jusqu’à la physique quantique, en passant par les nombres négatifs, les complexes et le calcul infinitésimal, on voit les cadres et les limites de la rationalité s’élargir de façon parfois vertigineuse. La rationalité de Heisenberg n’est plus celle de Newton, et dépasse même celle d’Einstein, et, à la suite de Grothendieck, Alain Connes nous permet de penser une unité des mathématiques et de la physique dont on n’aurait même pas pu rêver il y a quelques décennies. Nous aurons donc à nous situer dans les perspectives d’une rationalité grecque, sur laquelle se fonde certes toute notre science, mais que nous avons très largement dépassée, et qui n’est plus du tout la nôtre.
Les Stoïciens
Le stoïcisme s’étale sur cinq bons siècles, depuis le début de l’époque hellénistique jusqu’à l’empire romain et les premiers siècles de notre ère. Son fondateur, Zénon de Kition, a installé son école à Athènes dans les dernières années du quatrième siècle, moins d’une vingtaine d’années après la mort d’Aristote, et une quarantaine d’années après celle de Platon. Son successeur, Cléanthe, reprend l’école à la mort du fondateur, en 262, et la dirige une trentaine d’années. À sa mort, le nouveau scholarque, Chrysippe, donne un nouvel éclat au stoïcisme, grâce à sa virtuosité dialectique.
On a convenu d’appeler Ancien stoïcisme ce siècle des fondateurs et de leur successeur immédiat, Antipater, mais aucun ouvrage de ce premier moment de l’école ne nous est parvenu, ce qui rend très conjecturales les tentatives de reconstitution des éventuelles différences avec les développements ultérieurs du stoïcisme. Il faut en tout cas noter qu’aucune de nos sources antiques n’opère la périodisation adoptée par les historiens modernes : Ancien et Moyen stoïcisme, suivis du stoïcisme impérial.
À cet Ancien stoïcisme, qui, redisons-le, est une notion moderne, on fait succéder un Moyen stoïcisme, qui, avec Panétius et Posidonius, correspond au moment de la conquête romaine de tout l’est méditerranéen. Nous n’avons pas plus de chance avec cette période qu’avec la précédente : aucune œuvre ne nous est parvenue.
Enfin, le troisième moment, romain, du stoïcisme, nous laisse nos trois piliers de la littérature stoïcienne : Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. C’est ce que nous appelons le stoïcisme impérial, dans notre classification moderne. Après Marc Aurèle, mort en 180, le stoïcisme ne disparaît évidemment pas, mais il ne laisse plus de traces directes.
Les sources
Notre corpus stoïcien est donc très disproportionné par rapport aux cinq siècles de l’école, puisqu’il s’échelonne du milieu du premier siècle, avec Sénèque, à 180, soit environ 130 ans sur une extension globale de cinq siècles, et qu’il ne comprend que trois auteurs de l’époque romaine.
Cela signifie que nous devons être très prudents dans nos généralisations, et toujours tenir compte des erreurs de parallaxe dues à la minceur de nos sources. Qu’un auteur développe plus, ou moins, tel ou tel thème, ne correspond pas forcément à l’orientation globale de l’école, mais peut relever de ses centres personnels d’intérêt ou des occasions d’écriture.
Pourtant, notre information ne se limite pas à ces trois auteurs. Si la production des trois premiers siècles de l’école a sombré dans le naufrage qui a vu couler la plus grande partie de la littérature de l’Antiquité, elle n’a pas disparu sans laisser de traces. Nous disposons, en effet, d’un grand nombre de citations, de références, d’allusions, de critiques, mais aussi de quelques résumés, qui permettent de reconstituer les grandes lignes de la doctrine. Ces éléments, généralement appelés fragments, ont commencé à être rassemblés dans des recueils, à partir du XIXe siècle. Le plus important, qui constitue toujours le recueil de référence, est celui d’Arnim, publié en trois volumes au début des années 1900, et toujours réédité (H. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, couramment abrégés SVF, Stuttgart) ; il est accompagné d’un index, malheureusement incomplet, publié par Adler après la guerre (avec une préface qui l’évoque d’une manière qui fait un peu froid dans le dos : bellum atrocissimum, pax atrocior…).
Le travail d’Arnim est inégal. Ses découpages sont parfois discutables : dans des allusions, il est difficile de déterminer exactement où commence et surtout où finit la référence aux Stoïciens ; il arrive que le fragment s’arrête trop tôt, ou, au contraire, se prolonge indûment. L’ensemble n’est pas exhaustif, et tous ceux qui travaillent sur le stoïcisme trouvent des fragments qui ne figurent pas dans les SVF. Inversement, Arnim a parfois retenu des fragments qui n’en sont pas, sur la base d’analogies erronées. La reconnaissance de fragments est, en effet, souvent un peu délicate : quand un texte ou une opinion est explicitement imputé soit au stoïcisme en général, soit à un Stoïcien en particulier, le problème ne se pose pas ; mais si on retrouve les mêmes idées sans attribution à un auteur ou à une école, jusqu’où peut-on considérer qu’il s’agit toujours du stoïcisme ? Ces imputations par analogie peuvent être à l’origine de nombreuses bévues. Donc, méthodologiquement, il est très important de savoir que la présence d’un texte dans les SVF ne saurait à elle seule en justifier l’attribution au stoïcisme. Il arrive parfois à de grands spécialistes de philosophie antique, peu familiarisés avec le travail très spécifique des « fragments », de se laisser prendre au piège, et de considérer comme stoïciens des textes qui ne le sont pas, mais qui ont été répertoriés comme tels dans les SVF. Enfin, ce recueil ayant été réalisé au début du XXe siècle, Arnim a utilisé les éditions existantes, qui ne s’appuyaient pas toujours sur une collation suffisante des manuscrits. Autrement dit, les éditions modernes des mêmes textes sont nettement meilleures, mais il faut bien noter qu’Arnim était un très grand helléniste, et qu’il a souvent amendé les textes avec une sagacité que je n’ai généralement pu qu’admirer. Les éditeurs conservent la plupart du temps ses conjectures, mais il arrive aussi qu’il en fasse un peu trop. Il n’en reste pas moins que les textes des SVF doivent être examinés avec circonspection, et qu’il ne faut pas en négliger l’apparat critique.
Par ailleurs, l’usage du recueil est limité pour le lecteur français par le fait qu’il ne comporte pas de traduction de ses textes, essentiellement grecs mais aussi latins. Les Belles Lettres ont toutefois publié une traduction française intégrale, dont le défaut est de reprendre le découpage des SVF et d’utiliser les traductions disponibles, alors qu’il aurait fallu faire un double travail critique, sur les textes et sur leur traduction : redécouper les textes et les vérifier le plus soigneusement possible. Plusieurs équipes de chercheurs ont entrepris une refonte des SVF, mais ont été dépassées par l’ampleur de la tâche.
Notons aussi l’autre limite des SVF, qui est leur cadre chronologique, qui ne permet pas d’effectuer bien des rapprochements, notamment avec Sénèque ou Épictète, qui seraient pourtant fort éclairants, mais d’abord avec Panétius et Posidonius. Ce dernier bénéficie d’un excellent recueil, beaucoup plus récent, dû à Edelstein et Kidd (Posidonius, The Fragments, Cambridge University Press, 1972).
Sénèque est publié aux Belles Lettres, dans une édition bilingue de ses traités, de ses consolations et de ses lettres à Lucilius. À cette version, due à plusieurs contributeurs, assez ancienne et loin d’être irréprochable tant dans l’établissement du texte que pour la traduction, pour cette dernière, on préférera l’excellent trav...