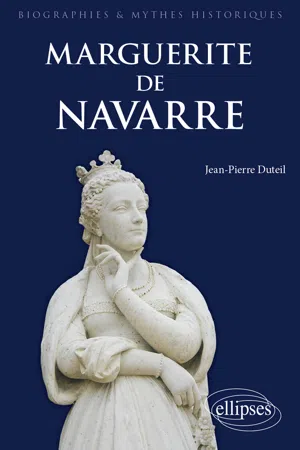![]()
CHAPITRE 1
MARGUERITE, L’ÉCRITURE
ET LA RELIGION
LA NAISSANCE D’UNE PRINCESSE ET SON ÉDUCATION
C’est le 11 avril 1492, dans la tour dite « Marguerite » du château d’Angoulême, que naît l’un des grands écrivains de la Renaissance française. Le baptême sera célébré dans la chapelle du château, où l’enfant, une fille, est appelée par sa mère Marguerite, du grec Margaritès, « perle », car durant sa grossesse la mère aurait avalé une perle alors qu’elle mangeait des huîtres ; c’est du moins ce que nous dit Brantôme, qui lui consacre quelques pages de ses Dames illustres. Le même Brantôme ajoute ces lignes pour les lecteurs d’aujourd’hui assez surprenantes : « Elle naquit sous le dixième degré d’Aquarius, alors que Saturne se séparait de Vénus par quaterne aspect, le 10 d’avril 1492, à dix heures du soir, au château d’Angoulême ; et fut conçue l’an 1491, à dix heures avant midi et dix-sept minutes, le 11 de juillet. Les bons astrosites pourront là-dessus en faire quelque composition ». Brantôme a entendu raconter tout cela par sa mère ou sa grand-mère, et de mémoire le transmet au lecteur. Mais que savons-nous exactement des débuts de la vie de Marguerite d’Angoulême ?
Les origines
Louise de Savoie, mère de Marguerite, est une femme cultivée et attentive au développement et à l’éducation de ses enfants. C’est même pour elle un véritable idéal, résumé dans sa devise latine Libris et liberis, que l’on pourrait traduire « Pour mes livres et mes enfants ». Née en 1476 Louise est la fille du duc de Savoie Philippe et de Marguerite de Bourbon. Elle a été confiée après la mort de sa mère à la fille de Louis XI, Anne de Beaujeu, devenue régente du royaume de France après 1483. Dès l’âge de douze ans Louise s’était vue obligée d’épouser le comte d’Angoulême Charles d’Orléans, le père de Marguerite. Le mariage a lieu en 1488 ; quatre ans plus tard naît Marguerite, au château d’Angoulême comme nous le dit Brantôme.
Il est lui-même le neveu de Charles Ier d’Orléans (1394-1465), duc d’Orléans et de Valois, surtout connu aujourd’hui pour son œuvre poétique dont une grande partie a été écrite lors de sa longue captivité en Angleterre. Ce prince-poète était le frère du roi Charles VI et le fils de Valentine Visconti qui descend elle-même des ducs de Milan. Charles d’Orléans, appartenant à la branche royale des Valois, a été aussi le père de Louis XII, qui règne de 1498 à 1515. Son neveu, le père de Marguerite, est lui aussi un prince cultivé et ami des livres, sans avoir les qualités littéraires de son oncle. Il est rattaché par son père Jean aux Valois d’Angoulême ; le comté d’Angoulême, détenu depuis le Xe siècle par les Taillefer, puis les Lusignan, est revenu à la Couronne de France au cours du XIVe siècle. Il a été donné à Louis d’Orléans en 1394, puis transmis au grand-père de Marguerite, Jean d’Orléans (1404-1467). Jean d’Orléans devenu Comte d’Angoulême avait été livré aux Anglais par son propre frère Charles. Il était resté en Angleterre durant trente-deux ans, aux termes desquels sa rançon a été payée, mais durant toutes ces années il s’était tourné vers la théologie, lisant entre autres les Consolations de Boèce. C’est le « bon comte » Jean d’Angoulême qui a agrandi le château comtal lors de son retour de captivité, au milieu du XVe siècle, château dont ne subsistent aujourd’hui que le donjon des Lusignan (XIIe siècle) et la tour des Valois, ou tour Marguerite, du XVe. Au tout début de la Renaissance les préoccupations militaires restent bien présentes : on construit alors des fortifications en étoile qui doivent assurer la sécurité du château comtal. Le biographe du bon comte Jean, qui écrit il est vrai longtemps après, le présente comme un saint à qui on aurait proposé de devenir pape. En tout cas deux traditions voisinent ainsi chez les Valois : les lettres, représentées par Charles d’Orléans, et la religion, par Jean d’Angoulême. Double héritage spirituel qui aura son influence sur Marguerite.
Tout cela semble laisser peu de place aux ambitions politiques ; elles sont pourtant présentes chez Charles, le père de Marguerite, qui a conspiré après la mort de Louis XI (1483) sous la régence d’Anne de Beaujeu. Celle-ci a gagné la « guerre Folle » que lui a déclarée la Ligue des Princes ; Charles est tombé en disgrâce, et Anne de Beaujeu l’a marié à une héritière pauvre, la fille du duc de Savoie Philippe dit « sans Terre » car les Suisses lui ont pris son comté de Bresse. Charles ne reçoit par la suite que la médiocre seigneurie de Melle, qui vient s’ajouter à celles d’Angoulême, Cognac et Romorantin. Ce qui explique qu’il ait eu le train de vie relativement modeste d’un noble de province, alors que Charles est de sang royal. Il termine sa vie à Angoulême, menant la vie d’un aimable dilettante entouré de maîtresses, d’ailleurs bien acceptées par Louise de Savoie, qui les connaît parfaitement : Jeanne Le Comte est une suivante de Louise, et Antoinette de Polignac sa dame d’honneur. Charles d’Angoulême a eu plusieurs filles de ces liaisons, ce qui fait qu’outre son frère, Marguerite a trois demi-sœurs qui ont été légitimées. En fin de compte il est adepte de ce que son oncle Charles d’Orléans appelait le « nonchaloir », une forme de mise en retrait par rapport à la vie politique. Il ne semble pas qu’il ait eu beaucoup d’influence sur Marguerite, qui n’a que quatre ans lorsqu’il meurt en 1496, et qui n’en parle jamais. Il est inhumé dans la cathédrale Saint-Pierre, lieu de sépulture des comtes d’Angoulême, où ses restes ont été retrouvés en 2011. Louise de Savoie, veuve à dix-neuf ans seulement, décide de se consacrer à l’éducation de ses deux enfants avec l’aide de son confesseur Cristoforo Numai de Forli.
Les parents de Marguerite appartiennent tous deux à la grande aristocratie de leur époque, mais vivent dans une relative gêne : le père de Louise de Savoie, comte de Bresse, est un cadet de noblesse qui n’a pas d’argent ni d’influence, et Charles d’Angoulême n’a pas pu « redorer son blason » en épousant une héritière fortunée. Louis XI, puis Anne de Beaujeu, l’avaient voulu ainsi pour qu’il reste peu menaçant pour le trône. La branche des Valois-Angoulême se trouve, à la naissance de Marguerite, très loin d’un destin royal.
L’influence essentielle, sur Marguerite, a d’abord été celle de Louise de Savoie. Mariée comme on l’a vu à douze ans, Louise était au désespoir de ne pouvoir un an plus tard donner un héritier à son mari. On commence à parler de stérilité, et c’est pour cette raison qu’elle a une entrevue avec un saint homme, Francesco di Paola (François de Paule), un religieux originaire de Calabre à qui l’on attribue alors de nombreux miracles. Fondateur de l’ordre des minimes, il guérissait les lépreux et Louis XI se sentant malade l’avait fait venir en France ; il avait traversé les eaux du détroit de Messine sur son manteau, d’après la tradition du moins, et soigné les pestiférés de Bormes et Fréjus avant d’arriver au château de Plessis-lez-Tours en 1483, quelques mois seulement avant la mort du roi. François de Paule prononçait aussi des bénédictions particulières contre la stérilité. Il prédit à Louise la naissance d’un fils qui sera roi. Louise croit dur comme fer à cette prédiction et se trouve enceinte en 1491 ; inutile d’ajouter qu’elle est fort déçue par la venue d’une fille en avril 1492. La prédiction se réalise véritablement avec la naissance de François, deux ans plus tard. Dès les premiers jours, Louise appelle ce fils « mon César » dans son journal. En 1507, après la mort de François de Paule, elle fait donner à l’ancien ermite un superbe tombeau, puis fait campagne pour sa canonisation, qu’elle obtient de Léon X en 1519.
Sans doute de manière inconsciente, Louise de Savoie fait passer sa fille au second plan, ce qui est aussi la norme de l’époque. Marguerite n’a jamais été délaissée, mais tous les efforts de sa mère sont tournés vers François et sa réussite, c’est-à-dire l’accès aux plus grands honneurs et si possible au trône. Cette ambition trop visible lui vaut l’hostilité à peine dissimulée d’Anne de Bretagne, épouse de Charles VIII puis de Louis XII. Le père de Marguerite, Charles d’Angoulême, meurt le 2 janvier 1496 ; Louise n’a pas vingt ans et la majorité pour conserver la tutelle de ses enfants est alors à vingt-cinq ans. Louis d’Orléans, le futur Louis XII, réclame cette tutelle. Louise fait alors preuve de beaucoup d’ingéniosité en retrouvant une coutume de l’Angoumois qui autorise la tutelle de la mère à quinze ans. Voyant cela Charles VIII accepte de laisser les deux enfants sous l’autorité de leur mère. Le roi n’a nullement l’impression, à cette date, que les Angoulême puissent menacer le trône ; il aura d’ailleurs quatre enfants avec Anne de Bretagne. Mais ils meurent tous en bas âge, et Charles VIII lui-même se tue accidentellement en heurtant de la tête le linteau d’une porte basse, à Amboise (1498). Le trône revient alors à son cousin Louis d’Orléans, désormais le roi Louis XII. Celui-ci demande de suite le divorce d’avec Jeanne, fille de Louis XI, pour se remarier avec Anne de Bretagne. Le changement de règne est à l’origine d’un changement de vie pour les Angoulême, qui sont appelés à la cour, à Chinon, puis à Blois. C’est là un changement important pour Marguerite, qui n’a guère connu que les cieux et le climat océanique de la Charente, à Angoulême et Cognac. La famille est logée dans un bel hôtel d’Amboise, proche du château achevé par Charles VIII. En contrepartie, de 1498 à 1506, Louis XII et Anne les font surveiller par un personnage de premier plan, Pierre de Rohan, seigneur de Gié et maréchal de France.
Il semble bien que Gié, aussi maladroit qu’il est honnête, ait été à l’origine de tensions qui finissent par indisposer Louise et la braquer contre lui. Il est conscient de la rivalité qui oppose Anne, qui n’a plus de fils, à Louise chez qui François est devenu le premier héritier mâle de la couronne. Le roi Louis XII, de son côté, passe beaucoup de temps en Italie où se poursuivent les opérations militaires. Lorsqu’il est en France, il est victime d’une série d’alertes concernant sa santé. En 1501, les médecins sont persuadés que le roi est proche de la fin : à ce moment, le maréchal de Gié craint que l’on cherche à attenter à la vie de François et oblige les Angoulême à quitter Amboise. Il demande à Louise de s’installer sur les terres des Rohan, à Angers. Louise n’a pas la même perception du danger, croit que Gié exagère et s’installe à Loches, au sud de la Loire. Les craintes du maréchal n’étaient sans doute pas vaines, car Anne de Bretagne, elle-même persuadée de la fin prochaine de Louis XII, quitte Blois sur un train de bateaux qui doit descendre la Loire jusqu’à Nantes, afin qu’elle puisse regagner son duché. Le maréchal fait arrêter les bateaux à Amboise, et impose à la reine de regagner Blois sans grands ménagements. Ce faisant, il provoque sa colère : elle l’accuse de lèse-majesté, se plaint de ce comportement au roi mais Louis XII rétabli préfère apaiser les choses. C’est compter sans le caractère rancunier d’Anne de Bretagne, qui engage un procès contre Gié. En 1505, le roi tombe malade de nouveau et décide de se rapprocher des Angoulême car il doute désormais d’avoir un fils pour lui succéder. Louise figure désormais au Grand Conseil. Elle ne fait rien pour éviter le procès au maréchal de Gié, aux termes duquel il est condamné en 1506 à l’exil sur ses terres d’Anjou.
L’enfance
Voilà donc disparu l’encombrant protecteur de Louise. Depuis plusieurs années, à Cognac puis à Amboise, elle se consacre à inculquer à ses deux enfants les premiers rudiments d’une éducation qui se veut de haut niveau. Elle-même parlait l’italien, langue aussi courante que le français dans le duché de Savoie, et l’espagnol. Dès la mort du comte d’Angoulême, elle avait commandé de nombreux manuscrits destinés à l’éducation des deux enfants, faisant œuvre de mécène et montrant par-là ses goûts humanistes.
Depuis 1492 Marguerite a grandi, est devenue une fillette près de qui a été nommée une « maîtresse de mœurs », Blanche de Tournon devenue Madame de Chatillon, dont le mari avait été gouverneur sous Charles VIII. C’est une parente de François de Tournon, qui deviendra cardinal et conseiller de François Ier. En outre, pour les deux enfants de sang royal, trois précepteurs inculquent les rudiments de la religion, du latin, de la philosophie. François Du Moulin leur présente l...