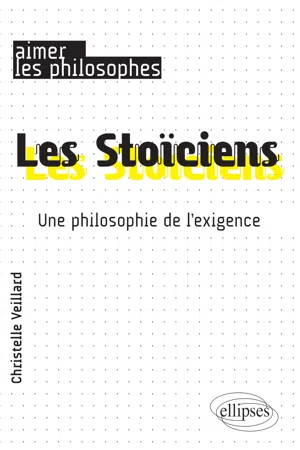![]()
Parcours en pensée
![]()
Chapitre 1
Pour être un homme digne de ce nom, il faut suivre la nature
L’homme est un animal : soyons cyniques !
Lorsque Zénon, ruiné, débarqua à Athènes, il se rendit sur le Pirée chez un bouquiniste. Il y trouva, dit-on, les Mémorables de Xénophon, qui racontent la vie et la doctrine de Socrate. Conquis par cette lecture, il se mit à la recherche d’individus « socratiques », et tomba sur Cratès le cynique, qu’il commença à fréquenter. Le slogan cynique par excellence est de « falsifier la monnaie », c’est-à-dire de remplacer la monnaie actuelle (les fausses valeurs proposées par la cité) par une monnaie de meilleur aloi. Renverser les valeurs n’est pas chose facile, comme l’on sait : les gens, curieusement, sont très attachés à leur mode de vie habituel, et il est très compliqué de leur montrer qu’ils ont tort. C’est pourquoi Diogène comme Cratès procédaient de manière provocante, parfois violente, afin de réveiller les hommes de ce que l’on pourrait appeler leur sommeil dogmatique. Ainsi, Diogène se promenait en plein soleil à l’Agora, avec une lampe allumée, en criant : « Je cherche des hommes ! » Aux individus qui avaient le malheur de s’approcher, il rétorquait : « J’ai dit des hommes, pas des ordures ! » Selon le diagnostic de Diogène, en effet, ses contemporains sont si amollis et si dénaturés par leur mode de vie qu’ils en ont même perdu le titre d’homme ; ils ne savent plus ni ce qu’est un homme, ni comment se comporter en hommes. La solution cynique est de retourner à nos racines naturelles. Leur modèle revendiqué est justement le chien (kunos) qui leur donne son nom (kunikos, cynique). Ne nous représentons cependant pas ce chien sur le modèle de Médor, dressé et joueur, parfaitement intégré au monde des hommes. Le chien de l’époque est un animal mi-domestiqué mi-sauvage, qui vit au milieu des hommes sans être complètement apprivoisé. Ce modèle convient parfaitement au cynique, qui vit, tel un parasite, au milieu des cités, mendiant sa nourriture et son logis, dormant souvent dehors, allongé par terre, couvert d’un manteau qui lui sert de tunique le jour. Ce manteau de voyage, le tribôn, est l’unique vêtement que possède le cynique : il sera le code vestimentaire signalant le philosophe, jusqu’à Marc Aurèle, qui, au grand désespoir de sa mère, se mettra en tête de porter ce vêtement pour signifier sa décision de vivre en philosophe. L’extrême dénuement, la frugalité et la simplicité de mœurs sont le lot du cynique, qui pratique cette ascèse avec emphase, pourrait-on dire. Il convient de choquer le passant par une nudité entrevue, pour lui signifier que son manteau de pourpre et ses colifichets sont ridicules, car tout à fait superflus. La limite au dénuement est l’accomplissement des besoins nécessaires : manger, boire, dormir, se couvrir suffisamment pour ne pas tomber malade. Il convient par conséquent de renforcer son corps aux attaques extérieures : Diogène s’entraînait l’hiver à embrasser des statues couvertes de neige, et à rester l’été en plein soleil. Il convient également de renforcer son âme à endurer tout événement contrariant. Rien n’entrave plus alors le cynique que ses propres limites internes. C’est pourquoi rien ni personne ne peut contraindre la volonté du cynique, dont le modèle est le héros Héraclès. Endurant, courageux, persévérant, couvert de sa peau de lion et armé d’une massue, il traverse sans hésiter toute difficulté. Alexandre le Grand, alerté par la grande renommée de Diogène et impressionné par sa force de caractère, se déplaça ainsi jusqu’à lui : il entendait le récompenser en lui accordant ce qu’il voudrait. La réplique fameuse de Diogène, assis par terre face à la stature imposante d’Alexandre debout devant lui, est bien connue : « Ce que je veux ? Que tu te pousses de mon soleil ». Autrement dit : Diogène n’a besoin de rien qu’il ne possède déjà, il est seul maître de ses désirs et personne n’est par conséquent le maître de Diogène.
Précisons toutefois que le modèle cynique n’est pas uniquement un modèle animal. Leur héros, Héraclès, est connu pour sa grande force et son immense endurance, mais il est aussi astucieux. Il fut surtout élevé par le centaure Chiron, cet être mi-homme mi-cheval qui lui enseigna, justement, que le destin de l’homme n’est pas identique à celui d’un animal. L’homme est lié au divin et appelé à rejoindre cet élément par l’usage qu’il peut faire de sa rationalité, mais une rationalité encadrée par le guide qu’est la nature. L’articulation entre cette double injonction – la naturalité et la rationalité – est le grand défi posé à l’homme. Posséder la raison, c’est posséder un outil qui nous écarte nécessairement d’un rapport brut et immédiat à la nature. Comment utiliser cette raison sans trahir la nature ? Cette question est justement l’un des problèmes auxquels se confrontera le stoïcisme.
Le modèle cynique, nous l’avons dit, inspira durablement la pensée de Zénon. L’âme du sage, dit-il, est telle une outre gonflée d’air ; il est impossible de la faire plonger dans l’eau, autrement dit, de lui faire faire ce qu’elle ne veut pas. De même, la frugalité et le repli sur des choses strictement nécessaires constituent un moyen de se libérer de tous les faux biens, pour ne plus considérer que le seul qui vaille : sa propre force intérieure. Cette force (tonos chez Diogène) s’appellera vertu (arétê) chez Zénon. Là où les stoïciens différeront des cyniques – et c’est ce dont s’apercevra très vite le jeune Marc Aurèle – c’est qu’il est plusieurs manières de porter ces principes. Pour Zénon, la cohérence veut que l’ascèse se vive dans la simplicité et non dans l’ostentation ; l’extrême dénuement symbolisé par le tribôn n’est finalement qu’orgueil et démesure. S’il convient de vivre simplement, il ne convient pas de porter comme étendard les haillons affectés du philosophe : choquer le passant oui, mais pour le convaincre de nous suivre, et non pas en lui inspirant dégoût et répugnance. Une anecdote vient résumer cet écart entre les deux écoles : désirant guérir Zénon de la honte qu’il éprouvait face à l’impudeur cynique, Cratès le força à porter un pot de lentilles à travers le Céramique. Comme Zénon s’efforçait de dissimuler l’objet, Cratès le brisa d’un coup de bâton, faisant couler la purée de lentilles le long des jambes de l’infortuné disciple, lequel se sauva, mortifié, tandis que Cratès lui criait : « Pourquoi fuis-tu, petit Phénicien ? Tu n’as subi rien de terrible » (DL, VII. 3).
Si les principes sont donc initialement les mêmes, la méthode sera différente, et l’élaboration théorique des dogmes creusera progressivement le fossé entre cyniques et stoïciens. L’Antiquité présentait déjà les deux écoles comme des écoles sœurs issues du socratisme, l’une étant la voie courte vers la vertu, l’autre la voie longue : si le cynisme peut se réduire à des dogmes pratiques, le stoïcisme pour sa part affirme le besoin de fonder ces dogmes sur des démonstrations qui conduisent à l’élaboration d’une explication systématique et exhaustive de tous les phénomènes du monde. Appliquer un principe ne suffit pas : il faut encore savoir pourquoi il est vrai, comprendre quelles en sont les causes premières comme les implications lointaines, ce qui est la condition nécessaire pour que ce principe reste suffisamment ancré dans l’âme pour lui conférer sa stabilité.
L’homme est un être rationnel : soyons savants !
Revenons à présent à l’énoncé cynique, assumé par les stoïciens : la fin est de « vivre en suivant la nature » c’est-à-dire, « vivre en accord avec la nature » nous dit Zénon. Cet énoncé apparemment simple nous plonge pourtant dans une grande perplexité. En premier lieu, il faudrait s’accorder sur ce que l’on entend par « suivre », ou « être en accord avec ». Les épicuriens, par exemple, pensent que la nature nous indique, par des signes biologiques indubitables, que nous devons rechercher le plaisir et fuir la douleur : il est évident que le nourrisson pleure quand il a mal ou faim, et qu’il sourit lorsqu’il est confronté à quelque chose d’agréable, qu’il s’agisse d’une caresse ou d’une fraise portée à sa bouche. Selon eux, la nature nous donne donc deux indications très claires : il faut fuir la douleur et rechercher le plaisir. Ces données physiques, immédiates, sont de l’ordre des entrailles et du ressenti : elles sont enracinées en chacun de nous, de sorte que chacun peut en mesurer la vérité. La sensation est ainsi pour les épicuriens le premier critère de vérité, puisque nous ne sommes pas trompés par nos sens sur la nature des choses : elles sont utiles si elles produisent une sensation de plaisir, nuisibles ou dangereuses si elles produisent la sensation contraire de douleur.
Cet argument, que l’on a appelé « argument des berceaux », est repris par les stoïciens, mais ils en tirent une conclusion bien différente. Selon eux, en effet, il est faux de dire que la nature nous enseigne à tous coups à suivre le plaisir et à fuir la douleur. Sénèque remarque notamment dans sa Lettre à Lucilius, 121, que le tout petit enfant n’est pas uniquement porté par ses in...