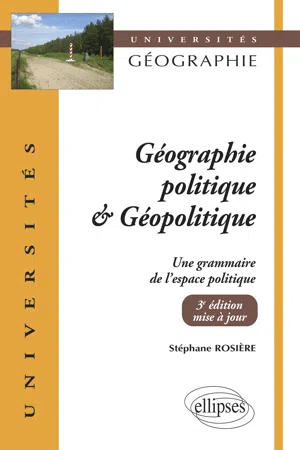![]()
Première partie
Géographie politique
La géographie politique est l’étude des éléments politiques structurant l’espace terrestre. Ces éléments sont essentiellement des territoires, des lignes et des pôles. De ce postulat découle l’organisation de cette première partie : chapitre 1. Les territoires politiques, chapitre 2. Les lignes politiques (intégrant les réseaux), chapitre 3. Les pôles politiques. Cette organisation est synthétisée dans la figure 1.
Réalisation : Sébastien Piantoni, 2011
Figure 1. Géométrie fondamentale de l’espace politique
La géographie politique contemporaine est multiscalaire, ou diatopique, c’est-à-dire qu’elle s’attache à étudier un phénomène à plusieurs échelles (locale, nationale, mondiale par ex.). Elle prend en considération au moins trois échelles emboîtées et interconnectées en considérant les territoires étatiques (États), sur lesquels se sont concentrés les premières géographies politiques (Ratzel, réédité en 1987, 1988 ; Gottmann, 1952), mais aussi les territoires infra-étatiques (ou subétatiques), que forment les régions et les entités administratives ; les territoires supra-étatiques, formés de réunions d’États en organisations intergouvernementales (OIG) à vocation mondiale ou régionale. À ces ensembles emboîtés s’ajoutent des territoires transétatiques, dont les limites ne correspondent pas à celles des États, que nous appelons ici « aires ».
Les interactions entre ces échelles ont été soulignées par le politiste américain Robert Putnam (1998), qui a clairement montré que la politique étrangère et la politique intérieure d’un pays sont profondément entremêlées et interagissent entre elles, comme par le géographe Kevin Cox (1998). Ces liens entre territoire d’échelle différentes sont par exemple symbolisés par les mobilisations citoyennes qui, pour connaître le succès au niveau local, doivent aussi triompher, entre autres, à l’échelle nationale. De même, l’action locale peut-elle aussi s’appuyer sur des décisions et des relais internationaux. Toutes les interactions sont possibles et, de ce fait, l’étude monoscalaire de l’espace politique n’est plus concevable.
Réalisation : Sébastien Piantoni, 2020.
Figure 2. Le territoire, une dimension multiscalaire
La compréhension globale de l’espace politique implique aussi l’analyse des réseaux (absents de cette figure consacrée aux territoires) qui sont des structures différentes, localisées dans l’espace ou non et qui doivent compléter l’analyse des territoires.
![]()
Chapitre 1
Les territoires politiques
Le territoire (schématiquement défini comme une portion d’espace approprié) s’articule au politique avec les territoires « administratifs » formant un pavage emboîté et rationnel, et les aires socioculturelles qui forment un pavage plus complexe marqué par des intersections, des chevauchements et des discontinuités.
Les territoires administratifs sont d’abord formés par les États, que l’on peut considérer comme l’élément fondamental, mais non unique, du pavage politique de l’espace. Une des caractéristiques géopolitiques du monde contemporain est que l’échelon étatique est de plus en plus concurrencé tant au niveau infra-étatique qu’au niveau supra-étatique. Le niveau infra-étatique est constitué par les subdivisions administratives, entités qui disposent de personnalités politiques très variables. Le niveau supra-étatique est formé des organisations intergouvernementales (OIG) à vocation mondiale ou régionale qui se sont multipliées durant la seconde moitié du XXe siècle et qui représentent un nouvel échelon significatif du pavage politique mondial.
Les aires socioculturelles forment des territoires transétatiques (l’adjectif transnational lui est souvent préféré) dans la mesure où ils ne coïncident pas avec le pavage étatique ou politico-administratif. Ces aires se singularisent par la relative homogénéité de leur population, données qui relèvent donc de phénomènes sociaux et culturels.
1.1. L’État
L’État est à la fois une structure, un pouvoir et un territoire (la science politique l’examine plutôt comme structure, les Relations internationales plutôt comme pouvoir, la géographie comme territoire).
L’État est constitué de nombreuses structures qu’une analyse géopolitique doit identifier. Elles peuvent être distinguées par rapport aux « trois pouvoirs » mis en exergue par Montesquieu : exécutif (gouvernement), législatif (assemblées), et judiciaire. Ces structures (réunies dans la notion d’« appareil d’État ») et l’ensemble des administrations sont parfois concurrentes. Dans certains cas, elles peuvent s’opposer ouvertement : la guerre d’Espagne (1936-1939) fut ainsi un soulèvement de l’armée contre le gouvernement légal. L’État est donc un agrégat de structures et de pouvoirs à ne pas simplifier.
En droit international, héritage des traités de Westphalie de 1642, un État est considéré souverain à l’intérieur de ses frontières, ses lois s’appliquent sans restrictions sur son territoire et sa population. La souveraineté est synonyme d’indépendance. Cette vision de l’État souverain a été conceptualisée par la Convention de Montevideo de 1933 sur les droits et les devoirs de l’État. Selon ce texte, un État est considéré comme souverain s’il respecte les quatre critères suivants : « Être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d’un gouvernement, et être apte à entrer en relation avec les autres États. »
Ce territoire nettement délimité (et le plus souvent d’un seul tenant et sans enclave), produit de la rationalité européenne, est devenu une norme universelle par le biais de la colonisation puis de la décolonisation. Chaque État est formellement « souverain » et égal aux autres. En théorie, tous les États indépendants se reconnaissent les uns les autres comme membres de la communauté internationale. Les États sont isonomiques : régis par la « même » (iso) « loi » (nomos). Au-delà de cette isonomie théorique (symbolisée par l’Assemblée générale de l’ONU où chaque État dispose d’une voix), et surtout si l’on considère la souveraineté comme une capacité, les choses sont différentes. L’égalité des États est loin d’être la règle. La « souveraineté » est le fait de ceux, qui ont vraiment le pouvoir considéré comme capacité à influencer et déterminer le comportement des autres acteurs. Certains États n’exercent aucune autorité : les « États faillis » (failed states) (Rotberg, 2002) alors que d’autres exercent une influence régionale voire mondiale : grande puissance, puissance hégémonique (cf. chap. 6).
Au-delà de ces considérations sur la capacité d’action des États, le géographe John Agnew a mis en garde contre le « piège territorial » (territorial trap) dans lequel serait tombée l’étude des Relations internationales, en soulignant que la carte politique du monde où apparaissent les États, territoires comme autant de « conteneurs » isolés les uns des autres, ne restitue pas la « topographie du pouvoir », les politiques d’influence ou l’importance des réseaux (Agnew, 1994). Le territoire constitue une variable qui n’est ni à surestimer ni à méconnaître. Il constitue toujours une variable dans les jeux d’acteurs nationaux ou internationaux.
1.1.1. Le pavage étatique mondial
L’État est l’élément fondamental du pavage politique de l’espace mondial. C’est d’ailleurs la donnée politique la plus fréquemment reproduite sur les cartes et planisphères.
L’existence des États, réalité incontestable sur les cartes, n’est pas toujours évidente sur le terrain ; parfois, à l’inverse, c’est la réalité sur le terrain qui n’est pas reconnue par les cartes. La carte politique n’est souvent que la représentation d’un ordre légitime (ou juridique), mais pas forcément de la situation sur le terrain. Le rapport entre la réalité et la représentation cartographique est plus complexe qu’il n’y paraît. C’est que, si la plupart des États existent de facto (de fait, sur le terrain) et de jure (juridiquement, en tant qu’entité reconnue par la communauté internationale), un certain nombre n’existent que de facto (quasi-État) ou que de jure (État-failli). L’existence des États qui apparaissent sur les cartes n’est pas toujours évidente sur le terrain. Les États-faillis n’ont quasiment pas d’existence concrète. Ils ne contrôlent plus leur territoire et n’offrent pas de service à leur population. À l’inverse, la réalité du terrain n’est souvent pas reconnue par l’ordre juridique mondial : les quasi-États qui existent bien sur le terrain (Abkhazie, Haut-Karabakh, Somaliland, etc.) n’apparaissent pas sur les cartes politiques. Le rapport entre la réalité et la représentation cartographique est donc plus complexe et parfois arbitraire.
D’un point de vue juridique chaque État est censé être reconnu par tous les autres. Cependant, certains États ne sont pas reconnus par tous. Ainsi, la Chine est-elle ...