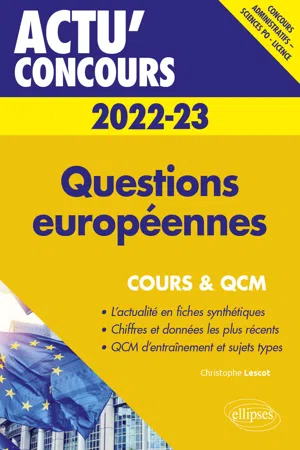
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Questions européennes 2022-2023 - Cours et QCM
À propos de ce livre
L'Union européenne est désormais installée au coeur de la vie politique, économique et sociale des États, mais cette construction européenne reste mal connue. C'est à l'échelle européenne que se posent les questions essentielles qui dépassent le cadre des États-nations:
- Comment équilibrer l'ouverture des marchés par la protection des équilibres territoriaux et la préservation de services d'intérêt général?
- La libéralisation des échanges est-elle possible sans dumping social au détriment des salariés?
- Comment créer, à partir de l'euro, les conditions d'une meilleure intégration économique et budgétaire?
- L'Europe doit-elle s'ouvrir à l'immigration économique ou fermer ses frontières?
- Faut-il fixer des frontières à un ensemble politique en expansion constante depuis ces dernières années?
Telles sont quelques-unes des questions essentielles pour notre avenir à tous que l'on trouvera analysées dans cet ouvrage.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Questions européennes 2022-2023 - Cours et QCM par Lescot Christophe en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Education et Counseling in Career Development. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
1
Des Communautés européennes à l’Union européenne
Historique
Les projets d’unification européenne
après la Seconde Guerre mondiale
après la Seconde Guerre mondiale
Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays d’Europe occidentale vont chercher à mettre en place des structures nouvelles de coopération. Leur objectif est de prévenir tout conflit d’envergure sur le continent, de favoriser la reconstruction d’économies dévastées par cinq années de conflit et de fortifier leur unité de valeurs contre la menace portée par le camp soviétique.
Du 7 au 10 mai 1948, se tient à La Haye, à l’initiative de mouvements européens et de diverses personnalités, le Congrès de l’Europe. Les débats font apparaître un clivage fort – déjà ! – entre partisans d’un pouvoir politique européen indépendant des États (les « fédéralistes ») et défenseurs d’une simple coopération intergouvernementale entre États souverains (les « unionistes »). Les textes adoptés sont assez incisifs sur les objectifs à atteindre (suppression des obstacles au commerce, libre convertibilité des devises, coordination des politiques économiques, adoption d’une charte des droits de l’homme, etc.) mais plus prudents sur les moyens institutionnels d’y parvenir.
Sa seule retombée concrète sera la création le 5 mai 1949 du Conseil de l’Europe, organisation de coopération intergouvernementale dont les compétences très générales couvrent la promotion des droits de l’homme, le renforcement de la démocratie et le développement de la coopération dans les domaines les plus divers (culture, éducation, science, médias). Seules les questions de défense sont exclues de son intervention. Composé initialement de dix États européens, le Conseil de l’Europe s’est élargi par la suite aux autres pays européens et compte aujourd’hui 47 États-membres.
La création d’une Communauté européenne du charbon et de l’acier : le laboratoire de la construction communautaire
Le 9 mai 1950, sur une idée de Jean Monnet, alors commissaire au Plan, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, propose de mettre en commun les productions française et allemande de charbon et d’acier et de les placer sous le contrôle d’une Haute autorité commune ouverte aux autres États européens. En lançant cette initiative, la France poursuit plusieurs objectifs : empêcher toute nouvelle guerre avec l’Allemagne en mutualisant des produits indispensables pour les industries militaires ; rationaliser un secteur en crise menacé de surproduction ; amorcer la réconciliation franco-allemande ; lancer un processus politique de coopération susceptible de déboucher sur une « Fédération européenne » (ce terme figure explicitement dans la déclaration du ministre français). Puisque les États sont réticents à déléguer leurs souverainetés, l’idée est de créer entre eux des solidarités de fait susceptibles de générer un surcroît d’intégration politique.
Le plan Schuman est immédiatement accepté par le chancelier Adenauer. Ouvertes le 20 juin 1950, les négociations aboutissent le 18 avril 1951 à la signature à Paris, par six pays (la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas), du traité sur la Communauté européenne du charbon et de l’acier. La Grande-Bretagne refuse de participer aux négociations par hostilité à l’inspiration supranationale de l’entreprise et par souci de préserver ses liens avec le Commonwealth. L’ensemble des ratifications obtenues, le traité entre en vigueur le 23 juillet 1952 pour une durée de cinquante ans.
Les principaux pouvoirs de décision et de gestion sont exercés par un organe à caractère supranational et indépendant des États, la Haute Autorité. Composée de neuf personnalités indépendantes désignées pour six ans en commun par les États-membres, elle dispose d’un budget financé en partie sur ressources propres et de larges pouvoirs en matière d’ententes et de concentrations ou de fixation des prix et des salaires qui l’autorisent à adopter des actes obligatoires s’appliquant aux entreprises et aux États-membres. Certaines décisions importantes en période de crise ou pour financer des travaux et installations ne peuvent être prises qu’avec l’avis conforme du Conseil des ministres composé d’un membre du gouvernement de chaque État-membre. La Haute Autorité peut être renversée à la majorité des deux tiers par une Assemblée commune, composée de 78 membres désignés par les parlements nationaux, dont les pouvoirs sont, pour le reste, consultatifs. Une Cour de Justice est chargée de veiller au respect du traité et de trancher les différends entre les pays membres ou les personnes.
Les traités de Rome : la création de la Communauté économique européenne et d’Euratom
Avec l’échec du projet de Communauté européenne de défense, la démarche fonctionnelle d’intégration économique apparaît comme la seule méthode possible de relance de la construction européenne. L’option privilégiée par Jean Monnet est celle d’une extension des compétences de la CECA aux transports et à l’énergie nucléaire civile. À cette approche par addition de coopérations sectorielles, les pays du Benelux préfèrent l’option d’une intégration économique générale. Cette seconde option l’emporte. Mandaté par la conférence de Messine (juin 1955), un comité intergouvernemental, réunissant experts et représentants des gouvernements, sous la présidence de Paul-Henri Spaak, propose la constitution d’un marché commun et d’une communauté de l’énergie atomique. Le rapport Spaak est approuvé par la conférence de Venise (29 mai 1956). Ouvertes en juin 1956, les négociations aboutissent à la signature par les six États-membres de la CECA (France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le 25 mars 1957 à Rome, de deux traités établissant, l’un la Communauté économique européenne (CEE), l’autre la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom). Ils entrent en vigueur le 1er janvier 1958 pour une durée illimitée.
La France et le traité de Rome
La France était initialement réticente à l’égard d’une libéralisation générale des échanges et très favorable à une coopération en matière d’énergie atomique (parce qu’elle estimait qu’en raison de son avance technologique dans ce secteur, elle profiterait plus que les autres pays d’une telle coopération). Elle n’accepte de se rallier au projet de marché commun qu’en échange de la conclusion conjointe d’un second traité instituant Euratom. Si elle doit concéder à l’Allemagne la mise en place d’une politique de contrôle de la concurrence, elle obtient le principe d’une politique agricole commune, des périodes de transition relativement longues pour la réalisation du marché commun et le principe d’une association avec l’Outre-mer. Arguant que l’objectif n’était plus seulement de nouer une coopération sectorielle mais de construire un marché commun général, elle obtient également que le Conseil représentant les États détienne la réalité du pouvoir de décision.
Le traité instituant la CEE prévoit la réalisation, d’ici le 31 décembre 1969 et à l’issue d’un processus en trois étapes, d’un marché commun ainsi que la mise en place de politiques communes dans les domaines de l’agriculture, des transports et du commerce extérieur. Le système institutionnel prévu par le traité va bien au-delà d’une simple coopération intergouvernementale mais il ne reproduit pas le modèle ouvertement supranational de la CECA. Le traité crée une institution indépendante des gouvernements, la Commission, qui dispose du monopole de l’initiative mais, à la différence de la Haute Autorité, n’a pas de pouvoirs propres de décision (sauf en matière de concurrence). C’est le Conseil, composé des ministres représentant les États, qui possède la réalité du pouvoir de décision. Il adopte à l’unanimité les règlements et les directives mais à partir de la troisième étape de la période de transition, ses décisions devront être prises à la majorité qualifiée. Une Assemblée des Communautés européennes composée de 142 membres désignés par les parlements nationaux peut censurer la Commission mais ne dispose dans les matières législatives que d’un si...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Page de copyright
- Sommaire
- Fiche 1. Des Communautés européennes à l’Union européenne
- Fiche 2. L’Europe à géométrie variable
- Fiche 3. La Commission européenne
- Fiche 4. Le Conseil européen et le Conseil de l’Union
- Fiche 5. Le Parlement européen
- Fiche 6. Le processus de décision
- Fiche 7. L’ordre juridique de l’Union
- Fiche 8. Les compétences de l’Union
- Fiche 9. L’exécution du droit de l’Union et la comitologie
- Fiche 10. La juridiction de l’Union
- Fiche 11. Le marché intérieur
- Fiche 12. La politique européenne de concurrence
- Fiche 13. Le budget de l’Union européenne
- Fiche 14. L’Union économique et monétaire et la coordination des politiques économiques
- Fiche 15. La politique agricole commune
- Fiche 16. La politique commune de la pêche
- Fiche 17. La politique de cohésion
- Fiche 18. La politique commune des transports
- Fiche 19. La politique de recherche et de développement industriel
- Fiche 20. L’Europe de l’énergie
- Fiche 21. La politique de l’environnement
- Fiche 22. L’Europe sociale
- Fiche 23. L’Europe de la santé publique
- Fiche 24. L’Europe de la culture, de la jeunesse, du sport et de l’éducation
- Fiche 25. L’espace de liberté, de sécurité et de justice
- Fiche 26. Liberté de circulation des personnes et citoyenneté européenne
- Fiche 27. L’espace judiciaire européen
- Fiche 28. Les politiques d’asile et d’immigration
- Fiche 29. La politique étrangère et de sécurité commune
- Fiche 30. La politique européenne de développement
- Fiche 31. La politique de sécurité et de défense commune
- Fiche 32. La politique commerciale extérieure
- Fiche 33. L’élargissement et les frontières de l’Union
- Réponses aux QCM