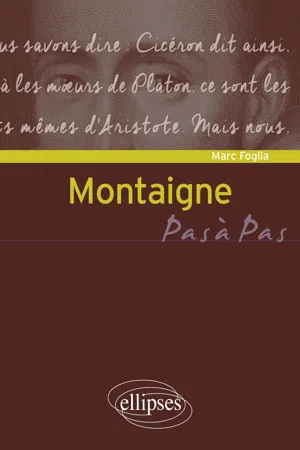II. Connaître
Si l’on suit la tradition critique, les Essais poursuivraient la connaissance du Moi, et à travers celle-ci, la connaissance de l’homme. Il faudrait chercher la valeur de l’œuvre dans « le passage de l’individu nommé Montaigne à la description générale de l’homme ». C’est dans cette psychologie empirique, libérée des dogmes, que serait préfigurée la littérature classique. « Tout ce qu’il confesse de lui est document sur la nature humaine. Il contribue ainsi, plus que personne, à engager la littérature française dans la voie où l’époque classique trouvera ses œuvres les plus significatives et les plus fortes : il lui propose son objet et sa méthode, une psychologie toute d’observation, aussi affranchie qu’il est possible de la métaphysique et du dogme », écrit Gustave Lanson. Cette tradition critique perdure, même si le vocabulaire et les outils diffèrent. C’est aussi une manière de rendre hommage à l’œuvre de Montaigne comme voie d’accès à la connaissance de soi, et réservoir inépuisable de la littérature moderne. Mais l’essai du jugement vise-t-il la connaissance de l’homme ? Quel type de connaissance pouvons-nous associer à l’exercice du jugement ? Le but de l’essai n’est pas théorique, mais réflexif. Montaigne ne veut rien laisser subsister en lui sans le soumettre à la vue de son jugement. L’hostilité à l’égard des médecins, par exemple, détestation qu’il dit avoir héritée de sa famille, est soumise à examen.
Il est possible que j’ay receu d’eux cette dispathie naturelle à la medecine ; mais s’il n’y eut eu que cette consideration, j’eusse essayé de la forcer. Car toutes ces conditions qui naissent en nous sans raison, elles sont vitieuses, c’est une espece de maladie qu’il faut combatre ; il peut estre que j’y avois cette propension, mais je l’ay appuyée et fortifiée par les discours qui m’en ont estably l’opinion que j’en ay.
Le chapitre sur les médecins (II, 37) est l’occasion pour Montaigne de faire beaucoup plus que de dire son antipathie à leur encontre, c’est aussi et surtout l’occasion de faire passer une sorte de test à cette « propension » personnelle et familiale. Si l’opinion personnelle était restée à l’état d’inclination, écrit-il au conditionnel, il aurait « essayé de la forcer », comme il se montre ailleurs en train de « forcer quelque barrière de la coutume ». L’emploi du verbe « essayer » renvoie à la valeur de mise à l’épreuve, d’interrogation active ou de test rationnel que revêt l’essai du jugement. À propos de tel philosophe, Montaigne écrit que « ses disciples, pour essayer sa continence, lui avaient fourré dans son lit Laïs, cette belle et fameuse courtisane, toute nue. » Le but de l’essai n’est pas de produire une connaissance de soi-même, mais de faire passer les jugements au banc d’essai de la réflexion. Le contenu de l’opinion restera le même, mais elle aura elle-même changé de statut : ce sera une opinion réfléchie.
Tel qu’il se décrit, Montaigne reconnaît en lui un ensemble d’inclinations naturelles, d’« opinions empruntées d’autrui », mais aussi un effort rationnel pour ne pas dépendre de ce donné. L’essai fait passer au crible du jugement les considérations spontanées et les savoirs empruntés. « Je ne compte pas mes emprunts, je les pèse ». L’enjeu n’est pas d’élaborer une encyclopédie personnelle, mais de conduire une entreprise critique à la première personne. Nous sommes toujours déjà installés dans des réactions et des savoirs, saturés d’opinions et de discours dont la valeur de vérité nous échappe. Comment faire passer une opinion empruntée à l’état de jugement réfléchi, que je puisse assumer à la première personne ? Le programme de l’essai est un programme qui reste fondamentalement rationaliste, malgré la critique sceptique de la raison que l’on trouve dans les Essais. Nous explorerons la physionomie de cet usage réflexif de la raison à partir de thématiques privilégiées, en commençant, comme le fait Montaigne, par des questions militaires.
1. Questions militaires
Le titre du premier chapitre des Essais, « Par divers moyens on arrive à pareille fin » (I, 1) se présente comme un constat qui relativise l’importance du choix des moyens. Ce titre philosophique pose la question de l’action rationnelle en général, mais les exemples choisis sont exclusivement militaires. L’auteur souhaite-il montrer à ses lecteurs qu’il s’adresse en priorité aux gentilshommes de son temps ? Tout se passe comme si Montaigne cherchait la reconnaissance de ses pairs, en soumettant ces questions militaires à un public cible dont il souligne par ailleurs l’inculture ! « Ceux auxquels ma condition me mêle le plus ordinairement, sont pour la plupart gens qui ont peu de soin de la culture de l’âme, et auxquels on ne propose pour toute béatitude que l’honneur, et pour toute perfection que la vaillance. » Sur la base d’exemples militaires, c’est toujours une question pour le jugement qui est posée. Les « questions » désignent précisément des objets offerts à l’examen du jugement.