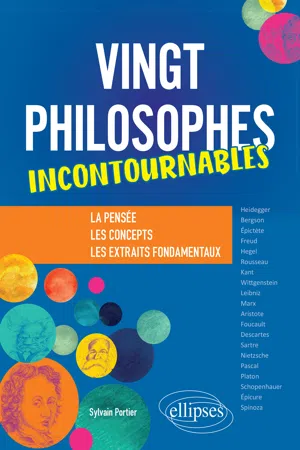![]()
Lexique
Angoisse (Heidegger) : À la différence de la peur, de l’inquiétude ou du stress, « l’angoisse » (« Die Angst ») désigne chez Heidegger un sentiment qui n’a ni cause ni objet, et c’est pourquoi elle est la plus haute expérience humaine possible du néant. En effet, dans l’angoisse, rien (entendons rien de concret) ne m’angoisse, mais une sorte de vide m’envahit tout de même, mon monde s’effondre totalement, s’anéantit, et le sens de toute chose disparaît.
Aperception (Leibniz) : Perception distincte et aperçue par une conscience, qui est elle-même composée de multiples perceptions inaperçues et inconscientes, car trop petites pour être individuellement saisies par l’esprit. Ainsi percevons-nous le brouhaha de l’océan, mais pas le bruit de chacune de ses vaguelettes.
Archéologie du savoir (Foucault) : Inspiré de la « généalogie » nietzschéenne, ce terme désigne le projet d’une réinterprétation du rapport de l’homme à sa propre histoire, qui est constituée de rapports complexes et parfois invisibles entre savoir et pouvoir, tout pouvoir reposant sur certains savoirs (ou prétendus savoirs) et tout savoir pouvant être source de pouvoir. La table des matières de l’ouvrage de Foucault L’Archéologie du savoir donne d’ailleurs une bonne idée des objets qu’il s’agit alors d’étudier (ex : « Les unités du discours », « La formation des concepts », « L’a priori historique et l’archive », « Archéologie et histoire des idées »).
Arraisonnement (Heidegger) : En allemand, Gestell signifie cadre, châssis, étagère, chevalet, bref, tout ce qui résulte d’un montage et qui est posé dans un ensemble. Il désigne chez Heidegger le mode de dévoilement de l’essence de la technique moderne, qui est le résultat d’une volonté de commander et de produire. On pourrait donc tout aussi bien traduire ce terme par dispositif, en donnant à ce mot le sens fort d’une mise à disposition de la nature (de l’Étant), qui réduit celle-ci à une sorte de fond, de stock ou de réserve pour l’homme. Ce dernier va dès lors l’interpréter selon un modèle utilitaire et techniciste : à quoi est-ce que cela sert ? comment est-ce que cela fonctionne ? comment en tirer rapidement des avantages matériels ? Telles seront alors les grandes questions de l’homme moderne vis-à-vis de toute chose.
Ataraxie (Épicure) : Profonde quiétude, découlant de l’absence de tout trouble de l’esprit ou de douleur du corps, qui provient de l’application rigoureuse et répétée de certaines règles éthiques. Dans le cas du corps seul, on parle d’aponie.
Atome (Épicure) : Du grec a toma, ce qui est in-sécable, il est l’élément insécable, matériel et éternel qui compose tout ce qui existe, avec le vide dans lequel ces atomes se meuvent.
Authenticité (Sartre) : Vertu caractérisant un sujet qui assume ses actes et le choix des valeurs qui guident son existence, sans chercher à se réfugier derrière des excuses ou des faux-semblants qui relèvent de la « mauvaise foi ». En ce sens, elle n’est pas une caractéristique essentielle mais un combat à réitérer sans cesse, « en situation », c’est-à-dire dans des circonstances contingentes (matérielles, sociales, historiques) que nous n’avons pourtant pas choisies.
Ça (Freud) : Ce terme, popularisé par Freud, a été créé par le médecin et analyste Georg Groddeck. Il désigne en psychanalyse le réservoir inconscient de nos pulsions, de nos instincts les plus archaïques, animaux, égoïstes. Ces instincts sont principalement de trois sortes : agressifs, sexuels et autodestructeurs. C’est pourquoi il est désigné par le mot « Ça » (« Es »), volontairement mystérieux, indéterminé et soumis à la censure morale – comme lorsqu’on dit ça pour parler de quelque chose de gênant ou de tabou. L’énergie chaotique qui y bouillonne, la « libido », devra être canalisée par le « Sur-Moi » (« Über-Ich »), l’ensemble lui aussi en partie inconscient des règles, des valeurs et des tabous issus de l’éducation et de la vie en société. C’est ainsi que le « principe de plaisir » sur lequel repose le Ça sera frustré par le « principe de réalité », de façon certes désagréable, mais salvatrice pour l’équilibre mental que le sujet construit dès son plus jeune âge.
Complexe d’Œdipe (Freud) : Cette expression freudienne fait référence au célèbre mythe antique dans lequel Œdipe finit, comme la commandait la prophétie, par tuer involontairement son père et épouser sa mère. Elle désigne, en psychanalyse, la période de l’enfance durant laquelle se nouent de complexes relations d’amour et de tension entre l’enfant et ses parents. C’est en dépassant ces conflits, en trouvant sa place affective par rapport à ses parents que l’enfant va pouvoir structurer son psychisme et se projeter vers son propre avenir.
Conscience pratique (Hegel) : Capacité propre à l’homme consistant à savoir réflexivement qu’il existe dans un monde sur lequel il va pouvoir librement agir (praxis signifiant action en grec), qu’il va pouvoir transformer en fonction de ses désirs et de ses valeurs, et qui va, en retour, le transformer.
Contrat social (Rousseau) : Association universellement légitime entre une autorité politique, un État, et l’ensemble des citoyens qui en dépend. Il s’agit donc de déterminer quelle pourrait être cette association universellement juste. Il faut en effet laisser de côté, neutraliser les particularités culturelles, les différences historiques, et les séparatismes religieux ou autres. Il est nécessaire de se fier à la seule raison (qui est universelle) et non pas aux passions (qui sont personnelles ou collectives), Or, il n’y en a qu’une : un contrat par lequel le Souverain incarne le peuple et par lequel le peuple est le Souverain. Comme l’écrit Rousseau, qui « défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ». Seule la Démocratie correspond à cette définition, mais il faut encore faire en sorte que les systèmes démocratiques réels s’approchent le plus possible ou atteignent cet idéal.
Cœur (Pascal) : Par opposition à la raison, le cœur désigne chez Pascal la foi, ce sentiment qui nous élève à la certitude que Dieu existe sans que nous puissions le démontrer. C’est également le cœur qui nous fait connaître les choses par une intuition immédiate, de sorte que nous percevons certaines vérités indubitables qui, elles non plus, ne sont pourtant pas démontrables (ex : que nous ne sommes pas en train de rêver, qu’il y a trois dimensions dans l’espace, que les nombres et les lignes sont infinis).
Chose en soi (Kant) : Réalité inconnaissable sur laquelle nous projetons divers prismes (l’espace et le temps, la causalité, les qualités sensibles) afin de pouvoir percevoir le monde qui ne nous apparaît donc que sous la forme subjective de « phénomènes » (phainomenon signifiant en grec ce qui apparaît, apparence). Nous ne pourrons jamais être certains que cela corresponde bien à la réalité objective des « choses en soi », dont nous devons pourtant logiquement poser l’existence.
Cogito (Descartes) : Certitude selon laquelle j’existe puisque je pense. En effet, douter, c’est penser que ce en quoi l’on croit n’est peut-être pas vrai. Il est donc impossible de douter de sa propre existence en tant qu’être pensant puisque cela reviendrait à penser que l’on ne pense pas. Je peux par contre douter de l’existence du monde que je perçois, de celle d’autrui, de celle de mon propre corps (que je dois donc distinguer de mon esprit), voire que 2+2 soit véritablement égal à 4, mais je ne peux pas douter du fait que je suis. C’est pourquoi la formule restée célèbre du cogito est « Je pense donc je suis ».
Déterminisme (Spinoza) : Si ce terme n’est pas employé par Spinoza lui-même, il décrit bien son système de pensée puisqu’il désigne une théorie (philosophique, religieuse ou scientifique) selon laquelle tout ce qui advient dans l’univers est déterminé à advenir ainsi. Tout évènement (de la chute d’une pierre en montagne au fait que je sois en train d’écrire cette phrase) étant l’effet d’une ou de plusieurs causes qui sont, à leur tour, les effets d’autres causes, rien dans l’univers ne se produit en dehors de ces chaînes de nécessités causales, qui ne sont pas la volonté de Dieu mais un processus aveugle, naturel et mécanique.
Désirs vains (Épicure) : Envies illusoires que la vie en société fait naître en nous et qui se présentent comme le plus à même de nous rendre heureux, alors qu’il s’agit en vérité de la meilleure façon de ne jamais l’être (ex : la recherche de la richesse, du pouvoir, de l’immortalité).
Dialectique (Hegel) : Dans le domaine de l’esprit, elle est l’histoire des contradictions de la pensée qu’elle surmonte en passant de l’affirmation à la négation et de cette négation à la négation de la négation. Mais elle désigne aussi un mouvement réel, inhérent au monde,...