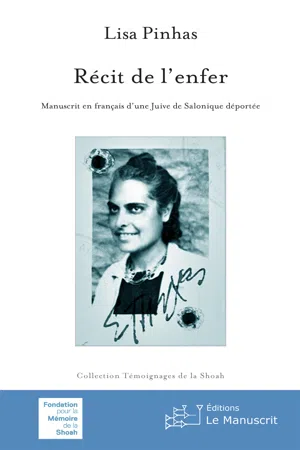![]()
Dépouillées de tout, nous attendions toutes nues en file indienne ; il faisait froid et ces messieurs n’avaient pas l’air de se presser. Il faisait encore jour quand on nous fit enfin monter dans des camions. Nous étions debout afin d’occuper le moins de place possible, car on transportait en même temps le bois qui servait à alimenter le gazogène. Au fond de la voiture, une jeune fille avait la dysenterie et ses vêtements puaient ; personne ne voulait l’avoir à côté de soi.
Nous traversâmes une très belle forêt de hêtres. Le voyage fut très long et très fatigant. La fumée de gazogène nous asphyxiait et puis on ne pouvait plus rester debout. On cherchait à s’appuyer sur sa voisine, laquelle protestait vivement. On s’injuriait sans vergogne, on se pinçait pour gagner un peu plus de place, pour se mettre plus à l’aise. La bonne éducation et le savoir-vivre s’étaient, disait-on, évaporés, avaient disparu pour faire place à la sauvagerie brutale de l’homme primitif.
Pour apaiser sa soif, une déséquilibrée fit pipi dans sa gamelle et but son urine.
Il faisait nuit depuis longtemps. À l’entrée d’une petite ville, il y eut une alerte. Nous entendîmes le ronronnement des avions, le bruit sourd des bombes qui tombaient au loin. D’immenses lueurs incendiaient l’horizon. Cela dura près d’une heure. Durant tout ce temps, notre voiture était arrêtée devant des maisons ; les habitants la contournèrent et nous firent mille questions ; nous leur demandâmes de l’eau, qu’ils ne nous refusèrent pas. Puis le voyage continua.
C’est avec soulagement que nous vîmes la voiture s’arrêter enfin pour de bon. Les Allemands nous ordonnèrent de descendre. Nous ne pouvions rien distinguer, mais au moins là, il n’y avait pas de cheminée et tout semblait si calme. On nous fit entrer dans un Block vide et, dans l’obscurité la plus absolue, en cherchant à tâtons, les unes trouvèrent des lits et les occupèrent, les autres, des bancs et des tables sur lesquels nous nous installâmes pêle-mêle pour le reste de la nuit. Aux premières lueurs du jour, nous vîmes dans un coin des gamelles blanches en faïence dans lesquelles il y avait encore des restes de soupe. Le camp avait dû être vidé la veille même.
C’était le camp de Rechling, à 40 kilomètres d’Auschwitz.
Après l’appel du matin, les Allemands demandèrent des volontaires pour diverses fonctions du camp, infirmières, cuisinières, Stubendienste, balayeuses, etc. Ce furent pour la plupart les Tchécoslovaques qui occupèrent les meilleurs emplois et le balai fut la spécialité des Polonaises. Elles se mirent aussitôt au travail. On nous laissa toute la matinée dehors ; nous allions de Block en Block, car ils étaient complètement vides. À midi, toujours dehors, on nous servit une soupe très épicée qui nous parut succulente, mais une heure après, tout le monde avait des coliques. Cela n’empêcha pas qu’on nous fit passer une Entlausung et on nous laissa nues jusqu’à la nuit. Ensuite, on nous distribua du linge d’homme couvert de trous et on nous conduisit au Block II. Il y avait plusieurs Stuben et chacune d’elles avait 25 couchettes de 80 mètres de large, à trois étages et à raison de trois personnes par lit. Mais ils étaient plus solides et en nous serrant (nous en avions pris l’habitude) nous pouvions goûter un peu de repos. Mes camarades et moi nous occupâmes les deux premiers lits près de la porte, tandis que celui de l’étage supérieur était habité par des Polonaises. Un poêle en fer était presque collé à notre lit. Notre Blockälteste était slovaque et s’appelait Bianca, une fille très cruelle et injuste, tandis que Regina, la Slovaque rousse, était la plus humaine de toutes les autres Stubendienste. Dès les premiers jours, toutes ces privilégiées du camp commencèrent à « organiser » des pommes de terre et des carottes en grandes quantités qu’elles cuisaient sur le poêle allumé clandestinement. Personne n’avait le courage de les dénoncer et elles avaient des marmites toutes pleines. Les marmites de soupe ne nous étaient pas distribuées loyalement. Bianca plongeait la louche dans tous les bidons pour retrancher les bouts de viande – les rares fois qu’il y en avait – et les pommes de terre, remplissait quelques gamelles, les mettant de côté pour leur usage personnel durant le cours de la journée et laissant l’eau claire pour nous. Elle les partageait avec ses complices, ne se gênant pas de manger devant les affamées, le regard desquelles suivait le va-et-vient de la cuiller avec convoitise. Mais, pensez-vous, cela ne les touchait pas, elles avaient déjà pris l’habitude et elles restaient insensibles à ces regards d’envie.
Les Stubendienste, elles, cachaient un ou deux bidons entiers qu’elles vendaient pour du pain ou de la margarine. À ce régime-là, nous ne pouvions pas aller très loin, d’autant plus que le travail pendant la journée était très fatigant.
C’était au mois de février. Nous travaillions alors dans les forêts ou les camps d’aviation, à creuser des fosses, à couper des branches d’arbres pour camoufler les avions. Le froid était terrible, le vent cinglait comme un fouet, la bourrasque congelait les flocons de neige et nous suivions l’interminable colonne à travers les champs glacés. Là, il fallait creuser jusqu’à l’épuisement total, piocher ; nos mains n’étaient pas habituées à ce genre de sport, d’ailleurs elles étaient gourdes et couvertes d’engelure. Nous avions l’onglée et le maniement de la pelle ou de la pioche devenait extrêmement difficile.
Les Einweiserinnen allumaient un feu de bois et bavardaient avec les sentinelles. Elles criaient tout le temps, pour nous inciter au travail ou pour ne pas perdre l’habitude. Parfois, nous nous arrêtions une seconde pour nous frotter les mains ou faire un peu de mouvements afin de dégourdir un pied gelé. Dieu, quel péché !… Elles accouraient, furieuses d’avoir été dérangées dans leur flirt, et distribuaient, pour se venger, des coups de bâton qui tombaient comme la grêle sur nos membres endoloris.
– Voyez-vous, là, ces grandes princesses, ces aristocrates ? Vous faudrait-il peut-être des fauteuils pour vous reposer ? Paresseuses, bonnes à rien… Los! Schweinehunde, verfluchte Bagage…
Nous essayions de reprendre le travail au prix d’efforts surhumains ; on avait envie de pleurer, de mourir, de mourir de n’importe quelle façon mais d’en finir une fois pour toutes. À quoi bon ces efforts intenses ? Ils ne serviraient qu’à reculer de quelques jours la date fatidique. Aussi combien furent-elles celles qui, désespérées, se jetèrent sur les fils de fer barbelés où passait un courant électrique à haute tension, préférant se suicider ainsi plutôt que de mourir de la mort lente du camp…
Si au moins on nous avait donné une soupe chaude à midi !… mais rien. Le matin, avant de quitter le camp, on nous donnait notre ration de pain (un kilo entre huit, d’un mélange de sciure de bois et de farine de seigle en grande partie moisi) que nous mangions à la pause de midi. Ce n’est que le soir en rentrant qu’on nous servait une louche d’une odieuse soupe de navets déshydratés ou de carottes sans sel et sans aucun corps gras, mais pleine de sable, car on ne se donnait pas la peine de laver les légumes. Parfois, quand la Lagerpolizei assistait à la distribution, nous avions du rabiot et on se remettait dans les rangs. Mais d’ordinaire, c’étaient les Stubendienste et les Einweiserinnen qui en profitaient frauduleusement et nous les avions surnommées « Nach Keller ».
Tout le camp souffrait d’une même étrange diarrhée qui causa la mort de plusieurs centaines de filles. Toute la nuit, c’était une procession incessante dans les water-closets ; on ne pouvait pas attendre et dans l’obscurité, on souillait le sol des couloirs, on pataugeait dans ces immondices, et en retournant à la Stube on revenait imprégnées de cette odeur asphyxiante qui se dégageait de ces lieux. C’était écœurant.
La cohue matinale aux closets est impossible à décrire : l’appel venait très vite, les Stubendienste et la Lagerpolizei faisaient la chasse en nous poursuivant avec une ceinture de cuir. Et il fallait pauser des heures entières ainsi, raides devant l’Allemand et Bianca qui nous comptaient inlassablement. Mais c’était un besoin qui ne souffrait pas l’attente et nombreuses étaient celles qui ne pouvaient pas faire autrement ; alors elles passaient un mauvais quart d’heure entre les mains de la brutale Bianca, qui finissait par les envoyer dans un Revier.
Pour remédier à ce mal tous les jours plus envahissant, nous brûlions du bois que nous réduisions en poudre et nous l’employions comme médicament.
Malgré mes précautions, je n’ai pas pu échapper à ce fléau. J’étais tellement épuisée qu’un matin je suis tombée deux fois pendant l’appel.
« Au Revier! Sofort! (tout de suite !)… » ordonna Bianca. Là j’ai souffert le vrai martyre. La dysenterie y avait fait son royaume. Elle se propageait de plus en plus et faisait des ravages effrayants. Le Revier était bondé. Tous les lits, pareils aux nôtres, étaient occupés par trois malades. Elles faisaient peur à voir : décharnées, hâves, pantelantes, de véritables loques humaines. Tout ce monde se plaignait, gémissait, demandait le bassin à une Pflegerin qui passait indifférente ou hargneuse, car toute sensibilité semblait annihilée chez ces dernières ; c’était effroyable. Tout le Revier puait terriblement.
Heureusement, l’infirmière en chef de la Stube où je fus admise était Aghi, une amie hongroise du Kanada qui connaissait très bien le français. Que pouvait-elle faire pour moi ? Si les pilules de charbon étaient comptées, elle avait, par contre, des paroles réconfortantes et elle était toute douceur à mon égard. C’était une chance très appréciable car les malades n’étaient pas toujours bien traitées.
Pendant la journée, des centaines de spectres dysentériques allaient et venaient sans arrêt aux water-closets, s’appuyant aux murs, titubant, gisant par terre dans une mare de diarrhée, pauvres squelettes qui n’osaient plus regagner leur lit, craignant d’être battues par la Stubendienst ; une effrayante vision.
Le soir, c’était pire. Une faible lampe éclairait à peine notre Stube. Dans un coin, une cuvette servait de toilette à 50 ou 60 malades qui se levaient toutes les dix minutes, exception faite des mourantes qui se plaignaient toute la nuit, demandant vainement le bassin. Parfois, elles faisaient des efforts pour se lever, se heurtaient contre un obstacle et tombaient par terre sans vie. Ainsi mouraient-elles par centaines, à tout moment. D’un lit voisin, une plainte accompagnée d’une grimace douloureuse, des yeux agrandis par la peur, un cri avec un geste suppliant désespéré comme si on voulait s’accrocher à la vie…, mais la mort, cette hideuse et fidèle associée de Hitler, attendait, implacable. Elle avait choisi ses proies et avait déjà décidé d’elles depuis le jour où elles étaient entrées au Revier. Nous-mêmes, nous étions dans un tel état que nous nous demandions souvent : Est-ce pour aujourd’hui ? Est-ce pour demain ? Il y avait bien de quoi se démoraliser. Cette maladie était devenue un vrai fléau.
J’ai cru ne plus sortir de ce misérable réduit. À peine je regagnais ma paillasse qu’il fallait me relever, me traîner jusqu’à la cuvette ; là je devais attendre mon tour ; j’avais des coliques, mes jambes étaient trop faibles pour me soutenir. Tout tournait autour de moi ; mes oreilles percevaient constamment des bruits étranges, comme le battement ou le frôlement d’ailes d’un grand oiseau. Mes lèvres esquissaient une grimace qui voulait être des pleurs, mais je n’avais même pas la force de pleurer ; mes yeux étaient secs de larmes. Personne pour nous tendre la main. Pas même Régine, l’égoïste et vulgaire Stubendienst grecque, qui pourtant acceptait bien le pain que je lui donnais. L’habitude de voir chaque jour mourir tant de personnes sous ses yeux lui avait sûrement endurci le cœur. Mais Aghi venait me voir plusieurs fois dans la journée. Sa présence était un réconfort pour toutes et particulièrement pour moi. Elle se dépensait jusqu’au sacrifice d’elle-même, m’apportant souvent des pommes de terre crues qu’elle avait « organisées » ou une tranche de pain grillé.
Près de nous, les Stubendienste parlaient de liberté toute proche déjà. Cela nous faisait pleurer. La goûterions-nous jamais de nouveau ? Et mêlant nos larmes à un sourire mélancolique, nous nous surprenions à rêver à haute voix : Dire que là-bas, dans la vie libre, on se lève à l’heure qu’on veut, on se couche dans de vrais lits avec des draps blancs, on se promène librement… et nous, après avoir souffert pendant deux ans, nous allons sûrement crever sous la faux nazie ! Quelle injustice, personne ne pense plus à nous, on nous a oubliées comme si nous étions déjà mortes.
La nourriture des dysentériques ne différait en rien de celle du restant des prisonnières. La même soupe aux rutabagas pourris ou au pain moisi nageant dans l’eau claire, et on prétendait nous guérir avec cela ! Presque toujours, la plupart des malades la refusaient, à la grande joie de la Stubendienst qui en profitait pour la vendre.
Trois fois par semaine cependant, il faut leur rendre cette justice, on servait une bonne soupe aux pâtes à laquelle les plus sérieusement malades seulement avaient droit. Il est inutile de dire que le bidon nous arrivait toujours à moitié plein, car les pâtes avaient eu le temps de « s’évaporer », en stationnant pendant quelques minutes dans la Stube des grandes du Block. Les malades privilégiées qui profitaient de ce luxe ne recevaient ce jour-là que la moitié de leur ration de pain.
Aghi me donnait toujours deux louches de pâtes qu’elle prélevait sur sa propre portion ; mais je n’avais aucun appétit et plusieurs fois elle me gronda pour m’obliger à manger.
Bella, Mini et Marie, ma sœur, venaient me voir régulièrement tous les soirs après le travail. Auparavant, elles allaient à la cuisine échanger leur pain contre des pommes de terre crues ou des carottes qu’elles cachaient dans la doublure de leurs jaquettes ; mais ce que je désirais le plus, c’étaient des oignons. C’était très drôle, car je ne les aimais pas du tout avant ma déportation. Elles ne pouvaient pas en trouver, mais elles me procuraient des bouts de poireaux, qui pour la plupart étaient pourris, et elles donnaient leur ration de pain pour cela, pour me sauver de la mort. L’ami...