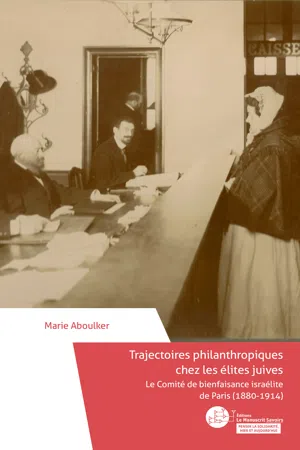![]()
Entre philanthropie traditionnelle et émergence de nouveaux besoins :
les missions des membres du conseil d’administration
Durant les dernières années du xixe siècle, les activités du Comité de bienfaisance s’intensifient : les montants distribués comme le nombre de personnes secourues augmentent. Le Comité développe ses missions en matière d’assistance en direction des plus fragiles, relayées sur le territoire parisien par un bureau de bienfaisance et deux sites de distribution de repas et de secours en nature. Dans ce contexte, la question du rôle des administrateurs dans l’organisation et le développement de ses activités se pose.
Il s’agit donc de chercher à évaluer l’investissement réel des administrateurs au sein du Comité afin de comprendre dans quelle mesure ceux-ci déterminent ses orientations et décident des projets engagés. L’analyse des réunions du conseil d’administration ou des commissions permet de revenir sur la fonction des membres du Comité et de mesurer leur degré de participation dans les différentes œuvres. Si la mise en œuvre des missions du Comité peut être envisagée comme un travail collectif, il faut cependant tenir compte de la composante individuelle de l’implication des membres : la présence aux réunions, l’investissement dans des commissions, la participation aux enquêtes, ou encore la mise en œuvre de nouvelles solutions ou de nouvelles activités.
L’implication des administrateurs dans la vie du Comité
L’implication effective des membres du Comité peut se mesurer à travers différentes sources, notamment les comptes-rendus des réunions, tant du conseil d’administration que des commissions. La mesure de l’implication des membres s’appuie sur plusieurs indicateurs. Il s’agit d’abord de la présence aux réunions, que l’on peut suivre à travers les listes de participants établies au début de chaque compte-rendu de séances, que l’on confrontera au contenu de ces mêmes registres. Seront également évoqués l’investissement dans le fonctionnement des commissions, que l’on peut analyser à travers l’exemple de la commission d’assistance pour laquelle nous disposons des registres de séances, ainsi que la pratique du don, forme particulière de l’investissement philanthropique, dont il faut évoquer à la fois le montant et la régularité.
La participation aux réunions
Les réunions du conseil d’administration ont lieu entre huit et cinq fois par an : généralement mensuelles, elles s’interrompent les mois d’été et reprennent en octobre. Ces réunions sont l’occasion pour les administrateurs de se retrouver afin d’écouter les rapports des différentes commissions, d’évoquer les problèmes auxquels sont confrontées les différentes œuvres, voire de faire des propositions. Ainsi, les séances du conseil d’administration permettent de veiller au bon fonctionnement du Comité, de surveiller ses finances et ses salariés mais également de discuter des projets d’œuvres et des règlements d’institutions nouvelles. Les réunions sont donc le cœur de la vie du Comité. Plutôt brèves – elles durent environ une heure – les réunions permettent de faire remonter devant le conseil les informations et les initiatives prises par ses membres.
Chaque compte-rendu de séance, dressé par le secrétaire du conseil d’administration, commence par une liste des participants. La comparaison de ces listes sur une longue durée nous permet de mesurer la participation de chacun des membres à ces différentes séances. Nous avons travaillé en particulier sur la décennie 1894-1904, pour laquelle nous avons relevé, de façon systématique, les participants à chaque séance. Si l’on considère que chaque année, le conseil d’administration est formé de trente membres, auxquels s’ajoutent d’éventuels membres honoraires participant encore aux réunions, à l’image des deux rabbins Zadoc Kahn et Jacques-Henri Dreyfuss ou encore d’Henri Bollack, membre honoraire depuis 1896 et qui assiste aux séances du Comité régulièrement jusqu’à sa mort en 1910, on constate que l’ensemble des administrateurs ne sont réunis qu’une fois dans l’année, à l’occasion de l’assemblée générale. En effet, lors des séances du Conseil d’administration, seuls 16 membres en moyenne sont présents, soit environ la moitié des membres du Comité. Selon les années, les variations sont grandes : les séances des années 1894-1896 sont nettement moins fréquentées, certaines réunions ne comptant que 8 à 10 membres, alors qu’en 1903 et 1904, le nombre de présents n’est jamais inférieur à 18. L’augmentation de la fréquentation au début des années 1900 peut s’expliquer par l’audience grandissante du Comité qui a développé massivement ses activités, notamment en raison de l’arrivée à Paris des juifs étrangers qui fuient les persécutions ou sont attirés dans la capitale par l’Exposition Universelle de 1900. Elle peut être également liée à l’évolution de la composition du Comité : les membres des années 1900 seraient, en raison de leurs situations professionnelles, plus disponibles, ou se sentiraient davantage concernés par le fonctionnement du Comité. Exerçant davantage des professions libérales, ils auraient davantage de temps à consacrer au Comité que les membres devant faire vivre une activité commerciale et industrielle. Entre 1894 et 1905, quarante et une personnes ont participé aux réunions : parmi elles, environ la moitié a été présente à plus de 70 % des séances sur la période retenue. Ce sont d’abord les membres du bureau, y compris le président Edmond de Rothschild, dont la disponibilité est exigée par leur fonction. L’exemple de David Seligman est significatif : nommé vice-président en 1890, il est très assidu aux réunions jusqu’en mars 1897. En novembre 1897, il présente sa démission, en mettant en avant des impératifs professionnels. Ne pouvant plus venir aux réunions, il cesse d’être membre du bureau. À la fin de la période, les nouveaux membres, Alfred Wimpfen, Albert Pontremoli, Max Wassermann, Lucien Sauphar sont également présents à la plupart des réunions, de même que les rabbins Kahn, Levy, Dreyfuss et Weiskopf. À l’inverse, d’autres membres ne viennent qu’à l’assemblée générale, à l’image de Léon Leder, membre du Comité entre 1887 et 1901 et qui ne participe jamais aux réunions, de Gabriel Anspach, qui, en dix ans, n’est venu que sept fois, ou encore de Louis Cahen d’Anvers, présent lors de six réunions seulement entre 1894 et 1904. Enfin, la fréquence de la présence de certains membres aux réunions varie selon les périodes : le plus souvent, les membres nouvellement nommés se rendent aux réunions chaque mois de l’année qui suit leur élection, pour se faire ensuite plus rares. D’autres, comme Emile Leven, ont une trajectoire inverse : nommé au Comité en 1887, ce dernier ne vient que huit fois entre sa nomination et 1900. À partir de cette date, il se montre très assidu aux séances qu’il ne manque que rarement, phénomène que l’on pourrait interpréter comme le signe d’un investissement plus important à cette époque, parallèlement à d’autres activités philanthropiques.
L’étude de la participation des administrateurs aux réunions du conseil d’administration permet déjà de distinguer plusieurs formes d’investissement au sein du Comité, entre ceux qui viennent souvent et régulièrement, qu’ils soient ou non membres du bureau du Comité et ceux qui ne participent qu’à l’assemblée générale ou à quelques séances ponctuelles. De manière plus qualitative, l’investissement des administrateurs peut se mesurer à travers la participation aux échanges, même si les comptes-rendus des séances dont nous disposons sont davantage un relevé de décision qu’une retranscription des débats entre les membres. Les réunions ont plusieurs fonctions. Elles s’occupent d’abord de l’organisation courante du Comité, en décidant des nominations, fixant le traitement des salariés ou mettant sur pied des quêtes exceptionnelles. Elles permettent aussi la remonté...