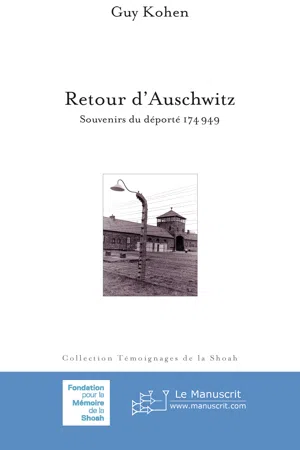![]()
En France
1
L’arrestation
Jamais on n’avait vu pareil temps en janvier. Le soleil n’était pas si pâle et les rayons qu’il lançait vigoureuse-ment sur les arbres dépouillés et les champs nus faisaient penser à une résurrection des forces de la Nature. Les chapeaux de paille faisaient une réapparition bien inattendue et l’on en arrivait à oublier les noirceurs et les difficultés d’une vie rendue amère par l’Occupation et à reconsidérer l’existence d’un point de vue optimiste ; la guerre ne pouvait pas toujours durer, et, en contemplant un ciel si bleu, nous retrouvions ce qui nous avait manqué depuis trois années : la joie de vivre.
Le déjeuner avait été excellent. Je me souviens encore de certain pâté en croûte qui nous fut servi ce jour-là. La personne qui faisait office de cuisinière s’était surpassée. Je me rappelle également la couleur brun doré du clafoutis. Notre chère hôtesse, cordon-bleu à la réputation bien établie, tenait évidemment à mettre en lumière le fait que la science pâtissière ne lui était pas non plus tout à fait inconnue.
Nous digérions béatement. Cependant, une pensée m’obsédait sans trêve depuis le matin. Je n’ai jamais cru en ce que l’on a coutume d’appeler un pressentiment, mais, néanmoins, la coïncidence est pour le moins curieuse. Un lutin entêté me tambourinait la tête depuis le matin en me répétant : « Mon Cher Ami, regarde-toi ! Tout va trop bien pour toi ; tu n’as pas faim et es ma foi bien gras ! Quand d’autres souffrent mille misères, tu coules des jours bien tranquilles et ton regard se pose rassuré sur un ventre qui n’a jamais eu l’occasion de faire des plis ! Mais prends garde, il se peut que cela ne dure plus si longtemps. »
Je n’avais rien prévu pour l’après-midi. Je devais aller me faire photographier à Sardent (petit bourg creusois situé à trois kilomètres du village où nous avions élu domicile). Il le fallait, car il était dans nos plans de faire établir une carte d’identité fantaisiste pour échapper à la déportation du travail . Malheureusement, le contrordre : « Ne vous dérangez pas aujourd’hui » m’était parvenu par l’intermédiaire du facteur. Si le photographe avait été disponible ce 28 janvier , il est infiniment probable que la Haute-Silésie n’eût jamais été honorée de ma visite ; mais il était sans doute écrit sur les tablettes de la Destinée que, comme tant de malheureux, je devais connaître la grande aventure.
N’allant donc pas au bourg, je m’occupais tranquillement en compagnie d’un de nos amis, berger de son état, à agencer une clôture de fil de fer, afin que les jeunes poulets ne puissent pénétrer dans le jardin. La pince en main, je tordais le fil, arrachais les clous, sortais les vieux piquets de leur emplacement afin d’en remettre de neufs, lorsque le bruit d’un moteur assez puissant me fit retourner la tête. Une grande automobile noire venait de stopper au milieu du chemin du village. Quatre hommes en descendirent. Un chien également.
Celui qui paraissait diriger l’expédition s’avança droit sur moi. Mon père, à son passage, lui demanda : « Vous désirez, monsieur ? » L’Allemand, un fort gaillard en trench-coat et chapeau mou, ne fit pas le moindrement attention à lui et, arrivant en face de moi, il me dit, une main dans sa poche : « Que faites-vous ici ? Comment vous appelez-vous ? » J’avais posé mes pinces et je le regardais droit dans les yeux. Dès ma première vision de la voiture, du fusil-mitrailleur et du chien de berger, j’avais compris. Je ne me faisais aucune illusion. Je savais, par l’audition des radios alliées, quel était le sort de ceux qui tombaient entre les mains des nazis. Ma conviction la plus intime était que les reportages britanniques sur les camps de concentration allemands en général, et sur le traitement infligé aux Juifs dans ces dits camps en particulier, bien loin d’être exagérés, ne devaient être qu’un pâle reflet de ce qui devait s’y passer en réalité.
Je répondis à ses deux questions : « Vous le voyez, je travaille à démonter cette clôture. Quant à mon nom, je m’appelle Guy. »
Le SD (abréviation de Sicherheitsdienst : « service de sécurité ») me répliqua très durement : « Guy, ce n’est pas un nom de famille, ça ! Guy comment ? Et vos papiers ? Les avez-vous ? Faites-les voir ! » Son français n’était ni très clair ni très correct, mais il était néanmoins possible de le comprendre. Je lui exhibais ma carte d’identité, laquelle portait un superbe cachet rouge « JUIF » en majuscules imposantes. Il fit : « Ah, ah ! », puis soudain, d’un seul coup, il me lança à la figure :
« Et votre père, où est-il ?
— J’ai déjeuné avec lui, je ne l’ai pas revu depuis.
— Y a-t-il longtemps que vous avez terminé votre repas ?
— Deux heures environ.
— Et où est-il ?
— Je viens de vous dire que je ne le savais pas.
— Vous avez certainement une idée sur l’endroit où il peut être et je vous conseille de nous la communiquer.
— Il est parti se promener dans les champs selon son habitude ; il ne reste pas toute la journée à la maison, qu’y ferait-il ?
— Où se promène-t-il ? Le lieu exact ?
— Il existe tant de prés et de champs aux alentours qu’il ne m’est pas possible de vous fixer.
— Vous ne voulez pas le dire ? Très bien. »
Puis, se retournant et montrant notre maison : « Vous habitez là, n’est-ce pas ? » Sur ma réponse affirmative, il me dit : « Précédez-moi » et m’indiqua d’un geste du menton la porte du rez-de-chaussée. Nous entrâmes tous deux dans la pièce. Il ouvrit une armoire, examina les deux lits, puis soudain :
« Et où couchez-vous ?
— Au premier.
— Allons-y », et, me mettant le canon de son revolver dans les côtes, il me fit passer devant lui pour monter l’escalier. Il examina tout et, se décidant enfin :
« Vous ne savez toujours pas où est votre père ? Vous me permettrez de vous dire que la discrétion poussée trop loin n’est pas toujours saine. »
Puis, brutalement :
« Vous venez avec nous, habillez-vous, et vite. »
Pendant que le policier m’interrogeait, mon père, réalisant enfin ce qui arrivait, était sorti par la porte qui donnait sur la route, seconde issue dont les sbires de la Gestapo n’avaient même pas soupçonné l’existence. C’est bien ce que j’avais escompté, en prolongeant à dessein mon interrogatoire par des réponses lentes et mal assurées aux questions trop vivement posées. Étant, bien naturellement, assez troublé, je pris ce que j’avais sous la main, et, une fois prêt, je descendis avec le colosse qui me conduisit à la voiture. Ils m’installèrent sur le strapontin, afin de m’avoir à leur complète merci et pour ne courir aucun risque inutile. Le chauffeur et le chef prirent place devant moi, les deux autres derrière, leur molosse sur les genoux. J’étais, ma foi, joliment encadré. La limousine démarra, et, le cœur serré, je jetai un dernier regard à notre pauvre grand-mère, à qui je venais de dire « À bientôt », en guise d’adieu, et qui s’était traînée jusqu’à la voiture avec une mine si défaite que les larme...