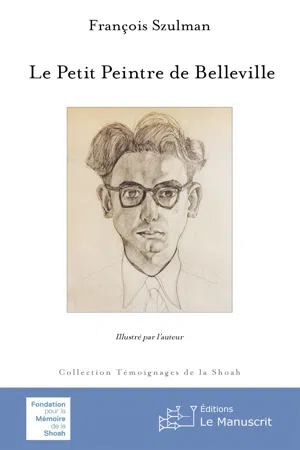![]()
Le retour de papa,
la mort de maman
1943
L’obligation du port de l’étoile jaune par les Juifs, dessin à l’encre de Chine de 1943.
Les premiers mois de l’année sont glacés. Un timide chauffage distillé par quelques bouts de bois enfouis dans un Godin vétuste ne permet pas d’éviter la chair de poule et les claquements de dents. Alors nous enfilons pull-over sur pull-over, mais rien n’y fait, nous continuons de grelotter. Je suis attiré par le givre qui se forme sur les vitres et subjugué par toutes ces formes que le hasard enfante : striures, craquelures, figures géométriques. J’éprouve une grande émotion. J’essaie malhabilement de copier cette image, mais je n’y arrive pas et de colère je déchire mon papier.
Le rationnement ne permet pas de se nourrir convenablement. Il manque de tout. Maman s’évertue à rendre notre ordinaire le plus goûteux possible. Malgré son talent de cuisinière, les résultats sont bien modestes.
Une classification selon l’âge commande les cartes d’alimentation :
E : Bébés
J1 : Jeunes enfants
J2 : Moyens
J3 : Adolescents
A : Adultes
T1-T2-T3 : Travailleurs
V : Vieillards
En fonction de ce classement, la nourriture est plus ou moins riche. Par exemple, les J1, J2 et J3 reçoivent du chocolat, évidemment en petite quantité .
Courant janvier, une lettre de mon père nous annonce que, peut-être, il sera de retour très bientôt, vœu auquel nous ne portons guère d’attention tant il nous paraît farfelu. Erreur, un télégramme nous surprend les premiers jours de février : « Je suis libéré, j’arrive à Paris gare de l’Est le 8 février 16 heures. Venez me chercher. Je vous embrasse. » Abasourdie par cette nouvelle surréaliste et inattendue, maman essaie d’organiser l’accueil de mon père. Premier problème à résoudre : comment accéder à la gare en portant l’étoile jaune ? Pour se protéger des froidures ma mère porte autour du cou une queue de renard argentée, et en la rabattant sur l’étoile, elle arrive facilement à la dissimuler. Pour cacher la mienne, ce sera le journal Le Téméraire , plié en quatre et maintenu avec ma main gauche. Ainsi affublés, nous nous rendons à la gare de l’Est en métro. Après avoir montré le télégramme officiel à un agent qui filtre les entrées, nous voilà sur le quai au milieu d’une foule de femmes et d’enfants. Le quai me semble interminable. Il se perd au loin dans un brouillard laiteux. Soudain des coups de sifflet stridents se font entendre. Le train arrive dans un bruit de tonnerre enveloppé par une fumée blanche. Il s’immobilise, la locomotive venant heurter les butoirs de fin de quai. Un bourdonnement joyeux s’échappe des wagons. Des hommes, tous vêtus du même costume prince-de-galles marron, sautent à terre avec à la main une valise en bois. Dans la bousculade, j’essaie de reconnaître mon père. J’ai du mal à me souvenir de ses traits après ces trois années d’absence. À travers le brouhaha, je crois entendre mon nom. « François ! François ! » Papa est là devant moi, il tombe dans les bras de maman, ils s’étreignent longuement. Autour de mon cou, les bras de mon père m’enserrent tendrement.
Ce moment d’émotion passé, il faut rentrer rapidement à la maison et ne pas s’éterniser sur ce quai encadré par une multitude de policiers et même de soldats allemands. Papa ne comprend pas cette précipitation et paraît comme ahuri. Nous descendons dans le métro et sur les marches nous lui dévoilons nos étoiles. Il se montre étonné. Nous montons dans le dernier wagon de la rame. De gare de l’Est à Jaurès, le trajet est court et ne dure que quelques minutes. Nous voici à la maison. Maman commence à lui expliquer notre situation. Il semble ne rien comprendre. Petit à petit, les traits de son visage se tendent et se creusent, un rictus de colère encadre sa bouche. Abasourdi par les propos de ma mère, il a l’air de débarquer d’une autre planète. En Allemagne, dans son Kommando à Mulhausen, il ignorait tout des persécutions antisémites. À son arrivée au Stalag I-B, il ne s’est pas déclaré comme juif. Grâce à une sympathie réciproque avec son gardien, un vieux Feldwebel social-démocrate, il est inscrit sur la liste en tête pour le rapatriement dans le cadre de la Relève .
Mais il faut très vite prendre des dispositions pour éviter le pire. Dès le début de l’année 1943, des informations incroyables commencent à circuler. Les Juifs sont systématiquement déportés vers l’est, en Pologne, pour y être massacrés. Il faut tout faire pour éviter d’aller à « Pitchipoï », pays imaginaire d’où l’on ne revient jamais. En tant que prisonnier de guerre mis en congé de captivité, mon père doit se présenter chaque quinzaine à la Kommandantur pour contrôle avec une pièce d’identité française. Pour l’obtenir il doit se rendre à la préfecture de police, démarche impossible qui révèlerait sa qualité de Juif entraînant arrestation immédiate et déportation. Il ne se présentera jamais à la Kommandantur.
Le lendemain du retour de papa, sur le petit matin, nous sommes réveillés par une tambourinade sur la porte.
« Ouvrez, police ! »
Papa ouvre la porte :
« Que voulez-vous ?
– Papiers ! Vous êtes juifs, nous venons vous arrêter !
– Vous êtes fous ! Je rentre du Stalag par la Relève, je suis arrivé hier. Vous croyez que les Allemands auraient libéré un Juif ? Tenez, voici mes papiers militaires. »
Les deux inspecteurs se regardent, l’air interrogateur :
« Mais la concierge vous a dénoncé comme juifs tous les trois !
– Elle est complètement folle, abrutie par l’alcool ! »
L’inspecteur qui paraît être le chef :
« Bien, dans ces conditions, nous partons. Au revoir. »
La porte refermée, tremblant de peur, nous nous affalons tous les trois sur des chaises. Nous reprenons doucement nos esprits. La décision est vite prise, il faut quitter l’appartement. Maman rassemble quelques affaires indispensables, papa remplit sa valise en bois de nos pièces d’état civil, d’albums de photo… Mon cartable gonflé de tout mon matériel de peinture frôle l’explosion. La porte est verrouillée à double tour. Nous dévalons l’escalier en silence. Nous baissons la tête en passant devant la loge de la concierge. Au bas de l’immeuble, nous tournons tout de suite à droite et nous remontons le boulevard de la Villette jusqu’à la place du Combat (aujourd’hui place du Colonel-Fabien). Là, nous bifurquons à droite avenue Claude-Vellefaux, nous la descendons vers la rue Saint-Maur. Nous longeons l’hôpital Saint-Louis, deuxième à gauche : la rue Sainte-Marthe. Nous voilà quasiment arrivés chez mon cousin Félix, au numéro 26.
L’appartement de mon oncle Isser s’étire dans un petit bâtiment d’un étage au fond de l’impasse. Devant l’entrée à gauche, un gros marronnier veille comme une sentinelle. Un escalier aux marches déformées monte vers un petit palier où une porte à deux battants s’entrouvre pour nous laisser passer. Félix nous accueille sur le seuil, il ne paraît pas surpris. Il nous attendait. Nous déposons dans l’entrée nos maigres baluchons. Nous pénétrons dans la salle à manger, à gauche la cuisine, puis deux chambres en enfilade avant l’atelier de casquettes, vaste pièce encombrée de machines à coudre et d’autres matériels divers. C’est notre première cachette. L’appartement de mon oncle n’est plus mentionné dans le fichier juif après la destruction de la fiche de Félix lors de son arrestation pendant la rafle du Vél’ d’Hiv’.
Rue Sainte-Marthe, dessin à l’encre de Chine de 1944.
Le bâtiment au fond de l’impasse au 26 rue Sainte-Marthe où François, sa mère et son père vécurent clandestinement à partir de février 1943.
Dans ce morceau du quartier de Belleville, délimité à l’ouest par la rue de Loos , au sud par la rue Saint-Maur, à l’est par la rue du Buisson-Saint-Louis et au nord par la rue de Sambre-et-Meuse, quelques familles juives décimées essaient de survivre au milieu de leur voisinage ni hostile ni amical. Les autochtones semblent nous ignorer, atteints d’une cécité contagieuse.
Midi sonne à la pendule trônant au milieu de la cheminée de la salle à manger. Maman racle les tiroirs de la cuisine et confectionne une purée avec les quelques pommes de terre qu’elle découvre. Nous voici tous les quatre à table, nous essayons de manger le plus lentement possible pour que ce festin s’éternise. Mon père et ma mère récupèrent un calme précaire après cette matinée agitée. Il faut rapidement trouver des solutions aux nombreux problè-mes posés. D’abord l’argent : papa a perçu une prime de 2 000 F à sa démobilisation. Bien entendu les allocations militaires sont annulées. Par conséquent il va falloir trouver de l’argent donc du travail. Ensuite, le ravitaillement : depuis ce matin, nous sommes dans la clandestinité la plus totale. Nous ne percevons plus de tickets d’alimentation. De toute façon, nous ne pouvons en aucun cas nous présenter dans un lieu officiel : mairie, associations d’aide… Nous risquons le pire : « Pitchipoï ».
Le seul fait positif, c’est le logement. Nous avons un toit. Grâce à son uniforme de Pétain, costume prince-de-galles marron, mon père peut circuler sans trop de tracas.
Devant toutes les bouches de métro, un car de police stationne. Des inspecteurs en civil et des agents contrôlent les papiers de tous les voyageurs qui sortent ou entrent. Les personnes ne pouvant décliner leur identité sont jetées manu militari dans le « panier à salade ».
Nous arrachons nos étoiles jaunes de nos vêtements. Je range précieusement la mienne. La décision est prise : je ne retourne plus à l’école. Je me rends dans le bureau de M. Gouin, le directeur, je lui explique que je suis dans l’impossibilité de venir en classe. Bouleversé, il m’étreint longuement. Pour faciliter mes déplacements, pendant les heures de classe, il mentionne sur ma carte d’identité scolaire obligatoire que je suis en convalescence après une maladie grave. Il m’accompagne jusqu’à la porte et me souhaite beaucoup de courage en attendant de me revoir très bientôt.
Rue Sainte-Marthe, la vie s’organise. Papa et maman occupent une chambre, la suivante est celle de Félix, moi je dors dans la salle à manger sur un canapé. Félix travaille dans une entreprise de gilets en peau de mouton retournée pour l’armée allemande : les établissements RETA, rue LaBoétie. Le besoin de main-d’œuvre permet aux quelques Juifs employés d’être très peu ennuyés. Son salaire hebdomadaire nous est d’un grand secours. Il assure les premières nécessités. Je passe mes journées à crayonner sur des morceaux de papier kraft récupérés. Deux fois par semaine, sur les ordres de mon père, je me rends boulevard de la Villette afin de constater si notre appartement est sous scellés. Je passe devant la loge de la concierge plié en deux pour ne pas me faire remarquer. Je n’ose frapper à la porte des Demonain, nos voisins de palier. Un jour lors d’une visite, je trouve la porte barrée par un ruban rouge, collé à ses deux extrémités par de la cire rouge frappée d’un aigle à croix gammée. Je n’ai retrouvé ma maison que quelques mois après la Libération.
Oncle Benjamin et sa famille survivent dans leur appartement du 28 rue des Gravilliers, près des Arts-et-Métiers. Dans cet immeuble, non déclaré au Commissariat aux questions juives , plusieurs familles trouvent refuge. Parmi ces personnes, certaines sont très à l’aise pécuniairement. Elles aident spontanément celles qui sont en difficulté. Nous leur rendons visite régulièrement, c’est notre rare distraction. Papa établit un itinéraire qui évite les grandes artères et les rues fréquentées. Pour se rendre de la rue Sainte-Marthe à la rue des Gravilliers, nous prenons des raccourcis semés de passages discrets. Mes seuls camarades de jeu sont mes deux petites cousines, Fanny et Régine. Paule...