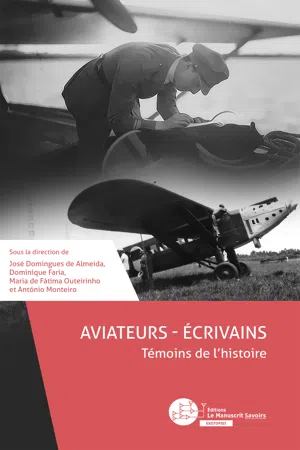![]()
Les origines de la poétique de l’aviation
Olivier Odaert
Académie des Beaux-Arts de Tournai
UCL-GRIT
L’apparition de l’avion dans la littérature a été presque immédiatement consécutive à sa médiatisation. Les vols d’exhibition du Flyer des Frères Wright au camp d’Auvours, près du Mans, en août 1908 et, dans l’année qui suivra, la multiplication des exploits aéronautiques et des meetings internationaux, ont suscité un enthousiasme sans limite, alimentant une attention médiatique incessante qui va contribuer à précipiter l’apparition de l’avion dans les représentations artistiques : en quelques mois à peine, tous les arts ou presque vont le faire entrer dans leur répertoire, à commencer par la littérature. Mais pour fonder leur poétique de l’aviation, les écrivains d’alors ont su tabler, en plus des récits médiatiques contemporains et, dans certains cas, de leurs propres observations, sur un vaste et antique substrat imaginaire, patiemment élaboré depuis les plus lointaines origines historiques par les innombrables mythes ascensionnels et autres récits d’anticipation qui ont précédé l’invention de l’avion, mais aussi par les témoignages des premiers accomplissements aéronautiques, depuis que les frères Mongolfier étaient parvenus à prendre la voie des airs, en 1783. Je me propose dans cette étude d’examiner ces sources diverses et pourtant cohérentes de la poétique de l’aviation.
Les précurseurs : mythes et légendes
Les précurseurs de ce qu’il faut se résoudre à appeler la littérature de l’avion, faute d’un adjectif adéquat, se sont presque tous emparés de modèles mythiques pour approcher dans leurs récits et leurs poèmes la réalité nouvelle qu’ils cherchaient à dire. Parmi la myriade des références possibles qui s’offraient à eux, c’est le plus souvent Icare qui a retenu leur attention : c’était déjà le cas dans les anticipations de Jules Verne, ce le sera encore sous la plume de Gabriele D’Annunzio. Le héros éponyme de Robur-le-Conquérant, ce roman publié par Jules Verne en 1885, et qui est à ma connaissance le premier roman d’anticipation consacré à l’aéroplane, même si l’appareil de Robur tient aussi de l’hélicoptère, se voit par exemple « maître de cette septième partie du monde, (…) cette Icarie que des milliers d’Icariens peupleront un jour » (Verne, 1885 : 72–73), sans songer une seconde, semble-t-il, au destin funeste de son modèle. Quant à D’Annunzio, auteur du premier roman d’aviation réaliste avec Forse che si forse che no en 1910, son « héros icarien » se souvient avec déférence de « la première aile d’homme tombée sur la Méditerranée », « l’aile icarienne » (D’Annunzio, 1910 : 62, 63, 145). Dès l’apparition de l’avion, et même un peu avant, l’homme ailé de la légende semble en fait avoir presque totalement, et assez inexplicablement a priori, éclipsé tous les Persée, Bellérophon et autres Ganymède de la mythologie, pourtant visuellement plus proches des aviateurs, puisque montés sur des animaux fabuleux, en quelque sorte, sur des appareils volants, là où Icare s’était contenté d’un déguisement d’oiseau.
Une première explication de la faveur d’Icare est que le fils de Dédale a l’insigne avantage d’avoir été, grâce à son père, le premier volateur industrieux, préfigurant de plusieurs millénaires cette grande réussite de l’homo faber, qu’il annonçait donc mieux que d’autres : le vol mécanique de l’aviateur. De fait, contrairement aux sandales d’Hermès ou aux ailes de Pégase, les ailes d’Icare ne viennent pas des dieux, mais de l’ingéniosité toute humaine de Dédale. Cette particularité d’Icare, cependant, n’explique pas tout, car la morale de la légende icarienne est limpide, et inquiétante pour qui se risque à prendre la voie des airs : le rêve de vol se confondait pour les anciens avec le désir blasphématoire de s’élever au rang des dieux, péché d’hubris que devait immanquablement sanctionner une chute mortelle, à moins d’avoir, comme l’architecte Dédale, le sens de la mesure. C’est la raison pour laquelle l’Antiquité et le Moyen Âge ont moralement condamné la figure icarienne, considérée alors comme le versant sombre de la créativité technique de son père. Le choix des premiers écrivains de l’aviation a donc de quoi surprendre, car il augurait de sombres lendemains en inscrivant au cœur des représentations de l’envol l’engramme sinistre d’une chute punitive, à un moment ou le scientisme aurait dû plus logiquement se confier au patronage de Dédale, que sa prudence avait sauvé tout à la fois du labyrinthe et des eaux.
Pour comprendre cette préférence des grands précurseurs, il faut sans doute s’émanciper de l’origine antique du mythe, ou plutôt de la signification que lui attribuèrent en leur temps Ovide ou Horace, tout autant que leurs homologues chrétiens du Moyen Âge, et s’intéresser aux contenus véritablement projetés par les pionniers de l’aviation sur leur modèle. Dans son étude des « métamorphoses du mythe » de Dédale et Icare, Michèle Dancourt a montré que « [l]à où l’Antiquité et le Moyen Âge prononçaient une irrévocable condamnation, les Temps modernes renvers[èr]ent toute négativité en élan et en gloire, voulant à toute force que le fils vole de ses propres ailes. » Icare serait devenu, et dès la Renaissance, « le prête-nom, l’homme de plume(s) d’un rêve d’absolu qui ne porte plus le nom d’hubris. » (Dancourt, 2002 : 61) Celui que le poète français Philippe Desportes appelait en 1573 « le jeune audacieux » (Deportes, 1573 : 787) serait ainsi devenu un emblème du nouvel envol de la civilisation européenne, au point que quatre siècles plus tard, Icare aurait encore représenté, pour les pionniers de l’aviation et leurs observateurs, une volonté d’émancipation qui, si elle ne se démarque pas vraiment de l’hubris initial, ne porte plus le poids de sa condamnation morale et figure bien un progrès technique dont l’Occident semble avoir oublié pendant trop longtemps les revers possibles.
Moins fréquente que celle d’Icare, la présence récurrente d’autres personnages mythiques dans la première littérature de l’avion, et en particulier d’Hermès et de Prométhée, auxquels D’Annunzio, pour ne citer que lui, compare volontiers ses aviateurs (D’Annunzio, 1910 : 104, 109, 202), confirme la prégnance de cette acception du mythe. Le destin de ces figures mythiques, en effet, est comparable à celui d’Icare, même si leurs statuts ontologiques diffèrent radicalement : Hermès, né d’une Pléiade, a dû négocier son statut d’Olympien, tandis que Prométhée a dérobé, comme on sait, le secret du feu aux dieux. Tous deux se sont donc rendus coupables d’hubris, au même titre qu’Icare.
Il faut encore mentionner le motif chrétien de l’ange, évoqué notamment par le même D’Annunzio dans son roman de 1910. Dans les livres d’emblèmes de la première modernité, où Icare était le plus souvent puni de sa témérité, les ailes des anges comme celles des oiseaux représentent un accès potentiel ou avéré au monde céleste, interdit aux simples mortels, mais ouvert aux vertus des hommes saints, comme en atteste notamment cette description de François de Sales, comparé à un oiseau perpétuellement en vol pendant son procès en béatification : « Cet incomparable oyseau est le véritable symbole d’une ame toute celeste, & d’un homme vrayement spirituel, qui n’a plus commerce avec les choses de la terre. » (Gambart, 1644 : 157)
Bref, oiseau merveilleux, ange, Icare, Hermès ou Prométhée, les modèles mythiques de la littérature de l’avion indiquent clairement que l’invention des frères Wright a immédiatement été associée, dans l’imagination collective, si pas au péché d’hubris, à la volonté de s’élever au rang de créature céleste, en abandonnant derrière soi le labyrinthe du monde et la misère de la corporéité animale. Car ce n’est pas l’orgueilleux et désobéissant fils de Dédale que l’avion est venu remplacer au ciel des symboles, mais le « jeune audacieux » de la Renaissance.
Outre l’héritage mythique, les premiers écrivains de l’aviation ont pu s’inspirer des récits plus ou moins réalistes des premières tentatives malheureuses comme des premiers exploits aéronautiques réels, mais aussi des nombreux récits d’anticipation qui avaient depuis longtemps envisagé la possibilité de la machine volante.
Si l’Antiquité semble s’être contentée de héros imaginaires et autres créatures légendaires, le Moyen Âge et la Renaissance ont eu leur part de fous volants, bien réels cette fois, que l’exemple fatal de cette tête-brûlée d’Icare n’aura pas empêchés, bien au contraire, d’essayer à leur tour de tutoyer le soleil en se lançant du haut d’une tour ou d’une colline, équipés d’ailes de fortune. Mais les échos littéraires de ces diverses tentatives et inventions plus ou moins fantasques n’ont pas dépassé le cadre des chroniques. Quant à la fiction d’anticipation, elle a longtemps fait du vol un simple prétexte narratif, à l’exemple de Cyrano de Bergerac avec sa fusée lunaire dans l’Histoire comique des Estats et empires de la Lune (1657) ou de Jonathan Swift avec son île volante dans Les voyages de Gulliver (1726). En d’autres termes, la poétique de l’aviation est restée cantonnée longtemps au mode allégorique, inauguré par Lucien de Samosate dans son Icaroménippée, au IIe siècle.
Avec les Lumières, en revanche, le fantasme du vol commença de se muer en rêve de progrès. Jean-Jacques Rousseau, en 1742, a composé un Nouveau Dédale de quelques pages, publié confidentiellement en 1801, dans lequel il soumettait la possibilité du vol artificiel au crible de sa raison scientifique. À son grand désarroi, le promeneur des rêveries y reconnaissait l’impossibilité de s’envoler avec de simples ailes artificielles, puis rejetait la fusée comme trop dangereuse, pour enfin sélectionner — et l’histoire lui donnerait temporairement raison — l’idée de l’aérostat, en suggérant de « trouver un corps plus léger qu’un pareil volume d’air » pour s’y élever (Rousseau, 1801 : 14). D’après lui, la navigation aérienne devait garantir un progrès de civilisation semblable à celui gagné par l’invention de la navigation maritime. Quelques décennies plus tard, Restif de la Bretonne, en 1781, ne s’embarrasserait plus du tout de réalisme technique et imaginerait la Découverte australe par un Homme-Volant en créant un Dédale français à l’audace toute icarienne. Équipé d’ailes artificielles, « lourde machine » dont la technologie se limite à associer un « rouage en bois » et un « ressort » (Restif de la Bretonne, 1781 : 36, 41), mais dont la puissance lui permet de transporter de très lourdes charges sur de longues distances, le héros de ce récit utilisera son invention pour bâtir une société utopique, d’abord sur une montagne inaccessible, ensuite sur une île des antipodes. Ainsi, chez Restif de la Bretonne, la poétique des ailes manifeste-t-elle, pour la première fois, un désir conjoint de progrès scientifique et social. Cependant, et malgré la référence à Dédale, c’est bien l’espoir ressuscité d’échapper à la condition terrestre qui anime les rêveries aériennes des auteurs du XVIIIe siècle, qui se voient échapper à toutes les contingences, notamment sociales, comme lorsque Rousseau se prête à rêver d’ailes et de plumes qui l’emporteraient avec « une impétuosité d’aigle », et s’imagine, en plein vol, considérant sous lui « le manège puérile [sic] de tous ces petits hommes qui rampent misérablement sur la terre » (Rousseau, 1801 : 9). Les auteurs romantiques confirmeront après eux cette association poétique entre l’ascension, le progrès et la libération du sujet. Charles Nodier imaginera ainsi au XIXe siècle l’homme futur avec un torse de « l’ampleur d’un aérostat », capable de traverser « les airs dans toutes les directions » (Nodier, 1832 : 334). La charge symbolique des envols aviateurs, au XXe siècle, ne serait pas fondamentalement différente.
Trois siècles après les dessins de Léonard de Vinci, lorsque les frères Montgolfier, dont le premier grand ballon prit son envol en 1783, réussirent pour de bon l’exploit de soulever de terre la carcasse humaine, les romantiques hésitèrent, si j’ose dire, à prendre la balle au bond, à l’exception de Lamartine, dont les allusions restèrent toutefois fort discrètes, même si leur contexte est assez significatif, puisqu’elles apparaissent dans une longue pièce intitulée La Chute d’un ange, qui renvoie au contenu du symbole icarien, dont l’ange déchu est l’avatar chrétien. L’Américain Edgar Allan Poe avait à vrai dire déjà ouvert plus clairement la voie en 1835 avec une de ses Histoires extraordinaires, qui fut traduite par Baudelaire sous le titre d’Aventure sans pareille d’un certain Hans Pfaall et raconte l’impossible ascension d’un ballon jusqu’à la lune. Les auteurs français attendirent quant à eux la deuxième moitié du XIXe siècle pour vraiment célébrer les exploits des ballonistes, comme on les appelait alors, sans doute parce que l’aérostat se devait de devenir dirigeable – ce qu’il fit justement vers 1850 – pour intriguer une imagination dynamique que ses ancêtres captifs avaient laissée de marbre. Théophile Gautier se fendit ainsi dès 1850 d’articles de presse consacrés à la locomotion aérienne. Gérard de Nerval suivit de peu en préfaçant un livre de Jérôme Turgan intitulé Les Ballons, en 1851. Jules Verne imaginera quant à lui, en 1863, une possible exploitation des nouveaux vaisseaux de l’air dans Cinq semaines en ballon. Comme chez Poe, le vol littéraire s’émancipe dans leurs textes de son statut de simple prétexte narratif, pour devenir l’occasion d’une douce rêverie scientifique chez Verne et Poe, ou plus simplement de rêves de progrès.
Mis à part les premières allusions de Lamartine en 1838, l’inspiration poétique, pratiquement contemporaine mais très distincte de l’imagination prosaïque, devrait attendre le bon vouloir de Victor Hugo qui, en 1859, célébrerait dans Plein ciel les nouvelles envolées dirigeables, qu’il gonfla de sa vision hyperbolique en s’imaginant, en bon romantique, c’est-à-dire peu soucieux des lois physiques, un voyage interstellaire, dont au contraire de Poe il ne s’embarrasse pas...