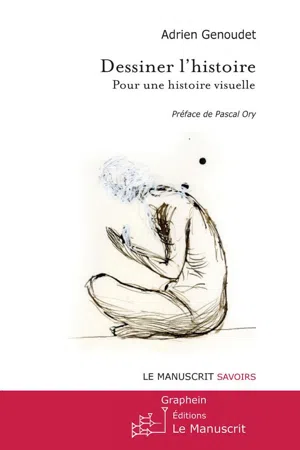![]()
La part inspirée du dessin
« Ses mains et son regard. N’importe quoi de n’importe qui de n’importe quand. Tout cela c’était lui. Tout cela et rien de plus. » Georges Perec, Le Condottière
Dessiner le passé, donc, pour mieux se ranger du côté du visible et de sa fabrique – dessiner le passé pour mieux tenter de comprendre le geste du dessin inscrit dans une généalogie visuelle. J’aimerais mettre en inquiétude, dans ce chapitre, l’idée du dessinateur à mains levées qui, maître des traits, produit une image ex-nihilo. On comprendra aisément, dans les lignes qui suivent, que je ne remets aucunement en question l’originalité de la création d’un auteur ou d’un dessinateur. Je ne cherche pas non plus à revenir sur des débats philosophiques ou d’historiens de l’art ancestraux. Je souhaite m’approcher d’une évidence qui a parcouru des étapes de mon enquête et de mes observations : le dessinateur, comme le peintre, accompagne son regard de modèles. Si ce constat multiséculaire m’intéresse, c’est parce qu’il pose directement la question de l’histoire et du passé et plus largement de la restitution d’époques, de situations, de personnages disparus. En effet, il est intéressant de voir que les dessinateurs, dès lors qu’ils souhaitent prendre l’histoire comme toile de fond – nous utiliserons cette expression faute de mieux – lorsqu’ils produisent du passé, semblent se confronter à un invariant : comment re-présenter, re-donner à voir une époque par définition invisible et disparue ? Quelque soit le degré de recherche du vraisemblable, un dessinateur qui place son récit et son intrigue au cœur d’une époque révolue monopolise tout un imaginaire de l’histoire – ce que nous nommons la visualité de l’histoire – infusée dans et par la culture visuelle de son temps. Cette prégnance visuelle contemporaine est pour moi fondamentale dans cette enquête : dessiner un gaulois avec de grandes moustaches n’est jamais un geste anodin, ce geste vient de quelque part, en ce sens qu’Harun Farocki note que dans « chaque geste affleure beaucoup de sa préhistoire » ; il est, lui aussi, inscrit dans un certain régime d’historicité visuelle. Qu’une bande dessinée soit humoristique, éducative ou « sérieuse », le dessinateur engage tout un processus d’appropriations et de restitutions de sa propre culture visuelle qui vient infuser et diffuser une certaine visualité de l’histoire. Or, et c’est ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce chapitre, au-delà du souci de vraisemblable, les dessinateurs ont à disposition tout un ensemble d’images qui peuvent être à la source de leur geste, de leur inspiration. En effet, si le passé est une image et qu’il est, dans sa dimension historiographique par définition évanoui et invisible, il reste pourtant incarné culturellement dans de nombreuses productions visuelles : photographies, gravures, films, dessins etc. Les époques passées existent en tant que passé, c’est-à-dire en tant que visuel à travers leur performance. Je me suis donc demandé ce que faisaient les auteurs de cet éventail du visible qui compose notre culture et qui délimite la visualité de l’histoire. Si les auteurs dessinent à mains levées, ils dessinent très souvent à mains voilées, c’est-à-dire les mains recouvertes de multiples couches d’appropriations d’images existantes. C’est ce geste extrêmement complexe – qui mériterait à lui seul une étude approfondie – que j’aimerais interroger ici ; car, plus largement, il questionne ce que cela peut impliquer et signifier, dans notre société contemporaine, de Dessiner l’Histoire. Si ces opérations sont difficiles à élucider et à donner à voir, je ne prendrais ici que quelques exemples évidents – parmi tant d’autres – pour mieux prononcer les pistes qu’offrent de tels constats. Parler de part inspirée du dessin, c’est bien comprendre que tout geste s’éparse comme un mouvement respiratoire : de l’inspiration comme dialectique du contenant et du contenu à l’expiration comme émancipation et diffusion. Le dessin s’exprime comme un souffle. On comprendra que j’utilise le sens d’« inspiration » dans le sens « d’être inspiré par » quelque chose ou quelqu’un et non pas dans le sens convenu et vernaculaire « d’avoir de l’inspiration », celle que l’on cherche pour se trouver ; celle-là même dont parle Chateaubriand dans sa Lettre sur l’art du dessin dans les paysages :
« Alors il s’aperçoit qu’il y a des principes qu’il ignore ; il est forcé de convenir qu’il lui faut un maître : mais un pareil élève ne demeurera pas long temps aux principes, et il avancera à pas de géant dans une carrière où l’inspiration aura été son premier guide »
Dès lors, quelle est cette part inspirée du dessin et que nous dit-elle de notre rapport culturel au passé ?
À main voilée : de l’apprentissage à la recherche du vraisemblable.
Une certaine pensée de l’histoire de l’art veut que les époques et leurs modes de reproduction de la nature ou des modèles se donnent la main, s’interpénètrent et s’influencent. On doit en partie cette lecture importante – quoique qu’extrêmement progressiste – à l’école viennoise et notamment à Ernst Gombrich. Ce qui est extrêmement intéressant dans le cadre de cette projection généalogique, c’est que l’on peut l’imaginer s’incarner dans chaque cours de dessin d’écoles des Beaux Arts. La caricature de Daniel Alain datant de 1955 dévoilée par Gombrich en introduction de L’Art et l’Illusion représente un groupe de jeunes artistes égyptiens en train de reproduire un nu de profil. Cette image démontre entre autres qu’une part importante de la biographie d’un dessinateur est occupée par le geste de reproduire, de copier, de saisir par le trait ce que l’on a devant les yeux. Si Gombrich présente cette caricature pour interroger la question du style, elle nous intéresse particulièrement dans son symbole. Il va de soi que l’acte d’exercer sa main au dessin à partir d’un objet quelconque, d’un corps nu ou d’après nature ne soit pas le même que l’acte du faussaire dont parle si bien Georges Perec dans Le Condottière. L’histoire de l’art et la philosophie antique n’ont eu de cesse de revenir sur les distinctions des premiers temps et sur les notions de mimesis, d’eikōn ou encore de phantasma pour ne prendre que la philosophie platonicienne et aristotélicienne. De la reproduction par la main du réel de la nature à la copie d’une image existante – faire une image d’image – en passant par l’éthique ou encore l’aura, la pensée antique, classique et contemporaine a développé de larges considérations et réflexions qu’il est inutile de résumer ou d’exploiter toutes ici. Dans la plupart des cas, un des problèmes récurrents est un réel invariant : il y a une distinction fondamentale entre l’apprentissage et l’appropriation – l’action de rendre propre, c’est-à-dire, à soi. Nombreux sont les théoriciens et praticiens de l’art qui fendent l’air d’un sillon indépassable : copier pour apprendre et s’inspirer pour être original – ce qui implique de s’émanciper du modèle. Nous allons le voir, dessiner le passé nous oblige à passer outre ces oppositions ancestrales. Disons-le dès maintenant pour couper court à tout soupçon de déclaration déontologique creuse ou de jugements fardés : un dessinateur inspiré est pour moi un créateur comme un autre, je ne fais aucune distinction, aucune hiérarchie. Lorsqu’un dessinateur utilise une image déjà existante, qu’il s’inspire d’un visible existant pour redonner à voir le passé historique, de quel geste parlons-nous ?
Précis d’histoire dessinée à grands traits
L’art du dessin a toujours été – comme la musique – accompagné d’ouvrages d’enseignements. Encore aujourd’hui, il est très facile de se procurer des manuels d’apprentissages du dessin qui s’apparentent au système de la tablature en musique. Derrière ces ouvrages, se cache une conception mécanique ou sportive du geste qui ne demande qu’à être réglé, éduqué, dressé. On sait combien la place du « maître » en peinture était fondamentale dans la formation, l’éducation et la carrière d’un peintre à l’époque médiévale et surtout à l’époque moderne. Reproduire les œuvres d’un maître ou des maîtres du passé – qui indique ici une certaine conception qu’une société se fait de l’histoire – était l’exercice obligatoire d’un dessinateur ou d’un futur peintre. Joachim von Sandrart écrivait par exemple en 1675 :
Quand notre entendement élabore d’excellents concepts, et que la main, exercée par de longues années de dessin appliqué, les transcrit sur la feuille selon les règles de la raison, la parfaite excellence du maître et de son art devient évidente
Ernst Gombrich, qui se penche sur l’histoire de l’apprentissage du dessin et de la peinture à la période médiévale jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, consacre plusieurs passages sur la manière dont « les académies de dessin [en Europe] appliquaient un programme soigneusement gradué, passant de la copie de gravure au dessin d’après l’antique, avant de permettre aux artistes d’affronter l’épreuve du monde réel ». Dès le XVe siècle et surtout au XVIe siècle, commencent à être diffusés de nombreux manuels pour apprendre à dessiner. Ces ouvrages touchés d’un fort souci idéologique ont forgé et répandu des conceptions académiques et conformistes de la représentation et du trait. Le plus important a été celui d’Odoardo Fialetti intitulé La Véritable Méthode pour apprendre à dessiner dans l’ordre des membres et toutes les parties du corps humain en 1608. Dans une dissection séquentielle des étapes du geste, qui peut faire penser à une bande dessinée expérimentale, l’ouvrage de Fialetti introduit cette importance de l’apprentissage du dessin par la mécanique du geste, par le dressage du trait. Grâce à ce type de traités, de brochures ou d’ouvrages, les dessinateurs, graveurs et peintres peuvent apprendre plus facilement à dessiner des animaux, une oreille, un œil etc. Dans cet ordre d’idée, l’encyclopédie d’images du néerlandais Crispyn Van de Passe intitulée Lumière de la Peinture et du Dessin en 1643 est un autre parfait exemple de diffusion de ces schémas de compositions dessinées ; on peut également noter le Recueil de figures académiques, récemment composées d’après nature, à très grand’ peine et à grands frais, indispensable à la jeunesse passionnée de l’art du dessin de Pieter de Jode publié à Anvers en 1629. On trouve ces ouvrages tout au long des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Largement basés sur le nu académique, ces manuels n’en démontrent pas moins la volonté d’éduquer le regard du dessinateur, du graveur ou du peintre par le biais de l’apprentissage via le copiage de schémas partagés. Cette forme de croyance était largement répandue, elle a conditionné un grand pan de la création européenne et donne à voir l’importance du suivi d’une certaine généalogie visuelle, sur laquelle nous reviendrons dans les pages finales de cet essai. Cela fait d’ailleurs dire à Gombrich, que nous suivons jusque là :
Van de Passe introduisit également dans son dictionnaire visuel des images empruntées à un opuscule de Sebald Beham, et si les putti de Rubens ont l’air d’avoir attrapé les oreillons, je soupçonne fort qu’ils leur ont été transmis par Beham. [… ] notre intérêt s’accroît lorsque nous en arrivons à nous demander si un maître de la taille de Rubens ne pourrait pas avoir été influencé quand il peint des portraits d’enfants, voire ceux de ses propres fils, par les représentations schématiques des proportions qu’il avait appris à respecter dans sa jeunesse
On voit bien combien la question posée ici est épineuse et qu’elle ouvre, dans le même temps, une porte d’entrée essentielle à notre réflexion : la part inspirée, voilée, du dessinateur. Cette réflexion – prise à travers cet éclat de l’histoire de l’art – est un fil tendu entre la philosophie antique et la pratique actuelle du dessin dans la bande dessinée. Court le long de cet invariable la question du geste que l’on dresse puis que l’on émancipe ; toujours est-il que cette part inspirée est à prendre en compte dans le cadre d’une enquête sur le dessin parce qu’elle permet de répondre à notre souhait de déhiscence. À la fin du XVIIIe siècle, des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau dans L’Emile ou De l’éducation (1762) ou comme Chateaubriand dans sa Lettre sur l’art du dessin dans les paysages (1795) cherchent à rompre avec l’enseignement du dessin pour inviter les créateurs à revenir à la Nature comme principal modèle :
Il faut donc que les élèves s’occupent d’abord de l’étude même de la nature : c’est au milieu des campagnes qu’ils doivent prendre leurs premières leçons. Qu’un jeune homme soit frappé de l’effet d’une cascade qui tombe de la cime d’un roc et dont l’eau bouillonne en s’enfuyant : le mouvement, le bruit, les jets de lumière, les masses d’ombres, les plantes échevelées, la neige de l’écume qui se...