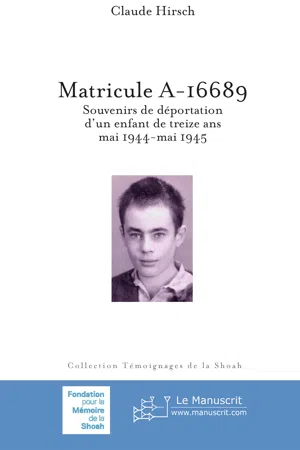![]()
Dans le vif du sujet
Au bout de trois jours et trois nuits de voyage, nous nous étions profondément enfoncés au cœur de l’Europe, puis en étions ressortis pour aboutir en Europe de l’Est. Convois militaires, transports de marchandises, trains de voyageurs, tout cela passait à l’arrière-plan. Il fallait que notre destin s’accomplisse. Les décisions prises par le régime hitlérien à Wannsee devaient être exécutées, coûte que coûte. Il en allait de la pureté de la race aryenne, même si les moyens de transport de l’Allemagne ne suffisaient même plus aux besoins essentiels d’un pays en guerre totale. Goebbels, chef de la propagande, s’adressant à un parterre d’uniformes dont certains gravement éclopés : « Wollt Ihr den totalen Krieg ? – Ja ! », hurlait la salle surexcitée. Cette scène est passée bien des fois à la télévision. Ils l’ont eue, la guerre totale. Nous aussi, d’ailleurs. Pour les privilégiés du régime que nous étions, Die Juden sind unser Unglück ! , « Les Juifs sont notre malheur », il y a toujours eu des locomotives, du charbon, des équipes de conduite et des circuits de voies praticables.
Le voyage se termina à Birkenau, région d’Auschwitz . Pour un germaniste, Birkenau est un lieu planté de bouleaux : die Birke, « le bouleau », die Au, « la prairie » en allemand. Des bouleaux, il y en avait peut-être eu à cet endroit. Mais le site n’avait plus rien d’agreste en ce début de juillet 1944.
Les loquets de nos wagons furent ouverts et on fit coulisser les portes. Nous étions arrivés. Il faisait jour et toujours ce beau soleil d’été. Nous fûmes invités à descendre sur un quai, aidés le cas échéant par des détenus du camp vêtus de la tenue rayée de bleu et de gris que bientôt nous porterions aussi.
J’étais encore avec mes parents. Nous fûmes priés d’avancer. Un premier tri eut lieu : les femmes d’un côté, les hommes de l’autre. Ma mère partit avec ses compagnes. Je ne la revis jamais.
Un souvenir me revient à son propos. À Monowitz qui devait être mon camp d’affectation en Haute-Silésie, j’avais des camarades plus âgés qui, ayant connu mon père à Lyon-Montluc, veillaient quelque peu sur mes destinées. Un soir, l’un d’eux me tendit un petit papier soi-disant écrit par ma mère et sur lequel étaient tracés quelques mots au crayon. D’après ce camarade, ma mère travaillait dans un commando , dans la même zone où travaillait aussi un commando détaché du camp de Monowitz. Des contacts avaient lieu entre ces deux commandos, d’où la transmission du message. Je ne reconnaissais pas l’écriture de ma mère et restai très incrédule sur l’origine du billet. Mon camarade avait sans doute organisé une petite supercherie pour me remonter le moral, ce qui partait d’un bon sentiment. D’après des renseignements que ma grand-mère a recueillis après la guerre d’une dame qu’elle connaissait, ma mère aurait travaillé dans une usine de munitions et serait morte d’une pneumonie fin 1944. Après la guerre, ma grand-mère me demanda à plusieurs reprises d’entrer en contact avec cette personne. Je lui opposai à chaque fois un refus catégorique. Je referme cette parenthèse.
Mon père et moi nous acheminâmes, avec la troupe des hommes, vers un bâtiment de douches. À ce moment, on nous fit déshabiller dans un vestiaire. Lorsque nous fûmes déshabillés, le SS qui dirigeait les opérations fit sortir du groupe mon père et un autre homme, tous deux plus âgés que le reste du groupe. J’eus alors de mon père une dernière vision : il était nu comme un ver et fut entraîné par le SS hors du vestiaire avec son compagnon. Sur le pas de la porte, il réussit à me faire une ultime recommandation à mi-voix : « Fais attention à ta hernie ! ». En effet, j’avais eu vers quatre ou cinq ans une hernie inguinale qui ne devait à nouveau se manifester que lorsque j’atteignis la quarantaine. Dès ce moment, je mesurai avec une froide lucidité que selon toute probabilité j’étais promis à l’appellation et à la dignité d’orphelin.
Restaient donc les plus jeunes, dont je faisais partie. Nous reçûmes une douche, une vraie douche. C’était de l’eau chaude qui fusait des pommes de douche fixées au plafond bas en béton du local. Dans d’autres bâtiments du même modèle, l’eau chaude était remplacée par de l’acide cyanhydrique. Il est vraisemblable que mon père, jugé inapte au travail en raison de son âge et d’une légère boiterie, fut gazé tout de suite au Zyklon B. Ce poison était en réalité l’acide cyanhydrique. L’acide cyanhydrique, HCN pour les chimistes, est un poison qui se fixe sur l’hémoglobine, la rendant inapte au transport de l’oxygène par les globules rouges du sang entre les poumons et les cellules de l’organisme. Le cerveau est particulièrement sensible au manque d’oxygène puisqu’il ne résiste pas à plus d’une ou deux minutes d’anoxie, une ou deux minutes pendant lesquelles la conscience s’éteint sans doute comme la flamme d’une bougie sous une cloche de verre étanche, laissant au supplicié un bref temps de conscience et de lucidité suffisant pour souffrir atrocement. On a retrouvé sur les parois des bunkers les traces laissées par les malheureux avec leurs ongles sur la paroi de béton.
Cette technique à haut rendement avait pour les SS l’immense avantage de permettre une extermination industrielle des suppliciés, sans effusion de sang et sans qu’il y ait eu besoin d’exécutants allemands. En effet, chaque fois que c’était possible, les Allemands se déchargeaient sur les détenus eux-mêmes des tâches les plus abjectes. C’étaient des détenus qui enfournaient les futures victimes dans les chambres à gaz, qui extrayaient les cadavres lorsque l’acide cyanhydrique avait fait son effet et qui les brûlaient dans les fours crématoires. Il faut rappeler ici qu’au fur et à mesure que les arrivages de juifs se faisaient plus massifs, les techniques d’extermination durent être adaptées. Dans les premiers temps, les SS abattaient leurs victimes à la mitrailleuse au bord des fosses que les fusillés devaient préalablement creuser eux-mêmes. Le rapport qualité/prix de cette méthode était défavorable. En outre, elle mettait les nerfs des SS à rude épreuve. Un restant d’humanité peut-être ?
Dans un deuxième temps, ils essayèrent une première méthode chimique : enfermés dans des camions étanches, les victimes furent asphyxiées par les gaz d’échappement du moteur Diesel du véhicule. Le rendement restait en dessous des normes requises. C’est alors qu’un ingénieux technicien eut l’idée d’adapter à la liquidation des juifs une méthode utilisée pour détruire les rongeurs. Cette méthode, d’une redoutable efficacité, consista à faire agir de l’acide sulfurique sur du cyanure de potassium. L’acide sulfurique déplaçait l’acide cyanhydrique de son sel de potassium sous forme gazeuse. Il était facile de diriger le courant d’acide cyanhydrique dans un local hermétiquement clos où étaient entassés les suppliciés. C’est ainsi que mon père, comme tant d’autres, a vraisemblablement fini ses jours. Il avait eu cinquante ans trois jours avant notre arrestation.
J’étais désormais seul dans la vie, livré aux aléas d’une aventure inédite, gardé par des hommes armés et en uniforme, à l’âge de treize ans et demi. Par chance, j’étais entouré de camarades qui avaient connu mon père et dont la présence tutélaire me rassurait. En fait, je ne me souviens pas d’avoir eu besoin d’être rassuré. L’avenir ne représentait rien pour moi. Je vivais dans l’instant présent et ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Je puis affirmer que jamais au cours de toute ma déportation je ne connus dépression, mal-être existentiel ou autres fadaises à la mode dont aujourd’hui nous abreuvent toutes sortes de professionnels dont le métier commence par « psy » ! Ce qui contribuait à maintenir mon moral en bonne forme était bien sûr le fait qu’à l’est et à l’ouest, deux puissantes mâchoires s’apprêtaient à broyer le grand Reich millénaire.
Nous nous rhabillâmes, était-ce déjà en tenue rayée de Häftling ou encore avec nos habits civils, je ne m’en souviens plus. Toujours est-il que nous gagnâmes notre camp d’affectation à pied, en rang et en bavardant. En quittant Birkenau, nous longeâmes un camp de femmes puis un camp de Tziganes. Ce fut une marche dont je garde le souvenir d’une promenade le long d’une route, par un beau et chaud soleil d’été, nullement exténuante.
Nous étions en Haute-Silésie, province allemande de l’est. Après la chute du IIIe Reich, cette région devint polonaise tandis que l’URSS s’agrandit vers l’ouest d’un territoire équivalent en annexant un morceau de Pologne orientale. Le paysage était plat, une plaine sans le moindre relief, marécageuse, caillouteuse, où poussait une maigre végétation de roseaux et quelques bouquets de saules, peut-être une moraine laissée par d’anciens glaciers descendus des Beskides proches. À moment donné, nous franchîmes une rivière sur un pont : c’était la Vistule. Je devenais fort en géographie, mais je ne pensais nullement qu’un jour je franchirais la Vistule.
En fin d’après-midi, nous atteignîmes la terre promise : le camp de Buna-Monowitz. Pourquoi Buna : le mot était formé des premières syllabes accolées de butadiène et natrium, sodium en allemand. Dans le combinat chimique auquel était rattaché notre camp, on fabriquait du caoutchouc synthétique par polymérisation de butadiène en présence sans doute de sodium. Le camp se composait de nombreuses baraques en bois ou blocks, disposés selon un urbanisme géométrique. Une large allée centrale et des allées secondaires desservaient tous ces blocks, sans oublier une grande place ou Appellplatz, où, comme son nom l’indique, les SS procédaient aux comptages de leurs têtes de bétail. Au fond, l’infirmerie. Le tout était, bien entendu, entouré d’une clôture de barbelés montés sur des isolateurs, eux-mêmes fixés sur des poteaux de ciment. Les barbelés étaient parcourus par un courant électrique. Plus d’un désespéré s’y jeta durant mon séjour pour mettre fin à ses jours. L’entrée du camp était commandée par le bâtiment des sentinelles et non loin se trouvaient les logements des S...