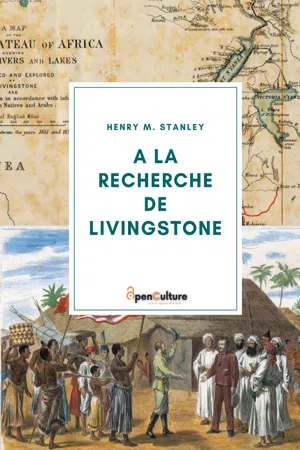![]()
XIX
Notre Argo. — Départ. — Bangoué. — Kigoma. — Paysage. — Scènes chan-geantes. — Villages. — Nature des roches. — Bergeronnettes. — Zassi. — Kiras-sa. — Sondage. — Frontière de l’Ouroundi. — Alluvion. — Contrée hostile. — Tribut réglé par Livingstone. — Vol. — Toujours même richesse. — Futte de vitesse. — Bikari. — Visites suspectes. — Curiosité polie. — jeune moutouaré de belle mine. — Guerre peu active. — Mougéré. — Fièvre. — Aimable cente-naire. — Fond du lac. — Le Roussizi. — Question résolue. — Côte occidentale. — Ilots du New York Herald. — Scène tragi-comique. — Retour.
Bien que notre Argo fût simplement une frêle pirogue creusée dans l’un des superbes mvoulés d’Ougoma, il avait une plus noble destination que celle du vaisseau grec d’antique mémoire. Ce n’était pas l’amorce d’une toison d’or qui le faisait partir, c’était l’espoir de trouver un chemin qui peut-être amènerait les barques du Nil jusque dans le Maroungou. Arabes et indigènes répétaient que le Roussizi sortait du Tanganyika, et nous supposions qu’il se rendait au lac d’Albert ou à celui de Victoria.
D’après ce que nous avait dit Ben Médjid du port de son canot, nous avions embarqué vingt-cinq hommes, dont quelques-uns s’étaient munis de sacs de sel pour faire un peu de commerce ; mais à peine avions-nous quitté la rive qu’il fallut y revenir : le canot trop chargé enfonçait jusqu’au bord. Six hommes de l’équipage furent remis à terre, le sel également ; nous restâmes alors avec seize rameurs, plus Sélim, Férajji et les deux guides. Cette fois, convenablement lestée, la pirogue se dirigea vers l’île de Ban-goué, située à quatre ou cinq milles de notre point de départ. Il y a quelques années, les Vouatouta ayant fait irruption dans l’Oujiji, la plupart des habitants, Arabes et indigènes, se réfugièrent à Bangoué ; tous ceux qui restèrent furent anéantis par le fer et par la flamme.
De là, suivant les courbes du rivage, nous arrivâmes à Kigoma, dont la magnifique baie formerait un port excellent. Il n’était pas plus de dix heures, mais une forte brise, qui menaçait de nous pousser au large, nous engagea à échouer le canot et à dresser nos tentes. Kigoma est d’ailleurs, pour les gens que rien ne presse, la première escale à partir d’Oujiji. Le lendemain, au point du jour, après avoir déjeuné et pris le café, nous nous remettions en route.
Parfaitement calme, le lac reflétait l’azur sans nuage qui se dé-ployait au-dessus de nos têtes, en lui donnant toutefois une cou-leur plus foncée et de nuance verdâtre. Les hippopotames venaient souffler à proximité alarmante du canot, et replongeaient rapidement comme s’ils avaient voulu jouer à cache-cache avec nous. En face des hautes collines du Bemba, la teinte de l’eau parut annoncer une grande profondeur ; nous jetâmes la sonde, elle indiqua trente-cinq brasses ; nous étions alors à un mille du rivage.
Cette rangée de montagnes, revêtue d’une herbe d’un vert éclatant d’où s’élevaient de grands bois et qui plongeait ses flancs abrupts jusqu’au fond du lac où elle jetait ses promontoires, était d’une grande beauté. À chacune des pointes que nous doublions, c’étaient de nouvelles surprises et dans chacun de ces plis un tableau ravissant : des bouquets d’arbres couronnés de fleurs, d’où s’exhalaient des parfums d’une suavité indicible ; une variété infinie dans les contours : des pyramides, des cônes tronqués, des tables rases, des toits pareils à ceux des églises, des croupes unies et gracieuses, des crêtes déchiquetées et sauvages —scènes changeantes, qui nous arrachaient des cris d’admiration. Que je fusse ravi, cela n’avait rien de surprenant ; mais le docteur lui-même, que j’aurais cru blasé sur de pareils tableaux, n’était pas moins en-chanté que moi. Je n’avais rien vu de pareil depuis que j’étais en Afrique, rien de semblable à ces hameaux de pêcheurs, enfouis dans des bosquets de palmiers, de bananiers, de figuiers du Bengale et de mimosas : bosquets entourés de jardins et de petites pièces de terre dont les épis luxuriants regardaient l’eau transparente où se reflétaient les cimes qui leur servaient d’abri.
Evidemment, les pêcheurs qui habitent ces parages trouvent leur situation bonne : le poisson abonde ; les pentes, cultivées par les femmes, produisent du sorgho et du maïs en quantité ; les jardins sont remplis de manioc, d’arachides et de patates ; les élaïs procurent l’huile et le breuvage ; les bananiers des masses de fruits délicieux ; et les ravins de grands arbres de quoi faire les pirogues. La nature leur prodigue là tout ce qu’ils peuvent désirer. Quels doivent être leurs soupirs quand, arrachés de ces lieux, ils traversent les déserts qui les en sépareront pour toujours ; quand ils marchent enchaînés, conduits par les hommes qui les ont achetés huit mètres de cotonnade pour leur faire faire la cueillette du girofle ou le métier de porte-faix ?
Aux environs de Niasanga, notre deuxième halte, la côte, avec ses collines, ses retraits charmants, ses cultures, ses troupeaux, me rappela tout à fait les rives du Pont. Comme nous venions de débarquer, je tuai un grand cynocéphale qui mesurait quatre pieds neuf pouces, de l’extrémité du museau à celle de la queue, et dont le poids était d’environ cent livres ; la face n’avait pas moins de huit pouces et demi de longueur. Pas de crinière, pas de touffe de poils au bout de la queue, mais tout le corps revêtu d’un pelage très rude. Les singes de ce genre se voyaient en grand nombre, ainsi que l’espèce à tête de chat et à longue queue, espèce très active et plus petite.
Niasanga, situé au bas d’un amphithéâtre de collines et à l’embouchure d’un ruisseau qui porte le même nom, a, comme tous les villages voisins, ses bouquets de palmiers et de bananiers, ses champs de maïs, de sorgho et de manioc. Nos tentes furent dressées sous un figuier-banian ; près d’elles se trouvaient une demi-douzaine de pirogues de différentes grandeurs ; en face de nous l’immense nappe d’eau, attirant la brise ; et dans le lointain l’Ou-goma, l’Oukaramba et l’île de Mouzimou, dont les montagnes nous apparaissaient revêtues d’un bleu foncé. Les galets que nous voyions sur la grève, en petits monceaux ou en lignes formées par les vagues, étaient des fragments de quartz, de grès congloméré, d’argile très ferrugineuse, d’argile durcie, etc., et nous révélaient la nature des roches environnantes. D’énormes roseaux s’élevaient entre le rivage et les cultures. Parmi la gent ailée, nous remarquâmes surtout les bergeronnettes, que protègent les indigènes ; pour eux, ce sont des messagères d’heureux présages, et quiconque les attaquerait serait frappé d’une amende. Il faudrait être d’ailleurs bien méchant peut leur nuire ; elles se montrent si confiantes ! À peine touchions-nous la rive qu’elles venaient à notre rencontre et voltigeaient à portée de notre atteinte. En fait d’oiseaux, nous vîmes encore là des tourterelles, des paddas, des bandes de veuves, des corneilles, des martins-pêcheurs, des oies, des plotus, des milans, des aigles, des balbusards.
Le troisième jour, nos tentes se dressaient à Zassi, petit village situé également à l’embouchure d’un ruisseau dont il a pris le nom. Les montagnes s’élevaient de deux mille à deux mille cinq cents pieds au-dessus du lac, et le pays me semblait à chaque instant devenir plus pittoresque, la scène plus vivante. Pas une courbe du rivage qui n’eût ses cases en forme de ruche ; pas une terrasse, pas une banquette, voire un talus, qui ne fût occupé.
Le Kirassa, groupe de montagnes coniques, s’élève à côté de Zassi, qu’il fait reconnaître de loin. À la hauteur de ce groupe, le lac a trente-cinq brasses de profondeur mais, à un mille de cet endroit, ma sonde, qui était de deux cent trente yards, n’atteignit pas le fond. En face d’Oujiji, Livingstone avait trouvé jusqu’à trois cents brasses.
Notre quatrième halte se fit dans l’Ouroundi, sur une île sableuse située à une demi-heure de la frontière. Bien que la Mchala soit considérée par les deux peuples comme séparant les deux provinces, il y a des établissements de Vouaroundi en deçà de la rivière, et des groupes de Vouajiji sur les deltas fertiles du Namousinga, du Kasokoué et du Louaba, qui se trouvent dans l’Ouroun-di.
De Nyabigma, l’île sableuse où nous étions campés, l’oeil embrasse la courbe profonde que décrit la montagne sur une étendue de vingt à vingt-cinq milles entre les promontoires de Kasinga et de Kasofou. Cette arène aux sommets irréguliers, voilés à peu près constamment d’un éther floconneux, et dont les profondes déchirures laissent échapper de nombreux cours d’eau, forme une scène des plus imposantes. À sa base se déploie une large bande alluviale d’une fertilité à défier toute description. Une épaisse ceinture de papyrus et de matétés géants entoure chaque delta, et s’y développe à certaines places sur une assez grande largeur. Au fond de la jungle, parfois impénétrable, sont des étangs paisibles qui servent de retraite à une multitude d’oiseaux, que les fondrières, la fièvre et le halber protègent contre les chasseurs.
Au moment de quitter Nyabigma, nous distribuâmes à chacun de nos hommes dix charges de poudre et autant de balles pour le cas où les Vouaroundi nous montreraient la haine qu’ils ont vouée aux étrangers. Le lendemain, nous fûmes arrêtés à Moukoungou par la demande du tribut. C’était Livingstone qui, depuis le départ, réglait toutes nos affaires. J’avais eu maintes fois, on se le rappelle, à me débattre en pareille circonstance ; j’étais curieux de voir comment le grand voyageur s’acquitterait de cette corvée. Le maté-ko, chef de troisième ordre, réclamait dix mètres de cotonnade. Livingstone répondit à cela en demandant si on ne nous apportait rien.
« Non, fut-il répliqué, le jour est fini, il est trop tard ; ce sera pour votre retour. »
Le docteur se mit à sourire :
« Puisque, dit-il, vous attendez que je revienne pour nous faire un présent, je payerai quand nous repasserons. »
Déconcerté d’abord, le matéko réfléchit un instant, puis réitéra sa demande.
« Apportez-nous un mouton, reprit le docteur, un petit mouton, nos estomacs sont vides, il est tard et nous avons faim depuis la moitié du jour. »
L’appel fut entendu, le vieux chef s’empressa de nous envoyer un agneau, accompagné de douze ou quatorze litres de vin de palme, et reçut en échange ses dix mètres d’étoffe. L’agneau fût tué tout de suite et parfaitement digéré, mais le vin de palme, hélas ! quel funeste présent ! Souzi, l’inestimable adjoint du docteur, et Bombay, le chef de mes hommes, étaient chargés de veiller sur le canot : imbibés de la fatale liqueur, ils dormirent d’un sommeil de plomb et, le lendemain nous avions à déplorer la perte d’une foule de choses, entre autres la ligne de sonde, une ligne de neuf cents brasses, cinq cents cartouches faites pour mes propres armes, et quatre-vingt-dix balles de mousquet. Outre ces objets indispensables dans une contrée hostile, on nous avait enlevé un grand sac de farine et tout le sucre du docteur. L’ignorance et la couardise avaient seules empêché les filous d’emmener le canot, avec tout ce qu’il renfermait, y compris Bombay et Souzi qui auraient été bel et bien vendus.
Repartis néanmoins à l’heure habituelle, nous continuâmes à nous diriger vers le nord, suivant toujours la côte, et entrant dans chaque baie qui nous semblait intéressante. C’était toujours la même scène, la même richesse ; toujours des rivières sortant des ravins ; toujours des palmiers et des bananiers, des villages sous leur ombre et entourés de cultures. De temps à autre, une bande de sable, ou couverte de galets, était convertie en marché où se vendaient du poisson et les produits des localités voisines. Tantôt des fourrés de papyrus et de roseaux, recouvrant les marais qu’ils avaient formés en arrêtant les rivières ; tantôt des montagnes plongeant à pic dans le lac, et se repliant en courbes profondes remplies d’un terrain d’alluvion de huit à dix milles de large.
Un canot se voyait-il à peu de distance, nos hommes se met-taient à chanter, faisaient force de rames, et tâchaient de passer devant. Les autres, piqués au jeu, redoublaient de vitesse et, debout, complètement nus, pagayant avec ardeur, nous offraient l’occasion de faire des études d’anatomie comparative. Plus loin, un groupe de pêcheurs, indolemment couchés sur la grève, regardaient les pirogues qui passaient auprès d’eux. C’était ensuite une flottille de canots, dont les propriétaires reposaient dans leurs cases, ou pêchaient à la ligne, ou préparaient leurs filets. Des enfants s’ébattaient dans l’eau sous les yeux de leurs mères qui, assises à l’ombre, applaudissaient à leurs jeux pleins de hardiesse ; d’où je suppose que les crocodiles ne sont communs dans le lac qu’à l’embouchure des rivières d’une certaine importance.
Entre le cap de Mouremboué et celui de Kisounvoué est une réunion de villages, qu’on appelle Bikan, et dont le chef réclame un tribut des bandes qui traversent son territoire.
Depuis que la disparition de mes cartouches ne nous permettait plus d’affronter une lutte sérieuse, nous évitions avec soin tous les endroits qui étaient mal famés chez les Vouajiji. Nos guides, cette fois, n’avaient pas eu le temps d’exprimer leur opinion lorsque les gens de Bikari nous hélèrent du rivage en nous menaçant de la vengeance de leur chef si nous passions sans nous arrêter. Comme leurs voix n’étaient rien moins que séduisantes, nous refusâmes d’obéir. Ils se mirent alors à nous jeter des pierres avec fureur. Un de leurs cailloux m’ayant presque touché, il me sembla qu’une balle pourrait leur être envoyée, au moins comme avertissement ; mais bien qu’il gardât le silence, le docteur ne parut pas approuver cette mesure, et nous filâmes sans répondre.
Nous atteignîmes rapidement le delta du Mouremboué dont la jungle épineuse et touffue, recélant un marécage, devait nous protéger contre les indigènes. Un coin sableux nous permit d’aborder ; on y traîna le canot et Férajji, sinon très capable, du moins toujours prêt, nous servit bientôt d’excellents cafés. Malgré le danger qui nous menaçait encore, nous éprouvions un bien-être réel. Sous l’influence du moka et d’une douce philosophie, nous nous sentions émus de pitié pour les aveugles qui nous provoquaient. Le docteur avait souvent rencontré de pareilles dispositions ; il les attribuait à la conduite insensée, non moins que criminelle, des traitants ; sur quoi je suis entièrement de son avis.
Nous avions quitté notre petite grève et, bien que le soleil fut couché, nos hommes continuaient à ramer avec courage. Il était près de huit heures lorsque nous nous arrêtâmes en un lieu désert, sur une langue de sable, adossée à une berge de dix à douze pieds de haut, flanquée des deux côtés de masses rocheuses en désagrégation.
Chacun gardait le silence, et tout nous faisait croire que nous resterions inaperçus.
À notre feu l’eau chauffait pour le thé, à celui de nos hommes pour la bouillie, quand les vedettes nous signalèrent des formes sombres qui rampaient vers le bivouac. Ces formes rampantes se dressèrent à notre appel et vinrent à nous en proférant le salut indigène vouaké. Ayant expliqué à ces gens qui nous étions, nous ajoutâmes que s’ils avaient quelque chose à nous céder, nous l’achèterions avec plaisir. Ils parurent très satisfaits de cette demande et, après un instant d’entretien pendant lequel ils nous semblèrent prendre des notes mentales sur le camp, ils s’éloignèrent en promettant de revenir et d’apporter des vivres. Un second parti arriva bientôt, ce fut le même salut, la même manière d’observer, les mêmes protestations d’une amitié que j’estimai trop vive pour être sincère.
Peu d’instants après, troisième visite, et des protestations de plus en plus chaleureuses ; en même temps, je vis deux canots croiser devant le bivouac, d’une allure plus rapide que la marche habituelle. Notre présence, évidemment, était connue des villages voisins, dont ces divers partis étaient les messagers. Or, depuis Zanzibar jusqu’au lac, jamais, sous aucun prétexte, on ne vient saluer personne après la chute du jour ; quiconque serait surpris à la nuit close rôdant aux environs du camp recevrait un coup de fusil.
Tandis que nous échangions nos remarques à ce sujet, une quatrième bande, plus bruyante que les autres, vint nous exprimer la joie qu’elle avait de nous voir, et dans les termes les plus extravagants.
Notre souper venait de finir. Dès que la bande joyeuse fut partie, nous sautâmes dans le canot qui fut promptement repoussé du rivage. Comme nous sortions de la pénombre projetée par la côte, je fis remarquer au docteur des formes accroupies derrière les rochers qui se trouvaient à notre droite ; d’autres corps gagnaient en rampant le sommet de ces roches, tandis qu’une bande nombreuse s’avançait à gauche avec précaution. Au même instant, une voix nous héla du haut de la berge, juste au-dessus de la place que nous venions de quitter. « Bien joué ! » cria le docteur, et la pirogue fila vivement, laissant derrière elle les voleurs déconfits.
Après six heures de nage, qui nous firent doubler le cap Sentakéyi, nous nous arrêtâmes à Mougéyo, petite bourgade de pêcheurs où il nous fut permis de nous reposer un instant. Au point du jour, nous étions en route, et à huit heures nous arrivions à Magala, dont le moutouaré passait pour un homme généreux. Nous avions eu, depuis notre dernier camp, dix-huit heures de marche, ce qui, à raison de deux milles et demi par heure, faisait quarantecinq milles. Du cap Magala, un des promontoires les plus saillants de la côte, on a la grande île de Mouzimou, l’Ouhouari de Burton, au sud-sud-ouest, et l’on voit se rapprocher rapidement les deux rives du lac qui paraissent se rejoindre à une distance d’environ trente milles. Le Tanganyika n...