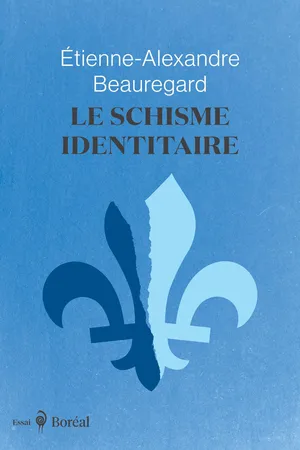CHAPITRE 1
Un nationalisme normal
Peu de périodes de l’histoire québécoise peuvent démontrer la puissance d’une idéologie hégémonique aussi bien que la Révolution tranquille et ses suites. Entre 1960 et 1995, le Québec a effectivement été dominé par une idéologie néonationaliste à ce point prépondérante que tous les partis de gouvernement ont été contraints de s’y soumettre pour demeurer politiquement acceptables. Fortement influencé par des historiens comme Lionel Groulx et Maurice Séguin, ce discours présentait le Québec comme une nation dont le destin consistait à cheminer vers la souveraineté pour accéder au statut de pays « normal ». Dans les faits, bien que ce récit n’ait pas permis au Québec de conquérir son indépendance, force est de constater que sa puissance s’est manifestée dans sa capacité à forcer ses adversaires naturels, les fédéralistes québécois, à accepter le débat constitutionnel comme un élément central du jeu politique tout en adoptant une philosophie du « Québec d’abord » au risque de s’aliéner le gouvernement canadien. L’hégémonie néonationaliste a donc exercé une influence profonde et durable sur le Québec durant plus de trois décennies tout en réaménageant profondément sa conception de lui-même et de son histoire.
La victoire de Groulx sur Bourassa
Bien qu’elle soit largement méconnue du grand public, la première fondation intellectuelle de la Révolution tranquille est survenue lors de la victoire idéologique de Lionel Groulx sur Henri Bourassa au sein du nationalisme québécois. Ces deux grandes figures du début du xxe siècle appartenaient au mouvement nationaliste, bien qu’une querelle irréductible les ait toujours opposées : l’espace dans lequel il fallait articuler le nationalisme du peuple canadien-français, pas encore devenu proprement québécois.
Perpétuellement en lutte contre le nationalisme canadien-anglais, qui repose alors sur l’Empire britannique, Henri Bourassa défend vigoureusement un nationalisme pancanadien foncièrement opposé à une vision impériale qui divise naturellement les Canadiens entre francophones et anglophones. Dans le contexte de la seconde guerre des Boers (1899-1902), il prend position contre toute intervention canadienne, opposant son « Canada d’abord » à « l’Empire d’abord » de ses adversaires anglo-saxons, et milite pour la « création d’un véritable patriotisme canadien, conscient, éclairé, aussi éloigné du jingoïsme que du séparatisme ». Si la majorité de ses interventions au Parlement canadien l’amènent à affronter d’abord le nationalisme canadien-anglais, il n’en est pas plus tendre avec son équivalent canadien-français, lui qui refusera toujours de voir le Québec comme une patrie du même ordre que le Canada. Au contraire, il se consacre à l’édification d’un véritable nationalisme from coast to coast qui laisserait de côté les questions linguistiques et culturelles héritées de l’Ancien Monde au profit d’une appartenance commune au Canada. C’est pourquoi il sera toujours insensible à l’idée de faire du Québec un État national, appelant « à mettre la grande patrie au-dessus de la petite ». Même l’idée d’un statut particulier ne trouve pas grâce à ses yeux, lui qui soutient que « ce régime est même bienfaisant et fécond, pourvu que chaque province, tout en conservant sa vie propre, collabore loyalement à l’œuvre commune et que l’équilibre de l’ensemble ne soit pas rompu par la prépondérance exagérée de l’un des membres de l’association nationale ». Ainsi, lorsque surgit l’idée d’indépendance, au début du xxe siècle, Bourassa la tourne en ridicule, prétendant qu’un Québec souverain n’aurait pas plus d’influence sur l’Amérique du Nord que Monaco n’en a sur la France, appelant du même souffle ses compatriotes à « [ne pas donner] à Rome l’impression que nous sommes plus passionnés pour notre langue que pour notre foi ». En ce sens, on trouve chez Bourassa une certaine parenté intellectuelle avec Pierre Elliott Trudeau, dont l’œuvre sera principalement guidée par cet idéal consistant à faire en sorte que les francophones et les anglophones du Canada s’identifient d’abord à Ottawa.
La bougie d’allumage de la Révolution tranquille se trouve chez Lionel Groulx qui, à l’inverse de Bourassa, voit le Québec comme le cadre nécessaire pour penser le nationalisme canadien-français. Dans l’enquête « Notre avenir politique », produite en 1922 par L’Action française, dont le chanoine est directeur, on explicite déjà ce programme qui se trouvera plus tard au cœur de la Révolution tranquille : « un travail immédiat de “souveraineté intérieure” qui demande d’accorder une nouvelle importance à l’État provincial et de le considérer comme l’État national ». Prônant également une intervention plus musclée de l’État québécois dans l’économie, Groulx envisage la souveraineté comme un horizon pour la nation, avançant que, « [quelle] que soit la prochaine transformation politique, elle ne sera que transitoire si elle ne permet pas au Québec de prendre place dans le monde international en qualité d’État souverain français d’Amérique ». En 1936, dans Directives, il postule que cet État français qu’il appelle de ses vœux naîtra « de l’action positive de la politique québécoise ». Contrairement à Bourassa, Groulx souhaite que les Canadiens français rejettent leur statut minoritaire pour ancrer leur nationalisme dans un État sur lequel ils auraient le plein contrôle : l’État québécois. Cette révolution mentale qu’on doit à la pensée du chanoine sera la prémisse du changement le plus fondamental qui marquera la nation durant la Révolution tranquille : le passage de Canadiens français à Québécois.
De Canadiens français à Québécois
« Nous sommes des Québécois. » Ce sont les premiers mots d’Option Québec, de René Lévesque, dont la signification est transformatrice pour la nation à ce moment de son histoire. Au cœur de ce changement de nom, on trouve d’abord le rejet de la condition minoritaire qui était le lot du Canadien français, lequel se définissait avant tout dans l’espace canadien. Jean Bouthillette, dans Le Canadien français et son double, traite de l’ombre qui plane en permanence sur le Canadien français, incapable d’exister sans l’Autre puisqu’il se conçoit par la négative face au Canadien anglais majoritaire, et accueille comme une véritable libération le vocable « Québécois » pour redéfinir la nation :
[…] dans l’intuition d’un nom – puisque tout a commencé dans un nom – nous nous réapproprions notre véritable identité ; un nom qui lève toute ambiguïté et qui nous reconstitue concrètement dans notre souveraineté intérieure et nous réconcilie avec nous-mêmes : Québécois. […] Nous sommes, dans ce pays, un peuple face à un autre peuple ou nous ne sommes pas.
C’est donc en se concevant d’abord comme des Québécois qu’on pourra s’approprier l’État comme un peuple majoritaire et ainsi en faire l’instrument de notre émancipation collective. Cette transformation identitaire causera le divorce avec la diaspora canadienne-française, ce qui s’accomplit aux États généraux du Canada français en 1967 lorsque les velléités indépendantistes des Québécois s’opposent aux vues de la majorité des francophones hors Québec présents aux États généraux. Affranchis des liens de solidarité qui les liaient jadis aux francophones hors Québec comme membres d’une même nation canadienne-française, les Québécois concentrent leurs énergies sur l’État du Québec, dès lors investi du rôle d’État-nation francophone.
Parallèlement à la construction du référent national québécois se produit une démonisation sans pareille du Canada français, devenu le repoussoir symbolique du Québec refondé de la Révolution tranquille. Afin d’accentuer la rupture, le Canada français se voit caricaturé comme une société attardée et prémoderne, « habité[e] d’une mentalité passablement obscurantiste – [une] mentalité d’Ancien Régime », dans les mots du politologue Louis Balthazar. Cet état d’esprit arriéré serait à l’origine d’un retard économique par rapport au reste du Canada, que la Révolution tranquille aura pour mission de combler, alors que des voix de partout dénoncent l’état d’un peuple économiquement sous tutelle.
L’Église en vient à porter largement le blâme et on fait état d’une « trahison des clercs » issue de la propension du clergé à collaborer avec les autorités anglaises pour maintenir son pouvoir ins...