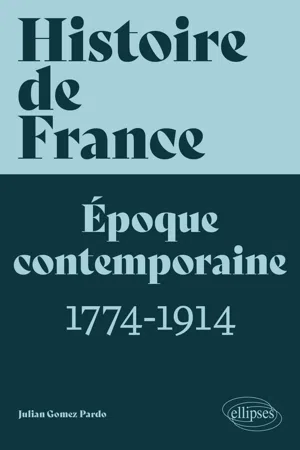
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Cette histoire de France en quatre volumes fait la part belle à l'histoire évènementielle, à ses héros, ses légendes, ses lieux et monuments. Elle met également en valeur les grandes évolutions sociales, économiques et culturelles de chaque époque.
- la plus récente synthèse d'un récit chronologique, d'après les recherches des plus grands historiens.
- des biographies des principaux personnages
- le point sur les évènements les plus marquants de l'histoire nationale et sur les principaux monuments de la mémoire nationale
- une présentation des grands débats historiographiques contemporains
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Histoire de France, volume 3 par Gomez Pardo Julian en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Histoire de l'Europe. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre 1
La France de la Révolution (1774-1799)
“Vous connaissez mon enthousiasme pour la Révolution. Eh bien ! J’en ai honte. Elle est ternie par des scélérats, elle est devenue hideuse.”
Manon Roland (1754-1792), Lettre à un ami, 5 septembre 1792.
Le règne interrompu de Louis XVI (1774-1789)

Selon la formule de Mirabeau, la France en 1774 est « un agrégat inconstitué de peuples désunis ». La France de Louis XVI compte toujours 40 000 paroisses environ réparties dans 139 diocèses. La langue française, langue des élites cultivées et de la diplomatie en Europe, n’est parlée, selon l’abbé Grégoire (1750-1831) qui écrit vingt ans plus tard, que par moins de 80 % des 28 millions de Français et le bilinguisme est encore très développé dans beaucoup de provinces. La monarchie a imposé la langue française pour les actes publics en 1685 en Alsace, en 1700 au Roussillon, en 1748 à la Lorraine, en 1768 à la Corse. En Roussillon, le Français s’impose dans l’état-civil en 1735 mais il n’est toujours pas la langue de la majorité de la population en 1789, d’ailleurs le catalan reste la langue utilisée par les prédicateurs et la catéchèse. Si le français est loin d’être une réalité dans les classes populaires, il s’est imposé comme langue naturelle des élites par sa diffusion dans les collèges des jésuites. Au moment de leur expulsion en 1764, les collèges de la Compagnie ont largement participé à l’unification linguistique des élites culturelles. D’après la signature des actes de mariage, l’alphabétisation a progressé. À la fin du XVIIe siècle, 80 % des Français sont encore analphabètes, 86 % des épouses le sont contre 71 % des époux. Mais à Paris ce taux n’est plus que de 25 %. En 1789, le taux d’analphabétisme a reculé à 63 %, avec un taux plus élevé au sud qu’au nord d’une ligne Saint-Malo-Genève1.
85 % de la population française est encore rurale et pour les deux tiers paysanne. Selon Moheau en 1778, une ville est une agglomération comptant au moins 2 500 habitants. Si on retient le seuil des 2 000 habitants, 20 % de la société française est urbaine. Quinze villes dépassent le seuil des 35 00 habitants2. Paris compte 600 000 habitants, Lyon 150 000, Marseille et Bordeaux 85 000, Rouen 75 000, Lille 70 000, Nantes 60 000. Seulement 4 % de la population vit dans des villes de plus de 50 000 habitants. 95 % de la paysannerie est libre de sa personne. La catégorie des « serfs » et mainmortables, vestige de la période médiévale, peut-être un million de personnes, est très minoritaire sans être marginale, surtout dans certaines régions du centre et de l’est de la France. La France seigneuriale est loin d’avoir disparu même si le prélèvement seigneurial reste très contrasté d’une région à l’autre, plus lourd au nord qu’au sud où il ne représente que 3 à 4 % du produit brut. Approximativement, la propriété de la terre appartient pour au moins 20 % à la noblesse, 10 % au clergé, 30 % à la bourgeoisie et 40 % à la paysannerie. Derrière, cette estimation se cache d’importantes disparités territoriales. Dans le Nord, dans certaines régions, le clergé possède 20 à 40 % de la terre alors que la propriété ecclésiastique est beaucoup plus faible dans l’Ouest, de l’ordre de 1 à 4 %. Le revenu annuel du clergé est estimé entre 90 à 100 millions de livres à quoi il faut ajouter 80 millions de dîmes prélevées sur les exploitations paysannes. De même, la propriété nobilière est forte de 30 à 40 % dans la région parisienne ou en Bourgogne, mais moins de 20 % dans le Sud. Plus on s’éloigne de la ville, plus la propriété nobiliaire s’affaisse.
En ce qui concerne le droit, l’uniformisation est loin d’être une réalité. La variété du droit civil reste la norme, marquée par la vieille opposition entre le nord de tradition coutumière et le sud de droit écrit. Les régimes du droit des successions sont ainsi d’une variété infinie entre des règles de partage égalitaire ou qui accordent à un des enfants un avantage au détriment des autres. En termes de fiscalité, la variété régionale des impôts est de règle. Dans les pays d’élection, sans autonomie fiscale, la fiscalité directe est prélevée dans le cadre des vingt généralités. À ces derniers s’ajoutent les pays d’États (Languedoc, Bretagne, Bourgogne, Dauphiné, Provence) pour lesquels des assemblées régulières « consentent » à l’impôt. Ces États défendent le droit provincial de manière plus ou moins vigoureuse3. Enfin, les pays d’imposition (Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Artois, Roussillon, Corse) sont directement sous l’administration des intendants. L’inégalité entre pays d’élections plus sensiblement imposés que les pays d’État persiste. L’inégalité est également de mise pour la fiscalité indirecte. Par exemple, pour la gabelle, qui est l’impôt sur le sel, il existe six régimes différents avec les pays de grande gabelle correspondant aux régions du Bassin parisien et à la Bourgogne, fortement taxées et à l’autre bout du spectre des régions totalement exemptées comme la Bretagne. Au cœur de cette diversité, on trouve la notion de privilèges, qui donne à une région, un ordre (noblesse, clergé), une ville, une profession ou un particulier, un régime juridique particulier qui déroge au droit général. Là est tout l’Ancien Régime.
La France de Louis XVI est encore une mosaïque où mêmes les poids et les mesures varient d’une province à l’autre, le setier, le boisseau ou le muid, unité de capacité n’ont pas la même valeur partout. C’est aussi un enchevêtrement de circonscriptions peu homogènes dans le domaine administratif, judiciaire et financier où chaque institution peut avoir une compétence. Parlements et intendants disposent d’importants pouvoirs de police mal définis, ce qui soulève inévitablement des conflits de compétences. La France est divisée en quarante gouvernements qui correspondent souvent aux anciennes divisions féodales dont huit sont réduits à des places fortes. Leur gouverneur ne réside plus sur place et un lieutenant général fait office de représentant du roi pour les questions essentiellement militaires. L’intendant dans les trente-quatre généralités, commissaire du roi et révocable, s’est imposé comme le rouage du pouvoir de la monarchie administrative du XVIIIe siècle. Avec quelques subdélégués, il administre la généralité dans le domaine de la police au sens où l’entend l’Ancien Régime, c’est-à-dire au sens de l’administration le plus large : application des lois, maintien de l’ordre, questions religieuses, industrie et commerce, travaux publics, communications.
Sur le plan financier, la situation budgétaire s’est dégradée depuis 17514. Cette année-là, les recettes s’élèvent à 256 millions de livres et les dépenses à 258 millions. Le service de la dette est de l’ordre 100 millions de livres. Après la guerre de Sept Ans (1756-1763), qui a coûté un milliard de livres, les finances royales reviennent difficilement à la situation d’avant la guerre. Les dépenses s’élèvent à plus de 410 millions de livres, les recettes à 350 millions, le déficit est proche de 60 millions de livres en 1769 et le service de la dette à 150 millions. La politique de Terray a réduit ce déficit à 27 millions en 1774. La situation financière est difficile mais pas encore catastrophique lorsque Louis XVI monte sur le trône. Sa jeunesse suscite beaucoup d’espoirs après le très long règne de son grand-père, mort le 10 mai 1774.

Né le 23 août 1754, Louis XVI n’a pas encore vingt ans quand son grand-père décède5. Sa jeunesse a été marquée par le décès de son frère aîné en 1761. Ses parents accablés par le chagrin semblent l’avoir délaissé pour s’occuper des deux cadets qu’ils trouvent plus brillants6. Après la mort de ses parents, son père en 1765 et sa mère en 1767, toute la cour s’accorde pour le trouver bien terne en comparaison de ses frères. Formé par le duc de La Vauguyon (1706-1772) qui ne néglige aucune matière sauf peut-être l’éducation militaire, le jeune prince chez qui on remarque une faiblesse de caractère, reçoit une formation politique théorique où les figures des rois qui ont été reconnus par leur autorité sont montrées en exemples. Le jeune Louis XVI écrit dans ses Entretiens avec Monsieur le duc de La Vauguyon « qu’un prince faible sera toute sa vie le jouet ou la victime de ses ministres, de ses domestiques, de ses amis ; indigne d’amour et de haine, il sera la honte du trône, le fléau de son peuple et le mépris de sa postérité ». Son gouverneur le met en g...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Page de copyright
- Introduction
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- La France napoléonienne (1799-1815)
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Table des matières