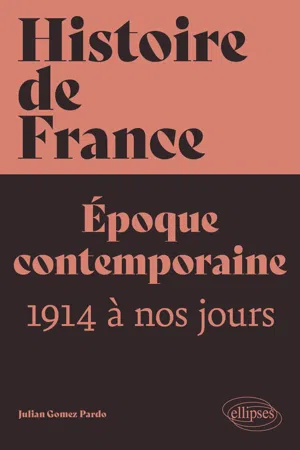
eBook - ePub
Histoire de France, volume 4
Époque contemporaine, tome 2 (1914 à nos jours)
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Cette histoire de France en quatre volumes fait la part belle à l'histoire évènementielle, à ses héros, ses légendes, ses lieux et monuments. Elle met également en valeur les grandes évolutions sociales, économiques et culturelles de chaque époque.
- la plus récente synthèse d'un récit chronologique, d'après les recherches des plus grands historiens.
- des biographies des principaux personnages
- le point sur les évènements les plus marquants de l'histoire nationale et sur les principaux monuments de la mémoire nationale
- une présentation des grands débats historiographiques contemporains
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Histoire de France, volume 4 par Gomez Pardo Julian en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Histoire de l'Europe. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre 1
De la Grande Guerre à la crise des années trente (1914-1938)
“Nous pouvons dire qu’avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance de ses armes, et quand nos vivants, de retour sur nos boulevards, passeront devant nous, en marche vers l’Arc de Triomphe, nous les acclamerons. Qu’ils soient salués d’avance pour la grande œuvre de reconstruction sociale. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, sera toujours le soldat de l’idéal.”
Georges Clémenceau, Discours 11 novembre 1918.
La France dans la Première Guerre mondiale (1914-1918)

Samedi 1er août 1914, le chancelier allemand Bethmann-Hollweg, alarmé par la mobilisation russe qui répond elle-même à la mobilisation austro-hongroise du jour précédent et à la déclaration de guerre à la Serbie du 28 juillet 1914, déclare la guerre à la Russie de Nicolas II1. En France, à 14 h 35, puis de nouveau à 21 h, le ministre de l’Intérieur Louis Malvy (1875-1949) télégraphie aux préfets l’ordre de ne pas appliquer le carnet B qui recommande d’arrêter d’urgence les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires qui pourraient s’opposer à l’ordre de mobilisation, et cela malgré les recommandations de Clémenceau2. Sans doute bien informé depuis l’assassinat de Jaurès que les milieux socialistes se rangeraient finalement à défendre la nation, le ministre signe également la suspension des mesures visant les congrégations en signe d’apaisement3. L’audace du ministre n’est pas contredite par les faits puisqu’en fin de journée l’ordre de mobilisation générale est diffusé et qu’aucun trouble ne se produit. Des affiches qui vont être placardées partout portent le décret du président de la République Raymond Poincaré (1860-1934) qui annonce que « le premier jour de mobilisation générale est le dimanche 2 août » « Tout Français soumis aux obligations militaires doit sous peine d’être puni avec la rigueur des lois obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation » de son livret militaire. Tous les hommes nés entre 1869 et 1894, soit 3,58 millions d’hommes doivent rejoindre leur caserne d’affectation. Ce samedi 1er août en fin d’après-midi, tous les clochers de France font entendre un lugubre tocsin.
À l’exception de quelques manifestations d’enthousiasme, le sentiment moyen est plutôt celui de la consternation et de la résignation à faire son devoir envers la nation4. Pour la majorité des Français le sentiment qui prédomine est celui d’être l’agressé et de mener une guerre de défense comme l’indique le témoignage du jeune historien Marc Bloch (1886-1944) qui décrit bien l’atmosphère de l’époque5. Même l’antimilitariste forcené Gustave Hervé (1871-1944) qui dirige le journal La Guerre sociale s’écrit « Ils ont assassiné Jaurès, nous n’assassinerons pas la France6 ! », avant de se rallier à la guerre le 6 août au nom de la défense « de la démocratie française et de ses alliés contre la caste féodale militaire d’Allemagne 7 ». Avant-guerre, l’état-major a estimé à 13 % le taux de l’insoumission à la mobilisation générale, le chiffre n’est finalement que de 1,5 %8.
Malgré tout pour prévenir toute difficulté, le 2 août 1914, Raymond Poincaré signe le décret de l’état de siège qui donne aux autorités militaires la responsabilité du maintien de l’ordre et de prendre toute mesure d’exception qui s’impose. Ce même jour l’armée allemande envahit le Luxembourg et lance un ultimatum à la Belgique pour l’autoriser à entrer sur son territoire. Après le refus belge, l’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août avant d’entrer en territoire belge. La journée du 4 août deux voix attendues se font entendre. D’abord celle du président de la République qui fait lire à la Chambre des députés un message dans un silence religieux : « Dans la guerre qui s’engage, la France aura pour elle le droit dont les peuples, non plus que les individus, ne sauraient impunément méconnaître l’éternelle puissance morale. Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils dont rien ne brisera devant l’ennemi l’union sacrée et qui sont aujourd’hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l’agresseur et dans une même foi patriotique. » « Union sacrée », la formule connaît un immense succès dans les journaux les jours suivants9. L’autre voix est celle de Léon Jouhaux (1879-1954), le chef de la CGT qui a annoncé encore en juillet que le monde ouvrier s’opposerait par la grève générale à la guerre. Mais lors des funérailles de Jaurès ce 4 août, il prononce un discours improvisé qui annonce son ralliement à la guerre « Avant d’aller vers le grand massacre, au nom des travailleurs qui sont partis, au nom de ceux qui vont partir, dont je suis, je crie devant ce cercueil toute notre haine de l’impérialisme et du militarisme sauvage qui déchaînent l’horrible crime. » Pour Jouhaux, les solidarités nationales passent avant l’internationalisme prolétarien.
Le président du Conseil René Viviani (1863-1925), qui pense comme tout le monde le croit à l’époque que la guerre ne va durer que quelques semaines, abandonne son portefeuille des Affaires étrangères à Gaston Doumergue (1863-1937). Pour la première fois de la IIIe République, le chef du gouvernement ne cumule pas sa fonction avec un portefeuille ministériel10. Il fait voter une loi le 4 août instaurant la censure et invite les journalistes à ce qu’aucune information sur la guerre ne soit publiée. Dans la réalité, la censure frappe toutes les informations diplomatiques et politiques et pas seulement celles d’ordre militaire11. Le 6 août, pendant que les hommes rejoignent leur régiment, Viviani lance un appel « Aux femmes françaises » « Je vous demande de maintenir l’activité des campagnes, de terminer les récoltes de l’année, de préparer celle de l’année prochaine : vous ne pourrez rendre à la patrie un plus grand service. » Tout est prêt pour faire face au conflit, une guerre de quelques semaines pense-t-on, car de part et d’autre tous les plans militaires confectionnés depuis plusieurs années n’ont envisagé qu’un scénario de guerre courte. Celui des Allemands, le plan « Schlieffen » est conçu pour mettre hors de combat les armées françaises en l’espace de quelques semaines avant de retourner l’effort contre la Russie12. Il prévoit dans un mouvement tournant d’envahir presque toute la Belgique et d’attaquer la France par le nord13. Le « plan XVII » français prévoit pour sa part trois offensives, l’une sur le plateau lorrain, une deuxième au Luxembourg et Thionville, une troisième en Alsace14. Joseph Joffre (1852-1931)15, généralissime, croit dur comme fer, qu’il peut couper l’armée allemande en deux en perçant le front au centre. Les offensives françaises vont se révéler des échecs cuisants et meurtriers. L’artillerie allemande fait des ravages. La bataille de Charleroi du 21 au 23 août est terrible et fait 40 000 morts16. Le ton est donné. Pour la seule journée du 22 août, 27 000 Français sont tués, le jour le plus meurtrier de toute l’histoire militaire française17. La bataille des frontières est perdue le 2418, il faut donner l’ordre de retraite et se replier sur une nouvelle ligne défensive car le plan allemand, lui, a parfaitement été exécuté par le général Moltke (1848-1916) ; l’armée allemande a envahi la Belgique entre le 6 et le 16 août, Bruxelles est tombé le 20 et elle progresse de 30 à 50 km par jour. Même si l’invasion de la Belgique a déclenché la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l’Allemagne le 4 août, la situation paraît très critique. Du 24 août au 5 septembre, les armées françaises se replient à marche forcée.
À Paris, on craint de revivre 1870. Viviani, sous pression de Poincaré, choisit de remanier le gouvernement en urgence le 26 août. Delcassé revient aux Affaires étrangères, Millerand proche de l’état-major prend la Guerre, Ribot aux Finances et Briand à la Justice. Les socialistes acceptent d’entrer au gouvernement confirmant la ligne de « l’Union sacrée ». Jules Guesde (1845-1922), le vieux révolutionnaire de la SFIO, entre au gouvernement...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Page de copyright
- Introduction
- Chapitre 1. De la Grande Guerre à la crise des années trente (1914-1938)
- Chapitre 2. La France face à la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
- Chapitre 3. La France de la IVe République (1946-1958)
- Chapitre 4. La France du début de la Ve République (1958-1981)
- Chapitre 5. La France depuis 1981
- Table des matières