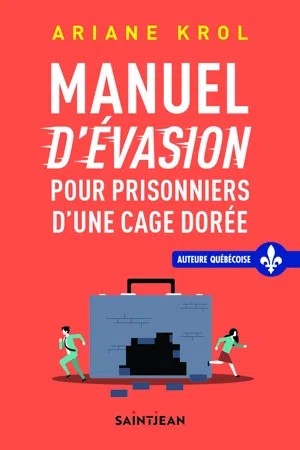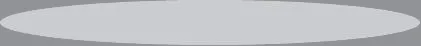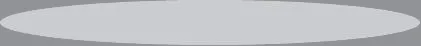![]()
1
Bienvenue dans les montagnes russes
Il est 3 heures du matin, et François Barrière pleure, roulé en boule dans la douche. Il se demande ce qu’il fait là. Pas dans la douche. Dans sa nouvelle vie.
Un an et demi plus tôt, François était premier vice-président et trésorier de l’une des six grandes banques canadiennes, avec une rémunération à l’avenant. Mais après presque 25 ans passés dans la finance, il a tout quitté pour réaliser le projet qui lui faisait envie depuis tant d’années : établir la meilleure boulangerie de Montréal.
Son commerce a ouvert ses portes ce matin-là… six mois après la date prévue. Les travaux de construction ont accumulé les retards. Les boulangers qu’il a fait venir de France, eux, sont arrivés comme convenu. Il les paie depuis des mois, sans avoir encore vendu une seule baguette.
« On va commencer lentement. Si on fait 2000 $ par jour, je serai content », s’était dit François.
En cette journée inaugurale du printemps 2019, sa boulangerie a enregistré 1980 $ de ventes. « Normalement, j’aurais dû être satisfait. Sauf que pour arriver à faire 1980 $ cette journée-là, il y a eu tellement de problèmes ! »
Les vitres donnant sur l’aire de production ont été cassées au moment de la pose, deux jours avant l’ouverture, et les plastiques installés en attendant ne sont pas étanches. La farine flotte dans l’air, et la pâte des pains croûte avant même d’être enfournée. « C’était infernal, j’avais 25 affaires à corriger. Là, j’ai eu peur. Je me suis dit : “Dans quoi tu t’es embarqué ?” »
Dix mois plus tard, la boulangerie Le Toledo remporte le prix de la meilleure baguette de Montréal, et plutôt deux fois qu’une : le prix du jury, ainsi que le prix du public. Et peu de temps après, l’entreprise décroche le prix Commerce de l’année de l’avenue du Mont-Royal, assorti d’une bourse.
À la fin de cet hiver-là, François Barrière a toutes les raisons de célébrer. Doublement, car sa conjointe, qui travaille encore dans la finance, a décidé de prendre un congé sabbatique, qui commence le soir du premier anniversaire de son commerce.
Ce vendredi-là, l’esprit est à la fête, autant à la boulangerie qu’à la maison, où un « méga party » est prévu.
Ce vendredi-là est le 13 mars 2020. À Montréal, la mairesse Valérie Plante annonce la fermeture de toutes les installations publiques. À Québec, le gouvernement Legault déclenche l’état d’urgence sanitaire.
« On a dégonflé les ballons, rangé les bouteilles de champagne, annulé le party et les billets d’avion, et on a regardé le train arriver en se demandant ce qui allait se passer. »
Bienvenue dans les montagnes russes des rêves qu’on se décide enfin à réaliser.
« Quand j’étais en finance, j’ai peut-être déjà pensé que j’étais un peu stressé, mais aujourd’hui, je suis capable de dire que ça n’a rien à voir. Ce n’était même pas 1 % de ce que j’ai vécu durant ma première année à la boulangerie ! »
François avait une belle carrière dans la finance, mais il trouvait le milieu terriblement ennuyeux. « Il n’y a rien qui ressemble plus à une banque qu’une autre banque. C’est l’endroit le moins créatif de toutes les industries. Avec le temps, ça devenait lourd de vivre là-dedans. C’était fatigant. »
Ce n’était pas qu’une impression. Lorsqu’il se portait candidat à d’autres postes, les tests psychométriques faisaient ressortir les mêmes traits, raconte-t-il. Esprit trop créatif, pas assez corporatif, absolument pas le profil recherché dans le domaine bancaire.
François avait d’autres aspirations, mais comme la plupart des gens arrivés à un niveau enviable dans leur carrière, il avait aussi des obligations. « Quand tu as 25 ans, ce n’est pas très grave. Tu peux te lancer à fond et tout perdre, parce que tu n’as pas grand-chose. Mais à 50 ans, c’est autre chose, donc planifie bien. »
Homme de chiffres, il a longuement préparé sa sortie.
Durant près de cinq ans, il a visité 143 boulangeries à Montréal, pris des notes, analysé des données. Lorsqu’il a finalement décidé de se lancer, il s’est associé à un Français d’expérience, qu’il considère comme un « génie » de la boulangerie, et il a préparé un plan d’affaires béton. En bon banquier, il avait prévu qu’une récession risquait de survenir au cours des cinq années qui suivraient l’ouverture, et avait démontré que même si cette récession lui faisait perdre 20 à 30 % de son chiffre d’affaires, son modèle tiendrait le coup.
Il a tout prévu, sauf une pandémie mondiale d’une ampleur jamais vue en plus d’un siècle, qui allait suspendre la marche du monde pour une durée indéterminée.
Après une semaine à se sentir comme un chevreuil saisi par la lumière des phares d’une automobile, François Barrière a eu un déclic. Le financier qui voyait clair dans les crises financières a repris le dessus.
Sa boulangerie, avec son permis d’épicerie, avait le droit de rester ouverte. Son personnel voulait travailler. Sa conjointe s’est proposée pour monter un site Web, avec l’aide d’employés qui avaient des compétences dans le domaine. « Au bout de même pas deux semaines, le site était monté, et pouf ! ç’a décollé ! »
La demande était au rendez-vous, et pas seulement pour ce qui sortait de ses fours. « La farine, la levure, ç’a explosé, tout le monde voulait faire son pain », se rappelle le propriétaire du Toledo.
Certes, son salaire est moins élevé qu’avant. « Mais à un moment donné, il y a des dépenses qu’on fait quand on travaille et qu’on n’est pas heureux, dit-il en évoquant les couteaux à 600 $, les bouteilles de vin à 100 $ et la collection de cravates de son ancienne vie. Tu vis avec moins, et t’es quand même bien. Donc tu es capable de prendre un risque temporairement, durant un ou deux ans », fait-il valoir.
Sans compter les témoignages des clients reçus durant le confinement. « Des gens disaient : “S’il te plaît, ne ferme pas, parce qu’aller chercher ma baguette, c’est mon seul bonheur de la journée” », relate François.
Non, ça n’a pas de prix. Mais ce n’est pas obligé d’être à perte non plus.
En décembre 2020, le chiffre d’affaires de la boulangerie avait bondi de 60 % par rapport au mois de décembre précédent, soit deux fois plus qu’anticipé avant la pandémie.
Et quand j’ai rencontré l’entrepreneur, en novembre 2021, il s’apprêtait à ouvrir un deuxième Toledo, deux fois plus grand, sur la rue Wellington, dans Verdun. Un espace épuré, avec une vaste zone de production équipée à la fine pointe, qui allait lui permettre de répondre à la demande de restaurants et d’autres clients commerciaux. Son entreprise, partie de zéro moins de trois ans auparavant, valait maintenant au moins autant que ce qu’il aurait touché en salaire s’il était resté à la banque.
Et sa conjointe, celle qui était venue le sortir de la douche à 3 heures du matin, la nuit suivant l’ouverture de la première boulangerie ? Après avoir travaillé quelques mois au Toledo, elle y a tellement pris goût qu’elle a quitté sa carrière en finance elle aussi pour s’associer dans l’entreprise.
Quitter le confort d’une carrière pour faire complètement autre chose ?
Pour plusieurs, c’est un rêve récurrent. Encore plus depuis le 13 mars 2020.
![]()
2
Quand votre zone de confort devient de plus en plus inconfortable
Accepter
Oui, la perspective d’abandonner une bonne situation pour se lancer à la poursuite d’un rêve ou d’une aspiration profonde, ça fiche un peu le vertige… Mais lorsque le statu quo devient intolérable, il faut accepter de regarder la réalité en face, et admettre que ça ne pourra pas continuer indéfiniment ainsi.
« Je le savais qu’il y avait anguille sous roche, parce que je me levais et j’étais comme écœuré, raconte Richard Cosetti. Je ne m’étais pas brûlé au travail. J’étais comme écœuré de ça, et je ne savais pas trop pourquoi. »
« Ça », c’était l’informatique, le domaine dans lequel Richard a étudié et travaillé durant 18 ans. « C’était ma force, les maths, la programmation, les ordinateurs. J’étais bon là-dedans. »
Après son DEC en informatique à Saint-Jean-sur-Richelieu, il a été embauché dans une petite entreprise de la région, qui a grandi avec les années, et dans laquelle il est devenu actionnaire. « C’était quand même intéressant. J’étais développeur logiciel et j’assistais mes collègues des ventes. J’étais la personne aux compétences techniques qui allait avec le vendeur chez des clients. »
Sauf que plus les années passaient, moins Richard se sentait à sa place dans ce milieu d’informaticiens, assis de longues heures devant un ordinateur. Au point d’en faire une « mini-dépression », pour reprendre ses termes. « Pas une dépression grave, mais je le savais qu’il s’était passé quelque chose. Je n’étais plus super heureux de me lever le matin. »
Il est allé consulter. Pas longtemps. La première étape, un long questionnaire, a été une révélation. « C’était écrit : “Quel est ton rêve dans la vie ?” Et la question suivante était : “Pourquoi tu ne peux pas réaliser ton rêve ?” » raconte-t-il.
La première réponse s’est imposée sur-le-champ. « J’aimerais avoir des serres, avoir mes serres. » La deuxième réponse coulait de source. Des serres, il était capable d’en acheter. Et du terrain pour les installer, il y en avait à profusion derrière la maison de ses beaux-parents, à Mont-Saint-Grégoire. Ce qui restait à trouver, c’était plutôt « le guts de le faire », a-t-il réalisé.
« En répondant à toutes ces questions, je me suis dit : “C’est ça, la révélation ! Je vais proposer de travailler à temps partiel, faire un départ progressif, vendre mes actions” », mentionne-t-il.
Richard, il faut le préciser, n’a pas de racines agricoles. Son père travaillait pour la Sûreté du Québec et sa mère, chez Desjardins. Sa conjointe, avec qui il est en couple depuis plus de 25 ans, pas davantage. Mais son envie de serres n’est pas sortie de nulle part non plus.
Durant ses études en informatique, Richard occupait un emploi à temps partiel comme commis dans une fruiterie des environs, à Iberville. Voyant que ses beaux-parents n’utilisaient plus le jardin aménagé derrière leur maison, il avait offert à son patron de lui fournir des légumes qu’il ferait pousser.
« Pour le fun, j’ai mis en terre 50 plants de tomates cerises, de couleur...