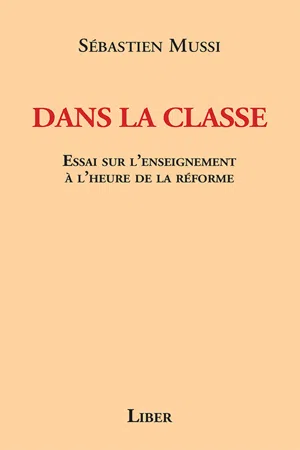![]()
Chapitre 1
Mutations de l’institution scolaire et réforme pédagogique
Les choix de mise en scène sont des choix politiques.
Jean-Luc Godard
Depuis 1994, l’école québécoise est en mutation. Cette transformation est aujourd’hui pratiquement parvenue à son terme, notamment dans les cégeps, qui, en 2005, se sont dotés de plans stratégiques et de projets éducatifs alignés sur ce qui a été appelé le « renouveau pédagogique ».
Ces établissements voient donc arriver aujourd’hui des étudiants qui ont vécu leur scolarité selon les méthodes et les contenus de la réforme, et les professeurs sont incités à ajuster leurs pratiques à cette nouvelle « clientèle » (c’est ainsi que l’institution nomme désormais les étudiants). Dans un rapport du Conseil supérieur de l’éducation, on trouve la recommandation suivante : « […] soutenir l’appropriation, par le personnel enseignant du collégial, des changements occasionnés au secondaire par le renouveau pédagogique et faciliter l’atteinte de consensus sur les changements qui en découlent au collégial ». Et si on affirme par ailleurs que les professeurs du cégep, « à titre d’experts de leur discipline et de leur pratique professionnelle, continueront de recourir aux pratiques pédagogiques et évaluatives de leur choix », c’est à la condition que ce soit « en cohérence avec les compétences et les connaissances visées par leurs cours ». Mais quels sont les aspects les plus marquants du « renouveau pédagogique » en ce qui concerne les cégeps ?
Pour saisir les enjeux de la réforme, il faut s’intéresser aussi bien au contexte socioéconomique dans lequel elle se déroule qu’à celui qui l’a produite — ou, comme le disent ses défenseurs, rendue nécessaire. Le contexte, érigé en réalité incontournable, a imposé en effet une mutation des objectifs et de la structure des institutions scolaires, y compris des cégeps qui, dans ce contexte, jouent au Québec un rôle clef. Il faudra ensuite s’intéresser à ce que l’on nomme la pédagogie par compétences ou l’approche par compétences, dans la mesure où elle répond parfaitement aux nouveaux objectifs de l’école ; nous parlerons encore de l’approche par programme ou approche intégrée (ce dernier terme, que l’on retrouve dans les documents préparatoires du ministère de l’Éducation du Québec, semble avoir disparu du vocabulaire courant), qui accouche d’une structure institutionnelle qui remplace celle de l’enseignement par champs disciplinaires et par matières et qui est la contrepartie organisationnelle de l’approche par compétences. Je dirai enfin quelques mots de la formation des maîtres, enjeu majeur de cette réforme dite pédagogique par le ministère — en réalité, on le verra, une réforme politique et économique dont le volet pédagogique n’est que l’aboutissement (terrifiant).
Une école taillée pour le marché
L’un des principaux arguments en faveur de la réforme, que l’on trouve aussi bien dans les documents institutionnels locaux, comme les plans stratégiques et les projets éducatifs des cégeps, que dans les documents ministériels, est que la réalité du travail a changé et qu’elle change rapidement et constamment. La croissance économique passe de plus en plus par un marché du travail caractérisé par deux données. Premièrement, en raison des changements rapides des réalités économiques, on a besoin d’une masse de travailleurs polyvalents, capables d’assumer des tâches non spécialisées, mais faisant appel à un certain nombre de compétences de base, des travailleurs adaptables, donc, à ces changements. Deuxièmement, le marché de l’emploi se polarise fortement : on a besoin, d’un côté, d’un petit nombre de personnes hautement spécialisées et, de l’autre, d’un grand nombre de travailleurs non spécialisés, mais possédant ces fameuses compétences de base nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Les compétences de base, qui deviennent, dans le jargon pseudopédagogique de la réforme, des compétences « transversales », ont été déterminées par différents organismes — notamment l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE —, dont aucun n’appartient au milieu de l’éducation. Elles désignent la capacité de communication dans la langue maternelle et dans une ou plusieurs langues étrangères, l’alphabétisation numérique, la flexibilité et l’adaptabilité et l’esprit d’entreprise. L’approche par compétences, qui ne date tout de même pas d’hier, a donc été jugée comme une approche d’enseignement capable de faire acquérir aussi bien les compétences dites spécifiques (propres à une formation et à un métier) que les « compétences dites transversales » (communes à tous et nécessaires pour tout travail, y compris non spécialisé). Adoptée comme unique méthode pédagogique, elle ne répond pas, comme on nous l’affirme pourtant, avant tout à un ou des problèmes scolaires liés à l’intérêt des étudiants (que ce soit la baisse du niveau de culture générale, le décrochage, la fréquentation sporadique, etc.), mais bien plutôt à un problème économique.
Ajoutons que l’approche par compétences provient, historiquement, de la culture d’entreprise dont le but est, justement, de rendre les employés adaptables et flexibles, de recycler ceux qui peuvent l’être. On comprend dès lors qu’il n’y a décidément pas grand-chose de pédagogique dans la réforme. Il s’agit au contraire, pour les entreprises, de faire porter à l’école le fardeau de la formation de ses travailleurs, aux frais du contribuable, et de rapprocher l’école de l’économie.
Devenue une succursale des entreprises, l’école voit ainsi ses objectifs changer : elle devra désormais leur assurer le personnel non spécialisé dont elles ont un besoin croissant. On retrouve d’ailleurs cette volonté clairement affirmée dans un rapport du Conseil supérieur de l’éducation : « Le Conseil constate que le recours aux ressources du réseau et de chaque établissement d’enseignement est limité et s’exerce dans des conditions de contraintes telles que les retombées de système ne sont pas optimales. Le deuxième enjeu réside donc dans des relations plus soutenues à l’interne qui pourraient générer de meilleures retombées sur l’activité éducative de chaque établissement. […] Le Conseil retient comme cinquième enjeu la question du financement approprié des services aux entreprises : les conditions d’existence des SAE et d’exercice de leur mandat, qui demeurent étroitement liées à l’impératif d’autofinancement des activités qu’ils organisent, ne favorisent pas le déploiement de l’offre de service du réseau de l’éducation. »
Dernier point à ce propos : il est évident que ceux qui le pourront, et non ceux qui le voudront, ni même peut-être ceux qui en auront l’intérêt et la capacité, iront faire leurs études dans un collège privé, puis poursuivront des études à l’université, ce qui leur garantira des postes spécialisés, bien rémunérés parce qu’essentiels et demandant une haute compétence technique et scientifique. Mine de rien, c’est l’idée d’un cégep à chance égale pour tous qui disparaît.
Le poids du monde
Mais pourquoi une réforme ? Pour répondre à cette question, il faut dire deux mots des justifications théoriques de cette réforme. Je n’irai pas ici au fond du débat scientifique, qui plonge en partie (mais en partie seulement) dans les travaux du psychologue et épistémologue Jean Piaget, pas plus que je n’entrerai dans le débat de savoir s’il s’agit ou non d’une méthode inspirée par le socioconstructivisme et de quelle manière — ce point est loin d’être clair, et il faudrait au moins distinguer, comme le font Nico Hirtt et Normand Baillargeon, entre le socioconstructivisme psychologique et sociologique et celui dit philosophique ou idéologique.
Dans le domaine de l’éducation, le socioconstructivisme philosophique (ou radical, comme le nomme Baillargeon) renvoie à une position pragmatique de l’enseignement. Les tenants de l’approche par compétences soutiennent en effet le relativisme absolu du savoir (dès lors réduit à une question d’opinion), sa dimension radicalement historique, culturelle et contextuelle. Si cela a bien un sens du point de vue sociologique, cela n’en a guère sur le plan épistémologique et encore moins sur le plan normatif.
Les promoteurs de l’approche par compétences vont encore affirmer que, à strictement parler, l’élève n’apprend rien ; son cerveau ne fait que se former une image du réel, image qui, dès lors, est nécessairement juste. L’image du monde (voire de sa discipline !) que se fait le professeur n’a pas plus de validité que celle de l’étudiant, peu importent les connaissances accumulées, l’expérience d’un monde, l’expertise disciplinaire et scientifique. Le professeur n’a radicalement (plus) rien à offrir. Et comme il n’a rien à offrir, comme il ne peut rien enseigner et que les connaissances qu’il possède ne sont ni plus ni moins qu’une image du monde, ni plus juste, ni meilleure, ni même plus avertie que celle de ses élèves, la transmission de ses connaissances, et ce qui l’accompagne, en termes de méthode et de sensibilité épistémologique, devient tout à fait secondaire — voire inopportune, car cela empêcherait l’élève de former sa propre vision des choses et du monde ! Le professeur devient un simple animateur, un facilitateur (un gentil organisateur !) et, dans le système socioéconomique, un opérateur de ce système : il est là pour que l’élève se forge une image du monde et pour s’assurer que cette image lui permette de s’intégrer dans ce monde dont il ne peut être au bout du compte que l’écho, s’y intégrer aussi harmonieusement que possible — et ce, dit-on, pour son plus grand bien —, c’est-à-dire tenir un « rôle efficace dans la société ».
Cette perspective soulève aussi d’autres questions. On peut notamment se demander quelle image du monde l’élève peut se former si tout ce qu’on lui offre, c’est l’image de son propre désir. Car de ce monde, dès lors qu’il est convaincu que son regard vaut par et pour lui-même, il ne voit plus que lui-même, que la projection de sa propre structure mentale, de ses propres fantasmes. C’est ici tout le rapport à l’altérité qui s’amoindrit, rapport qui commence non pas avec l’énonciation (aussi claire et efficace soit-elle) d’opinions variées, mais avec la tentative sans cesse à réitérer de comprendre l’autre, ce qu’il en est de lui et d’où il (de)vient. C’est aussi tout le rapport au temps qui est évacué : en privant l’élève de tout contenu, ou de la nécessité de l’assimiler, ce qui revient au même, on le prive non seulement de ces regards autres sur le monde mais aussi de l’idée que le monde dont il se forme une image n’est pas né avec lui, qu’il a une histoire, un développement, une construction et, finalement, des raisons d’être ce qu’il est — et naturellement, tout cela fait l’objet de discussions, de luttes autant idéologiques que scientifiques, d’une recherche qui ne s’arrête jamais.
Cette position épistémologique, et c’est un point capital, renvoie l’élève à lui-même. L’image du monde qu’il se forme, il en est responsable en fin de compte — ou du moins lui en renvoie-t-on la responsabilité. Et il n’est pas seulement responsable de sa vision du monde (ce qui est déjà en soi une absurdité abyssale), il le sera de ses choix, de sa réussite ou de son échec, de son bonheur ou de son malheur. Chacun devient de la sorte un individu seul et isolé qui aura à supporter un monde dont, tout de même, il hérite. « Tel est bien l’objectif : mettre les jeunes dans une situation où la concurrence et la hantise de l’adéquation à l’emploi remplissent pleinement leur rôle de moteur du changement, tout en leur proposant une grande diversité de cursus et en espérant ainsi trouver dans la multitude des travailleurs diversement formés, celui qui correspondra le mieux à l’emploi offert. Seul face à l’École, le jeune une fois devenu travailleur sera à nouveau seul face à son patron. »
Que l’on me comprenne bien, je n’ai rien contre la responsabilisation des jeunes — notamment en ce qui concerne leurs études. Mais en faisant de nos élèves les seuls responsables de ce monde, non seulement leur impose-t-on un poids impossible à porter, non seulement efface-t-on toute idée de solidarité, mais encore leur refuse-t-on toute possibilité d’éprouver quelque dette que ce soit à notre égard — toute dette, c’est-à-dire toute reconnaissance aussi bien que tout reproche car, en fin de compte, c’est nous, professeurs, décideurs, et même experts en pédagologie, c’est nous, adultes, qui avons fait du monde ce qu’il est. C’est alors tout le passé de ce monde présent qu’on leur demande d’assumer. « Enfermé seul dans des représentations qu’il doit construire et de la validité desquelles il est seul juge, le sujet connaissant [l’élève] ne peut pas compter sur un enseignant qui saurait où il doit arriver et qui corrigerait au besoin ses efforts pour l’y orienter, pas plus que sur un enseignant qui prétendrait lui transmettre du savoir. C’est que le savoir tel qu’il est conçu dans le cadre du constructivisme radical, cette chose qui consiste en structures construites par le sujet et dont on nous précisera tout à l’heure qu’elles doivent être viables, ne se transmet tout simplement pas. »
Je rappelle enfin que cette réforme, dont on comprend maintenant qu’elle est bien plus que « pédagogique », est déjà implantée au primaire et au secondaire — ce sont en somme des enfants que nous laissons aux prises avec ce poids. Qui sait quelle charge d’angoisse s’accumule face à cette impossible responsabilité, et avec quelles conséquences ? Mais, on peut le soupçonner, l’angoisse n’a plus cours dans nos études et dans nos classes — où donc pourra-t-elle s’exprimer ? Les questions, simples, tri...