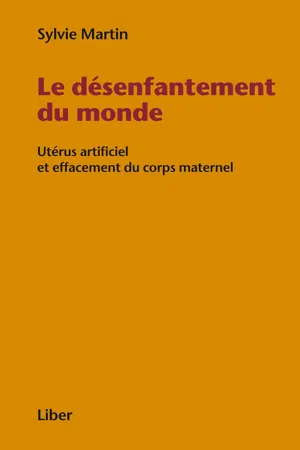CHAPITRE 1
Le projet de l’utérus artificiel
Tout se passe comme si la gestation habituelle dans le ventre d’une femme était vouée un jour ou l’autre à disparaître.
HENRI ATLAN
L’utérus artificiel est un type d’incubateur perfectionné qui reproduirait artificiellement et régulerait par ordinateur les fonctions normales de l’organisme maternel (membranes et parois de l’utérus, placenta, alimentation, évacuation des déchets, température, liquide amniotique, battements cardiaques de la mère, etc.). Selon le biologiste Henri Atlan, la mise en œuvre est complexe, mais ces difficultés techniques n’ont apparemment rien de fondamental. Il ne s’agirait que d’obstacles mécaniques franchissables, d’un « problème de tuyauterie très compliqué ». La concrétisation serait à son avis tout à fait possible. Le cahier des charges étant déjà en bonne partie établi, plusieurs scientifiques voient les écueils techniques comme surmontables et présentent la réalisation du projet comme souhaitable, voire inévitable. Quoiqu’ils soient nombreux à reconnaître que celui-ci suscite énormément de questions d’ordre éthique, politique, juridique, économique, social et culturel, certains estiment inéluctable une mise en marché de l’appareil, peu importe que ce soit dans dix ou dans cent ans. Cette « inéluctabilité » repose entre autres sur le fait que la majorité des chercheurs travaillent en ce sens sans débat public, mais aussi et surtout sur ceci que l’immense potentiel « thérapeutique » de l’utérus artificiel est généralement interprété positivement, en conformité avec la pensée occidentale qui cultive depuis plusieurs siècles la foi dans le progrès, le biopouvoir sur les corps et la médicalisation du social.
Deux voies principales de la recherche
Semblant sortir tout droit d’un roman de science-fiction, le projet de l’utérus artificiel donne lieu à d’énormes efforts de recherche depuis les années 1950 dans plusieurs laboratoires asiatiques, américains et européens, notamment dans les domaines de la reproduction assistée, de l’obstétrique-gynécologie, de l’embryologie, de la néonatalogie, de la bioinformatique et du projet Génome humain. En fait, le programme de l’utérus artificiel surgit à l’intersection de la recherche biomédicale et technoscientifique de toutes ces disciplines et pratiques. S’il était réalisé, comme l’éthicien Stephen Coleman l’a suggéré, il serait le résultat de la convergence de recherches indirectes davantage que de recherches frontales, c’est-à-dire uniquement consacrées à sa concrétisation. Parmi toutes ces activités, nous pouvons dégager deux voies principales concourant à l’aboutissement du projet ectogénétique, l’une tentant de gagner du terrain sur le début de la grossesse, l’autre sur la fin.
Avant de les aborder, rappelons que toutes ces expériences sont d’abord réalisées grâce à des modèles animaux, comme dans le cas des autres formes de procréation assistée, qui n’auraient probablement jamais pu voir le jour sans l’expérimentation vétérinaire. Dans le cas de l’insémination artificielle, par exemple, ce sont les nombreuses expériences sur des vaches qui en ont permis l’application à l’être humain, ce qui suppose une indifférenciation conceptuelle entre l’humain et l’animal, sur laquelle nous reviendrons. Cela dit, depuis les années 1950, de nombreuses tentatives de gestation artificielle sont effectuées non seulement sur des animaux, mais aussi avec des embryons humains, issus principalement d’avortements et de la fécondation in vitro (embryons surnuméraires), ce qui ne va pas sans soulever de considérables questions symboliques et éthiques que nous ne pouvons aborder dans la présente analyse.
La première voie vers le projet ectogénétique est donc celle de la biomédecine reproductive. S’intéressant principalement aux stades préembryonnaires (du jour zéro au jour quatorze) et embryonnaires (du jour quinze à la huitième semaine) de la vie, divers domaines de cette discipline (embryologie, génétique, reproduction techniquement assistée) tentent de maîtriser et de reproduire ces processus dans le but de pallier les diverses inaptitudes, imperfections ou défaillances du corps maternel. On vise à créer les conditions pour que des embryons puissent se développer efficacement en dehors de l’utérus maternel, dans le cas où celui-ci ne pourrait y parvenir « naturellement » ou « correctement ». Cette première catégorie d’expériences technoscientifiques est essentiellement animée par une lutte contre l’infertilité et la stérilité — construites comme des pathologies ou des dysfonctionnements « naturels », sources de « désespoir » dont la biomédecine se doit de triompher — et pour une constante « amélioration » du développement fœtal. Ces procédés témoignent déjà d’une forme d’ectogenèse partielle, en effectuant une partie de la reproduction en laboratoire. Parmi les moments de cette première étape de la grossesse, on retient deux processus principaux : la fécondation de l’ovule et son implantation dans l’utérus. Évidemment, il existe d’autres séquences reproduites artificiellement, comme l’insémination que nous ne retiendrons pas ici car traduisant davantage l’effacement du corps masculin.
Les desseins et les pratiques de fécondation extracorporelle ne datent pas d’hier. L’éthicien Stephen Coleman rapporte que les premières tentatives de fécondation in vitro animale remontent à 1878 et que la première réussite date de 1934. En ce qui a trait aux embryons humains, la première fécondation artificielle réussie (mais qui a échoué lors de l’implantation) a été effectuée par John Rock en 1944 à l’université Harvard, puis le flambeau fut repris par le Britannique Robert Edwards, en 1969, qui a réussi à féconder un ovule en laboratoire. La première grossesse accomplie par fécondation in vitro s’est faite à Melbourne en 1973 (mais elle n’a duré que neuf jours). Enfin, le moment le plus significatif de l’histoire de la procréation assistée est sans doute la naissance des premiers « bébés éprouvettes », telles la Britannique Louise Brown en juillet 1978 et la Française Amandine en 1982, ce qui donne le coup d’envoi à la généralisation de cette pratique dans les pays industrialisés. Sans trop nous attarder à l’historique de la fécondation in vitro, retenons simplement pour l’instant que la vie humaine peut depuis quelque temps déjà commencer en laboratoire.
Le second processus biologique que ce domaine tente de maîtriser davantage est celui de l’implantation d’un ovule fécondé in vitro dans une matrice artificielle : la nidation extracorporelle. Bien que l’implantation utérine demeure une condition sine qua non de la reproduction humaine, certains chercheurs visent à franchir cette limite à la fois biologique et éthique. La recherche la plus connue et citée est celle de la pionnière Helen Hung-Ching Liu de l’université Cornell à New York. Directrice de la Reproductive Endocrine Laboratory (Center for Reproductive Medicine and Infertility), elle et son équipe ont tenté de reproduire l’implantation d’embryons humains dans une ébauche d’utérus artificiel. Essentiellement, il s’agissait de prélever des cellules endométriales cultivées in vitro, produites grâce à un cocktail hormonal, et de tenter de les implanter dans un artefact biodégradable de forme utérine (fait de collagène), ce qui fut un succès. L’expérience dut être interrompue après quelques jours conformément aux lois bioéthiques américaines alors en place. Plusieurs considèrent donc cet arrêt non pas comme un échec mais plutôt comme une première étape réussie qui mènera un jour — lors d’un éventuel assouplissement juridique — à l’accomplissement du projet. C’est en ce sens que la chercheuse Liu affirme, sans ambages : « [c]’est mon but ultime. Je crois qu’un utérus artificiel peut être concrétisé afin de pouvoir mener un bébé à terme. »
L’autre voie vers le projet ectogénétique, à l’autre extrémité de la grossesse, est celle de la néonatalogie. Diverses recherches et pratiques biomédicales tentent en effet de maîtriser les risques et de résoudre les complications liées à la gestation et à la naissance, notamment les naissances prématurées. La néonatalogie demeure à cet égard un des champs les plus prometteurs pour la réussite du projet ectogénétique. Et il faut reconnaître que la technique d’« incubation fœtale extra-utérine » — incubateurs qui remplissent les unités de soins intensifs néonataux — représente de toute évidence une première forme d’utérus artificiel. Qui plus est, ce domaine parvient à continuellement repousser les seuils de viabilité des prématurés. On rencontre dans ce champ une série de recherches, dont celles portant sur le liquide amniotique et sur les possibilités de la ventilation liquide, qui, semble-t-il, demeurent prioritaires. Sont exemplaires à cet égard les recherches menées par Thomas Schaffer de l’université Temple, en Pennsylvanie, qui tente de sauver la vie des enfants prématurés de plus en plus tôt en reproduisant in vitro le liquide pulmonal intra-utérin.
Mais l’expérience la plus connue et diffusée est sans doute celle menée par Yoshinori Kuwabara, de l’université Juntendo à Tokyo, qui a travaillé pendant plusieurs années sur les placentas artificiels. La dernière recherche qu’il a dirigée consistait essentiellement à retirer un fœtus de chèvre âgé de dix-sept semaines du ventre de sa mère afin de le transposer dans une matrice artificielle emplie de liquide amniotique, lui fournissant du sang oxygéné par un cathéter implanté dans le cordon ombilical. La survie du fœtus pendant trois semaines a fait franchir un pas de géant à la néonatalogie. Et l’annonce très médiatisée en 1997 de cette avancée laisse entendre que de nombreuses autres recherches sur ce procédé s’effectuent actuellement. Ces efforts témoignent bien que nous sommes entrés « dans une autre ère de la néonatalogie dans la mesure où, plutôt que d’aider les prématurés à survivre dans le monde extra-utérin, on tente aujourd’hui de restituer, en l’imitant, le milieu intra-utérin ; ce qui peut tout à fait être considéré comme un pas supplémentaire vers l’ectogenèse ». En ce sens, certains affirment que l’utérus artificiel se réaliserait probablement dans le domaine de la néonatalogie, combiné aux avancées des technologies de reproduction : « Si nous persistons à faire reculer le seuil où les nouveau-nés prématurés peuvent survivre, nous finirons par atteindre le point où l’embryon produit par fécondation in vitro pourra être maintenu en vie sans jamais passer par un corps humain. »
Dans la même lignée des recherches qui tentent de maîtriser et de transformer les paramètres de la gestation, certains laboratoires travaillent à réaliser une grossesse extramaternelle interespèce ; il s’agit donc ici d’une gestation extérieure au corps maternel sans toutefois être machinique. C’est le cas des expériences de manipulations génétiques et de tentatives de gestation interespèces, menées par des chercheurs de l’Institute of Zoology of the Chinese Academy of Sciences. En 2002, ils ont créé quelque deux mille trois cents embryons hybrides panda-lapin et ont essayé de les transplanter dans des utérus de lapines. Si aucune grossesse n’a résulté de cette expérience, la tentative d’implanter ces embryons hybrides dans des utérus de chattes a pourtant réussi, ce qui est considéré comme une avancée considérable pour le projet de l’utérus artificiel. Le développement de ces techniques signale l’effacement effectif des frontières entre animal, humain et machine, ce qui, du coup, rend plausible le développement d’un humain dans un utérus non humain (qu’il soit animal ou machinique).
Mentionnons en dernier lieu certains cas extraordinaires, par exemple les recherches effectuées à la Chinese Academy of Medical Sciences, qui visent à implanter des utérus artificiels dans des abdomens masculins, ou encore le projet de la matrice artificielle Babytron annoncé avec tapage par les Raëliens en février 2003. Malgré leur marginalité évidente, on constate que ces cas s’ajoutent à une série d’autres recherches plus crédibles et moins fantaisistes. Ensemble, ces divers projets issus d’horizons fort différents convergent vers le même but, la réalisation de l’utérus artificiel.
En rappelant ces quelques exemples d’avancées effectives, notre intention était moins d’entrer dans les débats éthiques sur le projet de l’utérus artificiel que de faire sentir que la logique de développement dans les laboratoires est certainement tangible, alimentée de toutes parts. On n’a pas affaire à des « projections incantatoires et répétitives de formules issues des spéculations théoriques, mais [à] de la recherche de nouveautés concrètes, parfois inattendues, que peut faire apparaître l’expérimentation bien conduite ». L’utérus artificiel n’est donc pas de l’ordre de la science-fiction. C’est plutôt un moteur de la recherche biomédicale — un projet qui oriente la recherche, les investissements et l’avenir.
Quelle que soit la forme sous laquelle i...