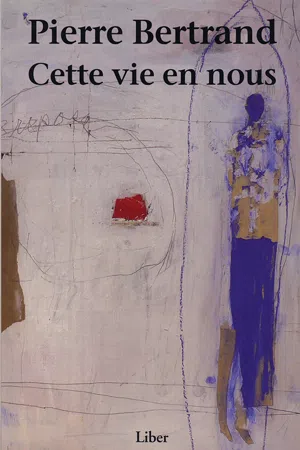![]()
III
LA MACHINE EST ENTRÉE PROFONDÉMENT DANS NOTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PRIVÉE, ET SANS DOUTE VA-T-ELLE Y ENTRER PLUS PROFONDÉMENT ENCORE DANS LE FUTUR. Une part de notre fonctionnement correspond à celui de la machine, d’où notre facilité à la créer et à faire corps avec elle. Toutefois, une fascination malsaine nous abrutit au lieu de nous stimuler. Nous avons trop souvent à l’endroit de la machine un comportement obsessionnel. Celle-ci devrait nous libérer, non nous assujettir. Cependant ce qui libère d’un côté asservit souvent de l’autre. Aujourd’hui par exemple, plusieurs enfants, adolescents et adultes sont devenus esclaves de leur portable et de leur cellulaire. Il n’est pas question ici de porter sur eux un jugement moral. Ce n’est pas une affaire de morale, mais de stratégie. Comment répondre aux nouveaux défis que nous lance la technologie ? Nous devons évoluer avec elle, sans devenir son esclave, en la subordonnant au contraire à nos besoins et à nos désirs. Certes de nouveaux besoins et de nouveaux désirs sont créés, car nous ne savons pas qui nous sommes ni de quoi nous sommes capables. Il nous faut l’apprendre ou l’expérimenter et la technologie contribue à cet apprentissage ou à cette expérimentation. Le créateur crée par-delà lui-même, pour se dépasser, par besoin et par désir. Il aime être surpris, découvrir quelque chose de nouveau. La technologie appartient au mouvement de la création et y contribue à sa façon, notamment, de remarquable et inventive façon, dans le domaine des arts. Elle n’a pas en effet qu’une fonction utilitaire, mais esthétique et artistique. Elle aide à créer pour le plaisir de créer, parce que la création est essentielle à notre épanouissement, que c’est par elle que nous nous inventons ou découvrons. Cependant la technologie n’est pas une panacée, plutôt un adjuvant. Si nous sommes obligés de nous adapter en partie à une technologie qui nous provoque et nous pousse en avant, si nous sommes souvent menacés d’un certain abêtissement par l’usage excessif que nous en faisons, nous l’utilisons aussi pour augmenter notre puissance de vivre, au premier chef notre puissance de créer. Le défi ou le danger tient à ce que le bon et le mauvais sont intimement liés et mélangés.
Il en va de même du faux dualisme vitesse et lenteur. La contradiction est stérile. Il nous faut trouver le calme au cœur de l’agitation, être rapides tout en goûtant le repos. Être vivant ne signifie pas en faire toujours plus et accélérer la cadence, mais au contraire devenir plus lent de manière à goûter l’imperceptible, ce qui se trouve entre les choses et entre les événements, et qui, dans l’agitation habituelle, passe inaperçu. Mieux encore, il ne s’agit pas de choisir entre la vitesse et la lenteur, mais de marier les deux, comme c’est le cas lorsque nous nous trouvons immobiles dans un avion qui file à toute allure, lorsque nous roulons en automobile en baignant dans la lenteur d’une musique ou d’une conversation avec la personne qui nous accompagne. Vitesse et lenteur vont ensemble comme on le constate d’ailleurs dans toute grande œuvre. On le voit notamment dans l’Éthique de Spinoza où la lenteur du début fait place à une immense vitesse. On le voit dans toute grande musique. Un peintre chinois demeure immobile dans le vide et le silence, puis exécute presque instantanément sa toile. Être vivant, c’est sans cesse relier vitesse et lenteur.
Nous entretenons de multiples relations avec la vie, et la connaissance, au sens où on l’entend, n’est que l’une de ces relations, bien que, répétons-le, elle occupe une position hégémonique, du moins du point de vue de la conscience. Nous sommes d’abord en relation symbiotique avec la réalité. Nous en « savons » inconsciemment bien plus que ce que nous pouvons en expliciter dans nos sciences. Comme le dit plaisamment Raymond Ruyer, l’embryon « connaît » mieux l’embryologie que l’embryologiste. Il la connaît de l’intérieur et immédiatement, par son corps entier, non par l’entremise de l’intellect. Cela est vrai de tant de choses. Nous connaissons de manière directe et immédiate l’air par nos poumons et la terre par nos pieds. Nous sommes d’abord en relation avec la réalité, et ce n’est qu’une partie de cette relation que nous pouvons mettre en concepts, en chiffres et en mots. Notre être vivant déborde très largement notre être connaissant. Celui-ci n’en est qu’une partie, même si cette partie a pris le dessus, manifestant ainsi le pouvoir de l’intellect sur le reste du corps. Cependant l’intellect n’est qu’une partie du corps, loin qu’il en soit indépendant, comme sa volonté de puissance voudrait le lui faire croire. Il y a plusieurs dimensions de la réalité. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles celle-ci demeure énigmatique. L’approche scientifique n’accède qu’à l’une de ces dimensions. Toutes les approches s’enracinent dans le corps vivant. Il est faux de soutenir que l’approche scientifique serait neutre ou objective, au sens où elle se trouverait au-dessus de la mêlée, car elle aussi manifeste une pulsion, un besoin, un désir ou un intérêt vital du corps, celui par exemple d’entrer en contact avec certains mécanismes cachés de la réalité de manière à pouvoir éventuellement agir sur elle. L’approche religieuse, elle, satisfait d’autres besoins et d’autres désirs. De même pour l’approche poétique, artistique, etc.
Il y a d’abord le corps vivant lié au monde, l’être-au-monde, comme on le dit en phénoménologie. Les couleurs par exemple appartiennent à cette relation du corps vivant au monde. Elles ne sont pas moins réelles que les ondes et les corpuscules dont nous entretiennent les sciences physiques. Qui plus est, c’est parce qu’il y a d’abord des couleurs pour le corps vivant qu’il y a investigation et découverte des ondes, celles-ci appartenant à une autre dimension de la réalité. On peut qualifier l’approche scientifique d’objective, mais cela ne signifie pas qu’elle soit la seule à nous entretenir de la réalité telle qu’elle est, puisque celle-ci comporte une multiplicité de dimensions ou d’aspects. Elle peut être qualifiée d’objective parce qu’elle fait appel au calcul et qu’elle s’exprime idéalement dans le langage formel des mathématiques, mais la relation du corps vivant au monde déborde le calcul et le langage mathématique, ceux-ci étant seconds et supposant d’autres modes de contact, ceux inhérents à l’être vivant en fonction de sa complexité, contact de respiration, d’alimentation, de perception, d’imagination, de mouvement, de désir, d’action, etc.
La pensée a spécialisé l’intelligence, alors que celle-ci est d’abord celle du corps entier. Avec le développement de la pensée, l’intellectualisme a pris le pouvoir. En fait, la pensée continue à n’être qu’une partie du corps et elle n’a pas le pouvoir qu’elle s’arroge. La place qu’elle prend cependant crée un déséquilibre, voire une division entre une dimension intellectuelle et une autre sensible. En réalité, entendement ou intellect et sensibilité ne sont pas, ne devraient pas, être artificiellement séparés. C’est précisément du point de vue de la pensée qu’ils semblent séparés, entrant même en conflit l’un avec l’autre, comme cela a été si souvent le cas au cours de l’histoire de la religion et de la philosophie. C’est l’être humain entier qui se trouve alors divisé, le corps d’un côté, l’âme (ou l’esprit) de l’autre — le corps, animal et mortel ; l’âme, divine et immortelle. L’humain absolutise et hypostasie une différence qui dégénère en opposition et, faute de pouvoir trouver l’harmonie en lui-même, il projette la guerre à la grandeur de l’univers.
Ce qui est en jeu dans ce conflit, c’est le lien problématique que l’humain entretient avec son animalité et, plus généralement, avec le reste de la nature. Il fait comme si son cerveau ou sa pensée le mettait à part, l’élevait au-dessus de tous les autres êtres, le faisant maître et possesseur de la nature, pour reprendre l’expression de Descartes, qui est fidèle en cela à l’esprit et à la lettre de la Bible. C’est d’abord à l’intérieur de l’être humain lui-même que le problème se pose, quand la pensée acquiert une importance démesurée en regard des autres facultés ou capacités du corps vivant. Elle a même l’impression d’acquérir une autonomie à l’endroit du reste du corps, comme si une tête pouvait fonctionner sans corps… Ce n’est pas l’homme qui porte un jugement sur des facultés qui sont en lutte en lui, mais c’est l’une d’elles, la pensée, qui prend le pouvoir et rabaisse ce qui n’est pas elle. C’est la pensée elle-même qui prend ses distances et se sépare, tombant ainsi paradoxalement dans une illusion transcendantale au moment même où elle prétend pourtant à la fonction de la connaissance, départageant le vrai du faux, l’indubitable de l’incertain. La pensée a d’autant plus besoin de certitudes qu’elle prétend remplacer l’intelligence du corps vivant, intelligence qui se contente d’être en contact avec la réalité dans ce qu’elle a de clair-obscur et d’incertain. Faute d’un contact avec la réalité telle qu’elle est ou devient — plurielle, changeante, imprévisible —, où l’on n’arrive jamais à des conclusions finales, où l’on n’entre jamais en contact avec la vérité absolue, où l’on ne rencontre jamais l’absolument certain et indubitable, puisque l’on se trouve d’abord en contact vivant avec elle, la pensée privilégie le contact cognitif avec l’idée ou avec l’idéal. Faute de trouver ce qu’elle cherche dans la réalité, elle le cherche là où elle peut le trouver, dans l’idée ou l’idéal. Cela dit, quoi qu’elle en ait, la pensée demeure alimentée par l’intelligence du corps entier, intelligence qui ne fait qu’un avec la sensibilité. Le corps vivant voit davantage que ne le conçoit la pensée, une fois dit que voir est plus vaste que connaître ou comprendre.
Contrairement à ce qu’affirmait Gilles Deleuze, qui garde toute notre admiration, le philosophe ne se définit pas d’abord et avant tout par sa capacité d’inventer des idées ou des concepts, mais par celle de voir la réalité telle qu’elle est. Produira-t-il des concepts ? Sans doute, mais secondairement et indirectement, là n’étant ni sa fonction ni son but puisqu’il met au contraire souvent en garde contre la prétention des idées ou des concepts à s’interposer entre la réalité et nous. Une idée ou un concept prend sa source dans une vision. Nous ne parlons pas ici exclusivement de la vision sensible, liée au sens de la vue comme l’un des cinq sens, mais de la vision du corps entier, à la fois sensible et intelligible, pour recourir, justement, à ces concepts traditionnels, en fait ni sensible ni intelligible, car ne s’inscrivant pas dans une structure de division ou de dualisme inhérente à ces concepts. Il ne s’agit pas non plus d’une sorte d’intuition intellectuelle qui serait la vision de l’esprit par opposition à celle du corps. Nous l’avons répété, il s’agit de la vision de l’être entier, du corps-esprit ou du corps vivant. C’est lui qui est dans la réalité et qui entre en relation avec elle. Il ne s’agit pas seulement ici du monde de la vie, si cher à Husserl, par opposition au monde abstrait des sciences, provenant d’une idéalisation mathématique, car le corps vivant a accès à toutes les dimensions de la réalité, pas seulement à celle de la vie quotidienne. Le corps vivant est voyant ou visionnaire. Il n’est pas seulement lié à ses besoins, à ses désirs, à ses intérêts et à ses pratiques. Le monde de la vie n’est pas qu’une dimension du monde, celle-ci dût-elle être à la source de toutes les autres, mais toute réalité est celle du corps vivant.
La pensée, même abstraite, ne se trouve pas au-dessus de la mêlée, mais est toujours vitalement liée au corps. Le langage mathématique est lié au cerveau qui ne peut opérer ou procéder sans le reste du corps. Le cerveau ou la pensée est vivant à l’égal du reste, et en tant que vivant, il n’appartient pas à une réalité intelligible, ni d’ailleurs à une réalité sensible, mais précède ces distinctions puisque celles-ci sont faites par la vie et par conséquent la suppose, la vie tentant, dans un temps second, de mettre en idées ou en concepts ce qui d’abord ne fait qu’un. C’est d’ailleurs pourquoi la philosophie, en tentant de voir ou de montrer la vie ou la réalité telle qu’elle est, produit des concepts. Ceux-ci ne sont que des outils. Ils permettent de voir, ils ne sont pas, comme le croyait Platon, ce qui est à voir comme réalité ultime de nature intelligible. Platon ne fait qu’exacerber le dualisme témoignant de la volonté de puissance de la pensée, qui cherche à prendre le pouvoir sur le reste du corps vivant. La pensée rabaisse ainsi le corps ou la vie, comme cela se fera tout au long de l’histoire de la philosophie chez tant de grands penseurs, notamment Descartes et Heidegger. L’on sait que domine en philosophie la tendance intellectualiste, rationaliste, spiritualiste et idéaliste. Une autre tendance heureusement, pensons à Héraclite et à Nietzsche, ne se laisse pas griser par le monde des idées et des idéaux, et demeure au plus près de la réalité. La philosophie elle aussi est vivante et, en tant que telle, ne se fige pas dans la tradition, mais invente et crée, non pas tant de nouveaux concepts que de nouvelles manières de voir ou d’entrer en contact avec ce qui est ou devient.
Nous sommes vivants en tant qu’humains, avec tout ce que cela implique comme capacités singulières, comme culture et comme histoire. Assumons cette humanité. Partons de ce que nous sommes. C’est d’ailleurs uniquement de cette façon que nous créons. Il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais d’aller de l’avant, une fois dit que puisque la terre est ronde, avant et arrière sont relatifs. C’est ainsi, comme l’a exprimé Nietzsche, que le défi qui se pose à l’être humain est de retrouver une « nouvelle animalité », celle propre à notre être. Nous devons trouver notre propre façon de nous lier à la nature. Nous ne pouvons par exemple faire l’économie de la technologie puisqu’elle est partie intégrante de l’humanité de l’homme. Il nous faut également assumer la pensée et le langage, et ne pas rêver d’un Âge d’or où nous retrouverions l’innocence animale. La pensée et le langage sont des puissances, à la condition bien sûr qu’ils soient utilisés à bon escient. Tout est en effet une affaire d’usage. Nombre de philosophes ont d’ailleurs tenté de déterminer le bon usage de la pensée et du langage. Mal utilisés en effet, ces derniers nuisent plus qu’ils n’aident. Ils produisent notamment de faux problèmes, dont une certaine métaphysique s’est amplement nourrie. Des problèmes peuvent être insolubles à cause de leur radicalité, mais d’autres le sont parce qu’ils sont mal posés. Notre vision doit inclure la pensée et le langage. De quoi sont-ils capables ? Quelles sont leurs limites ? Il nous faut donc faire plusieurs choses à la fois. Nous continuons bien évidemment de penser et de parler, mais sans être dupes de la pensée et du langage. Cela ne nous met dans aucune aporie sur le plan de la vision, même s’il peut y avoir aporie sur le plan de l’expression, forcément limitée, de cette vision. La capacité de faire plusieurs choses à la fois implique entre autres choses de ne pas procéder de manière trop rigide dans une logique de la contradiction puisque cette logique est précisément celle du logos — de la raison ou du discours — et que c’est la portée de cette logique qui est remise en question par la vision.
Par conséquent, il est hors de question de nous installer sans plus dans la pensée et le langage puisque nous nous fermerions alors les portes avant même d’entrevoir ce qui peut se cacher derrière. Une fois les portes fermées, n’existe plus que ce qui se trouve dans la pièce où nous nous sommes confinés. Nous devenons prisonniers de la pensée et du langage. Impossible d’en sortir, entend-on. Voilà une prophétie autoréalisatrice. La raison se donne raison. N’est-ce pas ce qui s’est passé chez tant de penseurs qui ont pris le tournant linguistique, à commencer par l’un des plus grands d’entre eux, sinon le plus grand, Wittgenstein ?
Nous mettons à l’avant-plan la pensée et le langage, et nous négligeons l’expérience du corps entier. Celle-ci est pourtant première, et la pensée et le langage ne peuvent que s’y alimenter. Si une partie du corps-esprit peut s’identifier à un point de vue, celui d’une science, d’une philosophie ou d’une religion, le corps-esprit entier, lui, n’est pas dupe, car il voit autre chose, même s’il ne le dit pas et ne peut d’ailleurs pas le dire.
La vision déborde la connaissance et la croyance. Elle est une expérience située au-delà ou en deçà de toute définition et de toute formalisation, de toute description ainsi que de toute explication. Cela rejoint Descartes : « pour savoir ce qu’est la pensée et le doute, il suffit de penser et de douter ». Ce savoir-là n’est pas scientifique, il est l’expérience ou l’expérimentation du vivant. Cette expérience est sans fin. Seule une petite partie peut en être exprimée. Si un certain type de description ou d’explication exige une distance, celle de la pensée et du langage, une compréhension immanente se fait dans l’expérience vivante. Nous savons ce que c’est qu’être, que vivre, que respirer, que désirer, qu’avoir peur, qu’aimer, sans que nous ayons besoin de le mettre en idées ou en mots. Cette compréhension ne se communique pas ou ne se communique qu’indirectement, elle s’éprouve, ne fait qu’un avec l’épreuve ou l’auto-épreuve du vivant. Dans la mesure où la connaissance suppose une certaine mise en forme ou en discours, la vision du corps-esprit la dépasse. Celle-ci n’est pas connaissance au sens d’une adéquation entre la chose et le mot, ou entre la chose et l’intellect ou l’esprit. Il n’y a pas cette dualité propre au signe. La vision est celle de l’inconnu, au sens où ce qui est vu, senti, expérimenté ne se réduit ni à la connaissance ni à la croyance. Nous voyons ou expérimentons tellement de choses que nous ne pouvons en dire qu’une infime partie. L’expérience de l’être vivant est plus vaste que celle de tout spécialiste.
Il est impossible de faire fi des affects. L’ataraxie chère aux stoïciens et l’objectivité chère aux scientifiques sont elles aussi des affects. La neutralité est une prise de position. Il ne s’agit évidemment pas de nous complaire dans les sentiments ou les émotions, comme les médias le font trop souvent. Nous n’exploitons pas l’affect, nous le laissons se déployer, car il ne fait qu’un avec l’être vivant. Nous sommes partie prenante de tout ce qui arrive, et non au-dessus de la mêlée. Il nous est difficile de faire face à la réalité telle qu’elle est, tellement nous nous en faisons des idées et la voyons plutôt telle qu’ell...