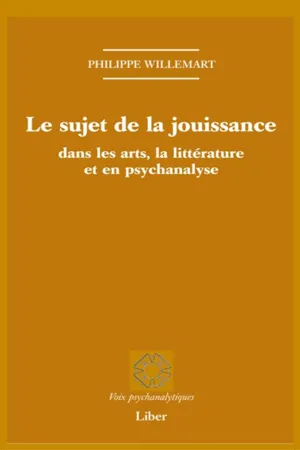![]()
CHAPITRE 1
La critique génétique et les sciences de l’esprit
Manuscrits de l’écrivain, ébauches et croquis de l’artiste montrent de manière privilégiée le travail de la pensée. Peu de publications soulignent le rapport entre les sciences de la pensée et la critique génétique. La fréquence des signifiants « pensée » et « processus de création » dans la revue brésilienne Manuscrítica, de l’Association des chercheurs en critique génétique, dans la revue française Genesis, de l’Institut des textes et manuscrits modernes du Centre national de la recherche scientifique (France), de même que dans les œuvres et thèses citées dans le site internet du département de recherche en critique génétique Núcleo de Apoio à Pesquisa em Crítica Genética, indique pourtant que la critique génétique se préoccupe indirectement du travail subtil de la pensée et de sa compréhension.
Je ne prétends pas discuter ici des rapports entre l’esprit et la machine. On sait déjà qu’il est possible de dicter un texte à l’ordinateur2; tout récemment, nous apprenions qu’il sera aussi possible de contrôler le pc ou le cellulaire par la pensée3, mais le doute subsiste quant à ce qui contrôle le cerveau et comment fonctionne la pensée. Qui domine l’autre ? Le cerveau et sa base biologique ou la structure psychique ? Un cancer se déclenche-t-il à la suite de la dérégulation des cellules ou est-il la conséquence de la perte d’un être cher ? Quelle est sa cause réelle et originelle ? La question fait l’objet de débats passionnés entre scientifiques, psychiatres, psychologues et psychanalystes. Les dualistes, comme Descartes, soutiennent la séparation du corps et de l’âme ou de l’esprit ; les monistes, de plus en plus nombreux, défendent leur union et n’attribuent pas plus d’importance à l’un qu’à l’autre. « Si l’esprit n’est pas autre chose que le corps en mouvement4 », il n’y a pas de raison de séparer le cerveau de l’esprit, souligne le cognitiviste Varela. On trouve là une conception qui n’est pas très loin de celle d’Aristote, pour qui l’âme est la somme des fonctions corporelles. Dans le même sens, Merleau-Ponty ajoutait que « notre corps n’est pas un objet pour un “je pense” : il est un ensemble de significations vécues qui marche vers l’équilibre5 ». L’esprit pourrait dès lors être défini comme la fonction du corps, selon Izquierdo, dépendant de lui pour exister, souffrir et se manifester6.
Pour comprendre le fonctionnement de la pensée dans la parole ou l’écriture, il existe pour le moins quatre voies d’accès : la psychanalyse, les sciences cognitives, la biologie et l’étude du manuscrit de l’écrivain.
L’écoute psychanalytique sur le divan suppose une non-pensée identifiée à l’inconscient comme origine de la pensée7. Selon la psychanalyse, l’homme ne pense pas avec son âme, contrairement à ce qu’affirme Aristote, bien qu’elle concède avec Lacan que le monde est un fantasme qui se soutient d’un certain type de pensée. Mais si « le sujet de l’inconscient touche l’âme à peine à travers le corps8 », n’importe quelle activité, y compris l’écriture, passe par l’inconscient. Même si je ne suivrai pas cette première piste explicitement, je ne manquerai pas d’y faire allusion entre les lignes puisqu’elle a tout à voir avec la naissance de l’écriture.
L’étude du cerveau par les cognitivistes et les neurolinguistes est une autre voie, bien que les approches soient variées et parfois antagoniques. Les progrès dans la description du cerveau au moyen de plusieurs techniques d’images et la possibilité de tester les effets d’un médicament sur une déficience localisée ont conduit certains scientifiques à croire qu’ils arriveraient à découvrir l’origine de la pensée9. Ce type d’études confirme en effet le fonctionnement holistique du cerveau et vient ainsi corriger les premières trouvailles du médecin Paul Broca qui avec beaucoup d’autres avaient identifié la fonction de chaque zone du cerveau10. Mais malgré le raffinement de la mesure et les tentatives d’identification d’un neurone à une image, la complexité du cerveau est telle que le passage du neural au mental demeure un mystère. Ce n’est pas non plus semble-t-il en assimilant le cerveau à la boîte noire de la première cybernétique, à un ordinateur ou à un réseau d’ordinateurs11, comme certains l’ont fait, que nous comprendrons la pensée.
Il existe un courant dans le cognitivisme qui soutient la naturalisation possible de la phénoménologie. La philosophie développée par Husserl a une base naturelle et biologique, affirment Jean Petitot et Francisco Varela12. C’est la embodied cognition ou la « cognition énactive », incarnée13. Les couches qui constituent l’être humain, depuis le psychique jusqu’au biologique, interagiraient entre elles et s’auto-organiseraient dans les deux sens, ascendant et descendant14. Notons que la cognition énactive ne s’oppose pas nécessairement à la théorie psychanalytique. Elle admet l’idée que la pensée, et donc l’inconscient, implique le corps pulsionnel comme une des couches qui interfèrent constamment avec l’ensemble. De plus, cette théorie ne cherche pas une équivalence biologique d’une action cognitive déterminée puisqu’elle fait l’hypothèse d’une infinité potentielle de représentations en relation à un élément biologique et met ainsi l’accent sur l’aspect métaphorique et métonymique.
C’est sur la base d’une telle conception que « la science cognitive peut revendiquer que le problème philosophique traditionnel du rapport entre l’esprit et le corps est transformé en un problème scientifique, et qui plus est scientifiquement soluble : la clé de ce rapport réside précisément dans les processus qui donnent naissance au mental, quelle que soit la matière dont on préfère les concevoir15 ». En accord avec Varela, Alain Prochiantz, directeur du Laboratoire du développement et de l’évolution du système nerveux (cnrs) de l’École normale de Paris, déclare que « même si la tentation relativiste d’humaniser les sciences dites dures peut sembler à l’opposé de la volonté sociobiologique de biologiser les sciences dites molles — les sciences cognitives restent partagées entre les deux tendances —, ces tentatives se rejoignent toutes dans un effacement désiré des frontières entre disciplines et plaident donc pour une réorganisation révolutionnaire des champs scientifiques16 ».
Mais on peut aussi miser davantage sur la biologie pour expliquer le rapport corps-esprit. C’est la troisième piste. De ce point de vue, « la structure cérébrale est le résultat d’une interaction entre les gènes de développement qui définissent l’appartenance à une espèce donnée et l’histoire de l’individu porteur de gènes et donc appartenant à cette espèce », écrit Prochiantz. On définit alors la pensée « comme le rapport adaptatif qui lie l’individu et l’espèce à leur milieu […]. Cette définition est strictement biologique et contraire à l’unicité des savoirs, elle n’exclut pas d’autres définitions […] élimine la question de la localisation de la pensée […] répudie la représentation de la pensée comme substance sécrétée par un organe (théorie inspirée de Cabanis) et incorpore tous les aspects des interactions entre le vivant et son milieu sans restriction aucune sur l’organisme considéré17. »
Bien que restreinte à la biologie et applicable à tous les êtres vivants, sans distinction entre l’homme et l’animal, une telle perspective a l’avantage d’être rattachée au corps sans exiger une base organique, et d’inclure le langage, la culture et le symbolique qui structurent nos sociétés. Prochiantz souligne bien que si la biologie « doit travailler à élucider les conditions universelles de la construction des singularités […] il lui est impossible de faire, à elle seule, la théorie d’un individu ou d’une civilisation donnée » puisque « l’individuation est un processus sans fin, mais aussi sans finalité, dont la compréhension relève de tous les champs de savoir, y compris des disciplines non scientifiques, même s’il revient aux seuls biologistes d’en élucider les mécanismes et les conditions d’existence […]. Il y a donc nécessairement dans l’étude de l’Homme quelque chose qui échappe au réductionnisme biologique18. »
Le psychanalyste François Ansermet et le neuroscientifique Pierre Magistretti confirment les observations de Prochiantz et de Varela : « Étrangement, il y a un point de convergence entre la neurobiologie et la conception de la cure analytique (deux incommensurables), dans la mesure où un signifiant équivaut à un “signe de la perception”, mais aussi à une trace synaptique19. » Le cognitivisme fait comprendre indirectement ce qui se passe dans les manifestations de la pensée visible dans le manuscrit, dans l’insertion de l’enfant dans la langue ou dans l’apprentissage d’une langue étrangère20. Ce sont ces manifestations qui constituent notre quatrième piste, celle que nous allons suivre de près. La cognition énactive tout comme l’approche biologique soutiennent que l’équivalence entre une localisation dans le cerveau et une activité cognitive n’est pas nécessaire, nous pouvons donc en conclure facilement que n’importe quelle activité anime plusieurs régions de l’esprit.
Avant d’aborder la critique génétique, je dois rappeler trois hypothèses littéraires sur le travail de l’esprit. La première est celle des surréalistes, qui pensaient avoir découvert le fonctionnement de la pensée grâce à l’écriture automatique, alors que les ratures que contiennent leurs manuscrits témoignent d’une relecture et d’une soumission à la syntaxe. La deuxième est celle de la poète anglaise Elizabeth Bishop, qui assimilait l’esprit à un univers partagé entre un espace ordonné par des corridors, des galeries et des chemins, et un autre espace sans architecture apparente21. La troisième est celle de Celina Borges Teixeira qui, étudiant les brouillons de L’Ange de Valéry22, a suggéré que les différentes versions du texte communiquaient dans l’esprit de l’écrivain, comme les pièces des mobiles de Calder poussées par le vent. Ces mouvements auraient créé des versions intermédiaires non transcrites, ce qui aurait empêché les archivistes d’établir le rapport entre les différentes versions manuscrites23. L’hypothèse rappelle celle des scientifiques qui ont détecté des aires du cerveau communiquant entre elles.
Alors que les réactions du cerveau peuvent être visualisées, les chemins de la pensée se révèlent encore mystérieux, puisqu’ils ne sont pas seulement tracés à l’aide du cerveau, mais aussi grâce au milieu24. Pour mieux les saisir, il faudra s’appuyer sur un cadre conceptuel, même s’il restera assez pauvre par rapport à ce qui se passe réellement25.
À la question sur l’origine de l’écriture ou sur ce qui déclenche le travail de la création, Proust suggère une piste dans Du côté de chez Swann26. Charmé par la petite phrase mélodique de Vinteuil qui évoque son amour pour Odette, l’amante, Swann ressent un bonheur momentané, il entend un autre, lui-même dans le passé, qui jouit (c’est le « j’ouis jouir » de Lacan), mais ne veut rien savoir de cette jouissance qui lui rappelle une souffrance du passé. L’attitude de Swann révèle que toute activité humaine a pour base une jouissance/souffrance dont peu se soucient parce que cela fait mal. Partant de là, pourquoi ne pas faire l’hypothèse qu’il existe une relation nécessaire entre la jouissance et le faire artistique ? Je soutiendrai donc que tout roman, poème, drame ou œuvre en général est à l’origine le fait d’une jouissance qui inclut la douleur. Le manuscrit expose cette dynamique. À mesure que le texte se construit par les suppressions et les ajouts, il passe par la re-présentation et le grain de jouissance. J’ai appelé ce mouvement « texte mobile » pour décrire à la fois l’instabilité du texte qui se fait et se défait et le grain de jouissance stable qu’il sous-tend. Cela suppose aussi que la jouissance, identique durant toute l’écriture de l’œuvre, disparaît avec la remise du manuscrit à l’éditeur.
C’est le grain de jouissance, ou « le bout de réel » comme dira Lacan, qui mène le jeu, amenant l’écrivain à se dire, à se désubjectiver, pour renaître auteur. Éveillé par le texte mobile — ensemble d’impressions, de sensations liées aux appels du grand Autre —, une invitation, la pression des amis, la tradition littéraire, la critique, etc., le désir de l’écrivain entraîne la « pulsion d’écrire ». Raturant page après page, l’écrivain bute contre d’autres sollicitations qui surgissent dans les silences et les suppressions, dans l’invention de l’écriture. Il devient en quelque sorte l’instrument de ces appels et de ces sollicitations, un scripteur, et, ensuite, le lecteur de son écriture. Dans ce processus se construit « la mémoire de l’écriture ». Le Flaubert de La légende de saint Julien l’hospitalier n’est pas exactement celui de Un cœur simple ou celui d’Hérodias. Non pas parce qu’i...