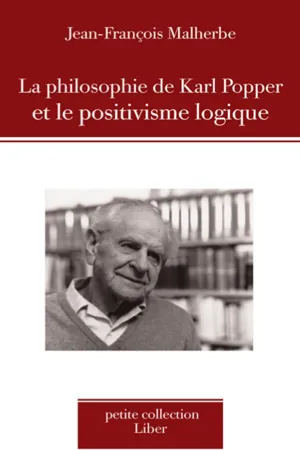![]()
Chapitre 1
L’empirisme logique radical
Les fondateurs du cercle de Vienne1
Le cercle de Vienne était un groupe de scientifiques qui s’intéressaient à des questions d’épistémologie ; constitué en 1923 par un ancien élève de Max Planck, Moritz Schlick, il tint des réunions hebdomadaires à Vienne de 1925 à 1936. En 1922, on avait confié à Schlick la chaire de philosophie des sciences inductives de l’université de Vienne et rapidement il rassembla autour de lui une brillante équipe d’universitaires appartenant à diverses disciplines : les mathématiciens Gustav Bergmann, Kurt Gödel, Hans Hahn et Karl Menger, le physicien Philip Frank, le sociologue Otto Neurath, l’historien Viktor Kraft, deux étudiants, Herbert Feigl et Friedrich Waismann, et un jeune philosophe qui avait également une formation de physicien : Rudolf Carnap. Parmi les amis du cercle, il faut citer Alfred Ayer, Albert Einstein, Bertrand Russell, Karl Popper, Hans Reichenbach, Carl Hempel.
C’est Otto Neurath qui fit connaître ce cercle de discussion dans le monde intellectuel. En 1929, il rédigea avec Carnap et Hahn un manifeste intitulé La conception scientifique du monde : le cercle de Vienne2 dans lequel sont exposées la méthode et les principales thèses du cercle, de même que les grands problèmes dont débattaient ses membres. C’est dans ce document dédicacé à Schlick que le groupe fut officiellement baptisé « cercle de Vienne ». Un an plus tard, Schlick lui-même publia dans la première livraison de Erkenntnis un autre texte important, « Le tournant de la philosophie3 », dans lequel il exposa l’orientation philosophique propre au cercle qu’il avait fondé.
Pour tenter de caractériser le but et la méthode du cercle, il convient de s’arrêter un instant au manifeste de 1929. Ses auteurs font remarquer que la conception scientifique du monde qu’ils défendent se caractérise plus par une attitude fondamentale que par des thèses particulières. Leurs efforts visent à harmoniser et à articuler entre elles les différentes branches du savoir empirique ; c’est pourquoi ils insistent sur les caractères collectif et intersubjectif de leur entreprise : le contrôle mutuel de leurs idées permit aux membres du cercle d’élaborer une philosophie originale. C’est la méthode de l’analyse logique, inaugurée par Gottlob Frege et Bertrand Russell, qui distingue ces nouveaux empiristes des empiristes classiques dont ils s’inspirent. Ces auteurs entendent atteindre ce but en clarifiant toujours davantage les concepts des sciences particulières à l’aide de l’analyse logique. « Si quelqu’un dit “Dieu existe” ou “Le fondement premier du monde est l’inconscient” ou encore “C’est une entéléchie qui forme le principe directeur des organismes vivants”, nous ne lui disons pas “Ce que vous dites est faux” ; mais nous lui demandons “Que voulez-vous dire au juste à l’aide de ces énoncés”. Alors apparaissent deux espèces d’énoncés : les énoncés appartenant à la science empirique dont l’analyse logique peut déterminer la signification ou, plus précisement, dont on peut réduire la signification à celle des énoncés les plus simples concernant des données empiriques et les autres énoncés, pareils à ceux qui viennent d’être cités, qui se révèlent vides de sens si on les entend à la manière des métaphysiciens4. »
Ce sont donc les « énoncés les plus simples concernant des données empiriques » qui forment les racines de la signification de tous les énoncés doués de sens. La question du statut de ces énoncés, que les philosophes viennois appelaient « énoncés protocolaires » (Protokollsätze), a été l’une de celles qu’ils ont le plus discutées.
Le cercle de Vienne se caractérise par son empirisme : « Il n’y a de connaissance qu’extraite de l’expérience, c’est-à-dire de ce qui est immédiatement donné5 », et par l’application de la méthode de l’analyse logique du langage permettant de tracer une ligne de démarcation entre les énoncés doués de sens et ceux qui en sont dépourvus. À cet égard, le texte de Moritz Schlick est tout aussi clair que le manifeste de 1929 et le renforce. Le fondateur du cercle décrit les principales orientations de son travail philosophique par ces mots : « Le grand virage contemporain est caractérisé par le fait que nous considérons la philosophie non plus comme un système de connaissances, mais comme un système d’actes ; la philosophie est une activité par laquelle la signification des énoncés est révélée ou déterminée. C’est grâce à la philosophie que les énoncés sont expliqués et grâce à la science qu’ils sont vérifiés. Celle-ci s’occupe de leur vérité, celle-là de leur signification effective […]. L’activité philosophique consiste à donner du sens et constitue 1’alpha et l’omega de toute connaissance scientifique6. » La métaphysique disparaît, poursuit-il, non parce que la tâche qu’elle s’est assignée dépasse les forces de notre raison, mais parce que cette tâche n’existe pas !
Telles sont les thèses principales que les fondateurs du cercle de Vienne ont inscrites à leur programme intellectuel. Elles inaugurent avec une doctrine radicale le mouvement philosophique de l’empirisme logique. Cette doctrine s’assouplira petit à petit et finira par devenir une philosophie empiriste assez libérale. L’itinéraire intellectuel de Rudolf Carnap est particulièrement représentatif de cette évolution. Carnap est l’auteur de nombreux ouvrages importants qui développent les grandes thèses de la conception scientifique du monde dans le cadre d’un formalisme rigoureux. C’était le plus écouté de tous les membres du cercle et il peut à bon droit être considéré comme l’un des fondateurs de l’empirisme logique, car c’est grâce à son premier grand ouvrage que les doctrines viennoises se développèrent de manière si constructive. Sa théorie de La construction logique du monde7, dont l’importance historique peut être comparée à celle des Principia mathematica de Russell et Whitehead et à celle du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, donna en effet un premier cadre général et systématique aux recherches des épistémologues viennois. Nous reportons au deuxième chapitre la discussion des autres ouvrages principaux de Carnap vu qu’ils témoignent d’une prise de distance croissante à l’égard du cercle.
C’est grâce à Neurath que les idées du groupe s’exprimèrent dans le manifeste du cercle de Vienne et que naquit le mouvement international de l’empirisme logique. Il eut en effet l’idée de transformer les Annalen der Philosophie en Erkenntnis, revue où, pendant neuf ans, les membres du cercle purent exprimer leur pensée8 ; il fut également à l’origine des principaux congrès organisés par le cercle : les Congrès d’épistémologie des sciences exactes (Prague, 1929 et Königsberg, 1930) et les Congrès internationaux pour l’unité de la science (Paris, 1935 ; Copenhague, 1936 ; Paris, 1937 ; Cambridge, 1938 ; Cambridge, Massachusetts, 1939). De même, ce fut lui qui imagina d’élaborer l’« Encyclopédie internationale pour l’unité de la science » que Carnap, Morris et lui-même publièrent à Chicago, à partir de 1938 sous le titre général : Fondements de l’unité de la science. Vers une encyclopédie internationale de la science unifiée9.
Otto Neurath était l’un des membres les plus actifs du cercle de Vienne. Chef de file de l’aile gauche du groupe, il adoptait face aux problèmes sociaux une attitude fortement influencée par le marxisme. Carnap rapporte qu’il critiquait sévèrement l’attitude désengagée des membres du cercle qui préféraient distinguer le travail scientifique des activités politiques. Neurath pensait, en effet, que cette attitude neutralisait l’impact que la science devrait avoir sur le progrès social. Pour lui, l’unification de la science était un but primordial ; il considérait la distinction entre les sciences de la nature et les sciences de l’esprit comme un obstacle au progrès social, car, disait-il, elle soustrait les sciences sociales à l’analyse logique qui seule peut en faire apparaître les caractères idéologiques. Il pensait par exemple que « la sociologie ne forme une partie de la science unifiée que si elle est considérée comme l’étude du comportement de la société10 ».
C’était un partisan acharné du physicisme promu par le Cercle. Schlick par contre déniait l’existence de liens entre la science et le développement social et se plaisait à répéter que « la vérité prévaut, quels que soient les obstacles que l’on mette sur son chemin ». L’aristocrate Schlick et le socialiste Neurath n’étaient pas faits pour s’entendre ; néanmoins, leurs divergences politiques ne firent jamais obstacle à leur collaboration scientifique.
En même temps que le cercle de Vienne donnait naissance au mouvement international de l’empirisme logique, il perdait plusieurs de ses membres les plus brillants. Herbert Feigl accepta en 1931 une charge professorale à l’université du Minnesota ; Hans Hahn mourut brusquement en 1934 ; en 1936, Rudolf Carnap devint professeur à Chicago, et Moritz Schlick fut assassiné par un ancien étudiant devenu fou. Les réunions du cercle de Vienne s’espacèrent et, en 1938, après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne, le cercle fut dissous. Waismann et Neurath s’établirent en Angleterre et Menger et Gödel aux États-Unis. Erkenntnis quitta Leipzig pour La Haye où son volume VIII prit pour nom Journal of Unified Science (Erkenntnis) ; mais sa publication cessa définitivement en 1940. La vente des publications du cercle fut interdite dans plusieurs pays à cause de la présence de Juifs parmi ses membres, et parce que certaines de ses activités étaient considérées comme subversives. En 1939, le cercle de Vienne avait disparu, mais l’empirisme logique était né et s’était déjà largement répandu à l’étranger, surtout aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays scandinaves.
Les ancêtres du cercle de Vienne
Les doctrines du cercle de Vienne sont celles de l’empirisme classique, mais elles sont élaborées de manière profondément originale dans le cadre de l’analyse logique du langage. Les ancêtres du cercle de Vienne sont David Hume, John Stuart Mill et Ernst Mach, et Gottlob Frege, Bertrand Russell, Alfred-North Whitehead et Ludwig Wittgenstein. Afin de pouvoir déterminer avec toute l’exactitude voulue la signification des principales thèses de l’empirisme logique, nous examinerons successivement l’héritage que Mach, Russell et Wittgenstein ont légué aux épistémologues viennois.
Ernst Mach (1838-1916) fut professeur de mathématiques et de physique avant d’être chargé des cours de philosophie des sciences inductives à l’université de Vienne. Ses principales œuvres sont La mécanique, Exposé historique et critique de son développement, L’analyse de la sensation et Connaissance et erreur.
Dans ces ouvrages, Mach élabore une théorie positiviste selon laquelle la connaissance humaine, de ses formes les plus primitives jusqu’à ses formes les plus élaborées, est un phénomène biologique s’inscrivant dans l’histoire naturelle de l’homme. Influencé par la théorie darwinienne de l’évolution, il concevait la connaissance comme un perpétuel processus d’ajustement mutuel des pensées et de la réalité. Il considérait que les objets de perception ne sont pas des choses en soi, mais des complexes de qualités relativement constants. Mach, qui appelle ces complexes éléments, déniait l’existence de choses en soi et attribuait l’illusion de leur réalité à l’usage que nous faisons des mêmes noms pour désigner des complexes changeants. Ce ne sont pas des choses en soi que nous observons mais simplement des relations qualitatives. Les lois de la nature devraient donc être formulées comme des relations fonctionnelles entre les éléments, c’est-à-dire entre des sensations qui sont tout ce que nous pouvons connaître de la réalité. Mach légua au cercle de Vienne son phénoménalisme et sa conception formaliste des lois de la nature, Frege, Russell, Whitehead et Wittgenstein une conception de la logique et des mathématiques ainsi qu’une méthode d’analyse du lan...