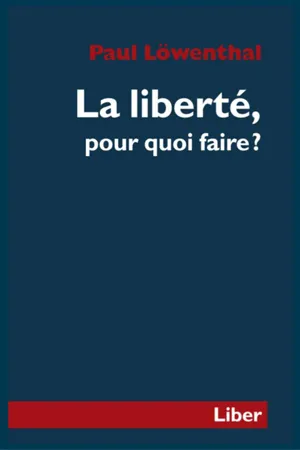![]()
CHAPITRE 1
Les libertés et la liberté
Être libre, c’est être responsable. […]
la morale, c’est ce qui ne se rattache à rien.
Pierre Chaunu
La liberté, tout le monde la veut, même sans savoir la définir, et sans en éprouver le besoin. C’est qu’avant tout elle se vit ou se revendique et qu’elle ne se raisonne qu’ensuite, lorsque les urgences en laissent le loisir. Vue ainsi, ce n’est pas tant un concept philosophique qui se laisse manier intellectuellement qu’une exigence de la vie humaine qu’il faut gérer. Notre liberté est définie par nos actes mêmes, au sens où l’on prouve la pomme en la mangeant, ou le mouvement en marchant. Cette vision contingente et rigoureusement incarnée est présente chez l’ensemble des philosophes contemporains, comme elle l’était déjà chez Thomas d’Aquin ou chez Fichte. Chez des poètes aussi. L’histoire est vie vécue, si je puis dire. Chaque époque, chaque culture, chaque situation singulière a connu ses défis et ses contraintes, qui ont été assumés avec plus ou moins de liberté et de conscience et sans trop savoir, ou sans savoir du tout, où cela mènerait le monde. Cette incertitude est aussi inconfortable que normale : « On ne peut définir que ce qui n’a pas d’histoire », a dit Goethe, et Machado que le chemin se fait en marchant, « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ».
L’avantage, c’est que nous ne sommes pas soumis à un destin tracé par je ne sais quel dieu aussi arbitraire que tout-puissant : « Ce qu’il adviendra de la liberté, seule la liberté peut le dire » (Jean Ladrière). Mais avons-nous cette liberté ? Et pouvons-nous la définir nous-mêmes en toute… liberté ? Non, pensent ceux qu’impressionne la contrainte rationnelle des lois de la nature ou d’un droit naturel, et qui, croyants ou incroyants, ne conçoivent la liberté qu’en opposition à ces normes naturelles : « Les hommes se trompent en ce qu’ils se croient libres, et cette opinion consiste en cela seul qu’ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés » (Spinoza) ; « L’esprit libre, c’est d’abord l’esprit de contradiction » (Alain).
Réciproquement, les partisans de la liberté se retrouvent parmi les fidèles de religions. Les chrétiens, en particulier, croient à leur liberté, puisque Jésus lui-même l’affirme : « Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ? » (Luc 12, 56-57). Pourtant, les catholiques se sont longtemps méfiés d’une liberté incompétente et ont laissé ériger leur hiérarchie en magistère : « L’hérétique est celui qui a une opinion » (Bossuet).
Bossuet a linguistiquement raison ! Selon cette vue, le catholique, lui, soumettrait sa raison à l’enseignement autorisé d’un magistère authentiquement enraciné dans la Révélation christique. Ce contre quoi les protestants ont particulièrement réagi : « En devenant majeurs, nous sommes amenés à reconnaître réellement notre situation devant Dieu. Dieu nous fait savoir qu’il nous faut vivre en tant qu’homme qui parvienne à vivre sans Dieu » (Dietrich Bonhoeffer). Ce qui donne son fondement, même du point de vue croyant, au jugement fameux de Marcel Gauchet : « Le christianisme est la religion de la sortie de la religion. » La société sécularisée a, dans nos pays, poussé la logique jusqu’au bout : « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » (Rousseau).
C’est que la liberté n’est pas donnée, même si l’histoire des hommes suggère que la pulsion qui nous la fait désirer est innée. « Chaque génération veut à la fois être libre de lier la suivante et de ne pas être liée à la précédente » (Jon Elster). « La liberté […] n’est pas une donnée, elle est un construit : le construit de la succession dans le temps. […] La liberté ne se saisit qu’en marche, en conflit » (Pierre Chaunu).
Nous voilà loin, déjà, des appels à la liberté des adolescents prolongés que nous avons trop souvent propension à être : « je fais ce que je veux », c’est-à-dire ce qui me plaît. Pour y voir plus clair, élaguons donc, décortiquons, nuançons et macérons… Rassurez-vous, nous terminerons sur une affirmation ferme. Elle ne portera toutefois plus sur la notion intuitive de liberté que nous charrions trop souvent. Nos premières citations ont déjà annoncé la couleur : partant de la liberté, nous aboutirons à la responsabilité, qui lui est strictement corrélative et où réside vraiment notre dignité, et à l’ambition humaine qu’elle permet.
Niveaux de libertés
Comme tous les mots importants, qui sont les mots les plus chargés de sens ou, au contraire, les plus banals, « liberté » est un terme polysémique. Si nous voulons nous comprendre, nous devons donc nous accorder sur les sens que nous lui donnons ici. Et les distinguos ne manquent pas dans l’histoire de la philosophie. Parler de la liberté n’est-il pas un singulier singulier ?
Isaiah Berlin est le père de la division devenue courante entre liberté négative et liberté positive. La première, qui est une latitude, est le fait de ne pas être empêché : en ce sens, un prisonnier n’est pas libre ; mais nous verrons qu’en un autre sens, intérieur, il peut l’être. La liberté positive, que j’appellerai faculté, est faite des moyens dont nous disposons pour exercer effectivement nos latitudes1. Ce seront des capacités aussi diverses qu’un équilibre psychologique, une compétence scientifique, des moyens financiers ou une aptitude intellectuelle au discernement moral.
Le droit et les aptitudes mentales constituent-ils des facultés ou des latitudes ? La question peut sembler théorique, mais elle a des implications pratiques. Des auteurs comme Isaiah Berlin ou Charles Taylor classent le handicap mental dans les contraintes et y voient un manque de liberté négative. Prisonnier de lui-même, le psychotique est en effet « empêché » d’agir librement, avec sa volonté consciente. En va-t-il de même du névrosé, ce qui veut dire chacun de nous, avec nos limites et nos conditionnements ? Ce serait vider de toute substance la qualification d’incapacité mentale, ou l’idée de liberté. Sauf dans les cas limites de démence ou de handicap insurmontable, l’aptitude mentale est une capacité que rien ni personne, individu ou collectivité, ne nous « empêche » d’acquérir. Elle est donc une faculté : elle ne vise en effet pas une absence d’obstacles, mais une aptitude qui dépend d’une éducation, d’un accueil familial ou social et, si nécessaire, d’un accompagnement psychologique. Si ces conditions sont réunies, la faculté peut être développée dans une certaine mesure, et l’être par nous-mêmes. Ce sera sans obligation de résultat, car nous avons tous nos limites, mais sans nier l’ambition ni notre responsabilité personnelle à la poursuivre.
En ce qui concerne le droit, il ouvre des possibilités (des droits) et il impose des limites. S’il ne fournit pas les moyens d’exercer ces droits, ou s’il ne réprime pas les transgressions à ses procédures ou à ses interdits, le droit n’est que lettre morte. Parmi les droits de l’homme, les droits économiques, sociaux et culturels font l’objet d’un pacte international qui a été conclu en 1966, mais les États-Unis ne l’ont pas ratifié et, malgré cette abstention, ont bloqué jusqu’en 2009 les tentatives des Nations unies de leur associer un protocole qui les rende exigibles en justice. Pour l’individu, il y a là un empêchement à l’exercice d’une liberté reconnue. Mais pour la collectivité, le droit effectif est une faculté à acquérir ou à conquérir. C’est plus clair encore à l’égard des interdits : ils ne m’empêchent pas, car je puis les violer.
La frontière sera parfois floue entre l’empêchement et le manque de moyens, mais le défi moral ou politique sera a priori différent. Lorsque je suis empêché, je suis prisonnier ; lorsque je refuse d’utiliser certains moyens, je suis libre !
Et la morale ? Les deux niveaux de libertés que sont les latitudes et les facultés n’ont par eux-mêmes aucune portée morale : ce sont des possibilités de fait et tout dépend de l’usage qui en est fait. Mais la distinction éclaire le champ moral, et notamment politique. Les droites individualistes se concentrent sur les latitudes en promouvant les libertés en droit, sans trop se préoccuper de ce qu’elles ne pourront être exercées que par ceux qui en ont les moyens. Les gauches se soucient davantage des facultés, ou libertés de fait, sans lesquelles le plus grand nombre ne peut exercer les libertés et les droits qui lui sont reconnus en principe. Et elles les organisent, en contraignant parfois certaines libertés négatives : « Le droit de propriété est grevé d’une hypothèque sociale », disait par exemple Pie XI, qui serait sans doute surpris de se voir cité comme témoin d’une position de gauche ! Cela montre que la liberté n’est pas un absolu, mais qu’elle vaut selon le projet qu’elle sert.
La portée morale des latitudes et des facultés dépend du jugement que nous portons sur elles, en fonction d’une vision de l’homme ou de la société. Elles n’accèdent au rang de valeur qu’en… vertu de ce jugement. Disons que, pour accéder au plan moral, nous devons dépasser les libertés négatives et positives et faire place à la liberté, au singulier : une autonomie responsable. « On appelle liberté le rapport du moi concret à l’acte qu’il accomplit », écrit Henri Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion. Pour qu’elle soit autre chose qu’une convention ou une contrainte, la morale suppose (et engage) la liberté. Seule cette liberté peut mettre en perspective un projet et s’assurer qu’il soit justifiable à la fois dans ses objectifs, dans ses moyens et dans ses conséquences prévisibles. Cela ne discrédite évidemment pas les latitudes et les facultés : la liberté comme autonomie responsable suppose les libertés pour pouvoir s’exercer, et il est hautement moral de se battre pour les libertés lorsqu’elles font défaut. C’est même la première chose à faire.
Mais peut-on, comme Amartya Sen, s’arrêter aux libertés négatives et positives pour définir la visée du développement économique ? N’est-ce pas sacrifier à une vision fonctionnelle ou utilitariste du développement ? Nous y reviendrons au chapitre 3 dans la section consacrée au niveau collectif et aux politiques. Ici, nous ferons seulement observer que si les latitudes et les facultés n’ont en soi aucune portée morale, le développement qu’elles définissent n’en aura pas davantage. Elles sont l’une et l’autre nécessaires à un développement humain intégral, mais celui-ci implique aussi une autonomie responsable, une liberté qui définisse une éthique politique de développement humain, et de tout homme. C’est vieux comme le décalogue : le Seigneur a d’abord libéré les juifs de la servitude en Égypte, il a ensuite balisé leur route par des repères en avant et en arrière (la colonne de feu), puis seulement il leur a proposé sa Loi.
Objets de libertés
Tout dépend, disions-nous, de l’usage que nous faisons de nos latitudes et de nos facultés. Cela devrait aller sans dire, mais a besoin d’être dit. Et cela conduit à affronter la question posée par le titre du livre : la liberté, pour quoi faire ?
Une liberté à exercer
La première condition d’un bon usage de la liberté est qu’il en soit fait usage, tout simplement ! Charles Taylor y insiste particulièrement et il est un des seuls à le faire : « Dans une conception en termes d’autoaccomplissement, nous ne pouvons pas dire que quelqu’un est libre lorsqu’il n’a absolument aucune conscience de ses propres potentialités, lorsque l’idée de les mettre en œuvre ne lui est jamais venue, ou lorsqu’il est paralysé par la peur de briser une norme qu’il a intériorisée, mais qui n’exprime pas ce qu’il est lui-même d’une manière authentique. […] Si les théories négativistes peuvent se fonder indifféremment sur le concept de possibilité ou sur un concept d’accomplissement, il n’en va pas de même des théories de liberté positive. L’idée que la liberté implique un autogouvernement collectif au moins partiel est inséparable d’un concept d’accomplissement. Une telle idée identifie en effet (au moins partiellement) la liberté avec le fait de se gouverner soi-même, c’est-à-dire avec l’exercice effectif du contrôle et de la di...