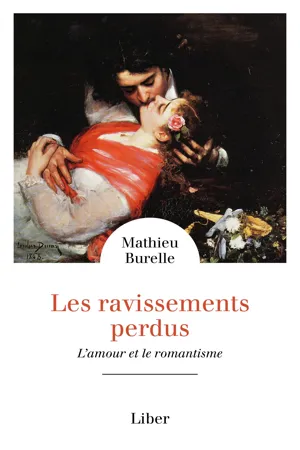Introduction
En matière de relations amoureuses, les sociétés occidentales offrent à l’observateur des visages contrastés. Nous sommes, pour reprendre la formule du philosophe Allan Bloom, des « romantiques désenchantés ». Nous sommes ( du moins plusieurs d’entre nous ) encore attachés aux idéaux du romantisme : l’amour inconditionnel qui triomphe de tous les obstacles, la passion qui se mue en union durable, le don de soi jusqu’au sacrifice, le mariage ou du moins le couple fondé sur l’amour plutôt que sur la raison. Mais nous sommes désenchantés parce que nous avons de plus en plus de mal à croire à ces idéaux, auxquels, déjà, des romantiques lucides comme Jane Austen mettaient des bémols.
La chanson Mamie, mamie, des sœurs Boulay, dit bien l’air du temps :
Mamie, mamie, tu veux savoir
C’est quand est-ce qu’on va se marier
Si une bonne fois j’l’emmènerai te voir
Si on prévoit faire des bébés
Tu sais astheure c’est pus pareil
Mes amoureux, je peux pas t’en parler
Ils sont comme les bijoux d’oreilles
On sait qu’on peut les enlever
Pour dormir ou juste pour changer
On se choisit au jour le jour
On se donne plus de rendez-vous
Si on se croise on fait l’amour
On s’fait la bise sur les joues
À la fin on rentre chez nous
Mamie, mamie, des fois j’me dis
Que l’amour, c’est comme le p’tit Jésus
Dans les histoires, ça fait joli
J’voudrais y croire, mais je l’sais pus
Nous voulons y croire, mais avec de plus en plus de peine. Pourquoi, au juste, avons-nous du mal à y croire ? Peut-être, tout simplement, parce que notre ambition de fonder un couple durable sur un sentiment amoureux s’est révélée déraisonnable. Nous en aurions trop demandé à la nature humaine.
Il faut, pour le comprendre, se souvenir que la généralisation du mariage d’amour en Occident est une conquête récente, du moins si l’on se compare aux sociétés européennes du Moyen Âge et de l’Ancien Régime. Dans La révolution de l’amour, le philosophe Luc Ferry a bien insisté sur ce point. Les rois et les reines d’autrefois, tout comme l’ensemble de l’aristocratie, ne se mariaient pas souvent par amour, même s’ils s’autorisaient des incartades, des aventures, voire des maîtresses ou des amants dûment reconnus. Ils contractaient des unions avantageuses sur le plan social, financier et politique, bien plus qu’ils n’écoutaient leur cœur. Il y avait à cela maintes raisons, dont celle-ci : l’amour ne leur semblait tout simplement pas assez fiable pour fonder le mariage.
Les réflexions de Montaigne, dans ses célèbres Essais, sont à cet égard on ne peut plus claires. À ses yeux, non seulement le mariage n’est pas fondé sur l’amour, mais il ne devrait pas l’être. Une tendre amitié, un compagnonnage cordial, demeurent à ses yeux la base la plus solide d’une union matrimoniale, alors que les amours sont par nature réservés ( pour un homme ) aux amantes qui pimentent la jeunesse d’un célibataire ou aux maîtresses qui agrémentent les jours d’un homme marié. Comme il le dit : « Le mariage a pour sa part l’utilité, la justice, l’honneur et la constance : un plaisir fade mais plus universel. L’amour se fonde sur le seul plaisir, et il comporte en vérité un plaisir plus chatouillant, plus vif et plus aigu. » Il ajoute, pour que ce soit plus clair : « Un bon mariage, s’il en existe, refuse la compagnie et les manières de faire de l’amour. Il tâche d’imiter celles de l’amitié. C’est une douce communauté de vie, pleine de continuité, de confiance et d’un nombre infini d’utiles et de solides services et d’obligations mutuelles. Aucune femme qui en savoure le goût ne voudrait tenir lieu de maîtresse ou d’amie [ amante ] à son mari. Si elle est logée dans son affection en qualité d’épouse, elle y est logée bien plus honorablement et plus sûrement. »
L’amour, plus vif, plus brûlant, entre autres parce que le désir sexuel y occupe une place prépondérante, est aussi plus inconstant, plus éphémère, plus prompt à se changer en rancune et en froideur. C’est ce que constate Montaigne : « Son feu, je le confesse, est plus actif, plus cuisant et plus âpre. Mais c’est un feu téméraire, volage, ondoyant et divers, feu de fièvre, sujet à accès et remises, et qui ne nous tient qu’à un coin. En amitié, c’est une chaleur générale et universelle, tempérée au demeurant et égale, une chaleur constante et rassise, toute douceur et polissure, qui n’a rien d’âpre ni de poignant. » Aux amantes le feu de l’amour, à l’épouse la chaleur de l’amitié conjugale. La leçon est claire. Place au mariage de raison.
Dans la bourgeoisie, le mariage d’amour était sans doute plus présent, et plus encore chez les paysans, surtout ceux dont l’union s’accompagnait de peu d’enjeux financiers et matériels pour les familles. Mais là encore, jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle, ce n’était pas la norme. Certes on préférait qu’il y ait une certaine attirance entre les fiancés, allant de l’absence de répulsion à la franche inclination, mais cette condition n’avait pas le caractère central qu’elle a acquis depuis. C’est ce qu’ont bien montré divers historiens, Jean-Louis Flandrin et Jean Claude Bologne par exemple. Les travaux aux champs, les commérages sur la place du village, les veillées et les fêtes, les pèlerinages, même les réunions spontanées autour du puits, offraient l’occasion de flirter, d’éprouver son pouvoir de séduction, d’apprivoiser la proximité du sexe opposé. On se permettait parfois des relations sexuelles passagères, adultères ou pré-fiançailles, en contournant les interdits, en écoutant le désir avec une spontanéité qu’on ne s’autorisait pas dans la recherche d’une épouse ou d’un époux. Car le mariage, lui, était une affaire sérieuse, qui requérait l’approbation des parents, laquelle dépendait de nombreux critères étrangers à l’attirance amoureuse stricto sensu.
Dans ces sociétés fondées d’abord sur des mariages de raison, parfois même des mariages arrangés, le mouvement romantique a changé la donne, comme l’a bien montré Allan Bloom. Ce mouvement a proposé une reconfiguration de notre rapport à l’amour, à la nature et au soi. Émergeant au milieu du dix-huitième siècle avec Jean-Jacques Rousseau et d’autres philosophes et romanciers, il a connu son plein essor dans la première moitié du dix-neuvième siècle, pour s’exprimer à la fois dans la peinture, la musique et la littérature, notamment chez des écrivains qui ont été, de près ou de loin, sensibles aux idées de Rousseau. Il a connu une phase plus radicale, où se sont exprimées ses tonalités les plus mystiques, les plus mélancoliques, les plus sombres aussi, avant d’amorcer, vers la moitié du dix-neuvième siècle, un lent déclin au cours duquel s’est largement diffusée, sur un mode plus concret et plus lumineux, sa conception de l’amour, à travers notamment la tradition du roman-
feuilleton sentimental. Cet ample mouvement culturel, qui a travaillé en profondeur les mentalités européennes, ne se limite pas au « romantisme littéraire », si bien que des auteurs plus réalistes dans leur style ( comme Austen, Flaubert, Tolstoï ou Wharton ) apparaissent a posteriori comme des représentants critiques de l’essor d’un imaginaire romantique en Occident. Cet imaginaire accorde à l’amour, surtout l’amour-passion, la place centrale dans une vie réussie, au-delà de l’amour filial ou parental, des conventions sociales et des obstacles religieux. Pour lui, l’amour doit être au fondement du mariage, et il justifiera l’adultère dans un ménage sans amour. Il met en outre l’accent, dans cette quête de l’amour vrai, sur l’écoute de soi, l’authenticité, l’idéalisme dans l’opposition aux obstacles qui nous détournent de nos vrais sentiments.
Au regard de ce qui prévalait au temps de Montaigne, le romantisme était révolutionnaire et promettait des lendemains meilleurs. Loin d’écarter du mariage le feu ardent de l’amour, les romantiques entendaient le fonder sur lui. Nombre d’hommes ou de femmes, qui s’étaient contentés d’une entente conjugale cordiale, au mieux amicale, qui n’avaient jamais connu de relations amoureuses véritables, faute d’avoir pu écouter leur cœur ou rencontrer la bonne personne, pouvaient désormais espérer autre chose. Espérer que les histoires d’amour des contes de princesses deviendraient pour eux aussi une réalité.
L’essor du roman comme genre littéraire, à la fin du dix-huitième siècle, est contemporain de cette lente propagation du romantisme, de cette diffusion de nouveaux espoirs, de nouvelles mœurs, dont témoignent nombre de classiques, de La nouvelle Héloïse à Anna Karénine en passant par Orgueil et préjugé ou Madame Bovary. La bourgeoisie, qui avait succédé à l’aristocratie mais persistait à soumettre le mariage à des considérations de prestige et de confort, a été un temps menacée par ce mouvement, qu’elle a récupéré en ouvrant le mariage aux élans du cœur. Nous sommes les héritiers de cette ultime victoire du romantisme. Fidèles à cette promesse de changement, nous avons instauré en Occident le mariage d’amour, avec la possibilité de se séparer quand l’amour n’est plus là. Avec en tête parfois cette idée un peu folle : que, à l’ère de la démocratie, l’amour-passion se transformant avec le temps serait, lui aussi, démocratisé. Chacun aurait, une fois les obstacles sociaux vaincus, son conte de fées à raconter. Comme si la nature avait prévu que tous puissent en vivre un, comme si les choses étaient au fond bien faites.
Avec les résultats que l’on connaît. La moitié des mariages finissent en divorce. Si nous tenons compte des unions de fait et des amours de passage, quel est le taux d’échec : 85 % ? 90 % ? Difficile dans ce contexte de croire à l’amour inconditionnel, au sacrifice, au forever after. Nous avons essayé, ça n’a pas fonctionné. Les ravissements promis se sont révélés chimériques. Fin des illusions. Le romantisme est maintenant une affaire pour jeunes filles, pour tendres garçons à leur première idylle. Une recette pour « films de filles », un canevas pour romans de gare. Reste des sentiments plus incertains, des couples où chacun cherche prudemment son bonheur, des unions dont on ne sait trop si on doit croire en elles. On espère encore, avec un doute derrière la tête. Alors on vit sa jeunesse, on expérimente, en espérant trouver un jour. Certains s’en accommodent avec grâce, certaines en tirent des blogs sur leur vie d’éternelles célibataires, d’autres se morfondent en attendant le gran...